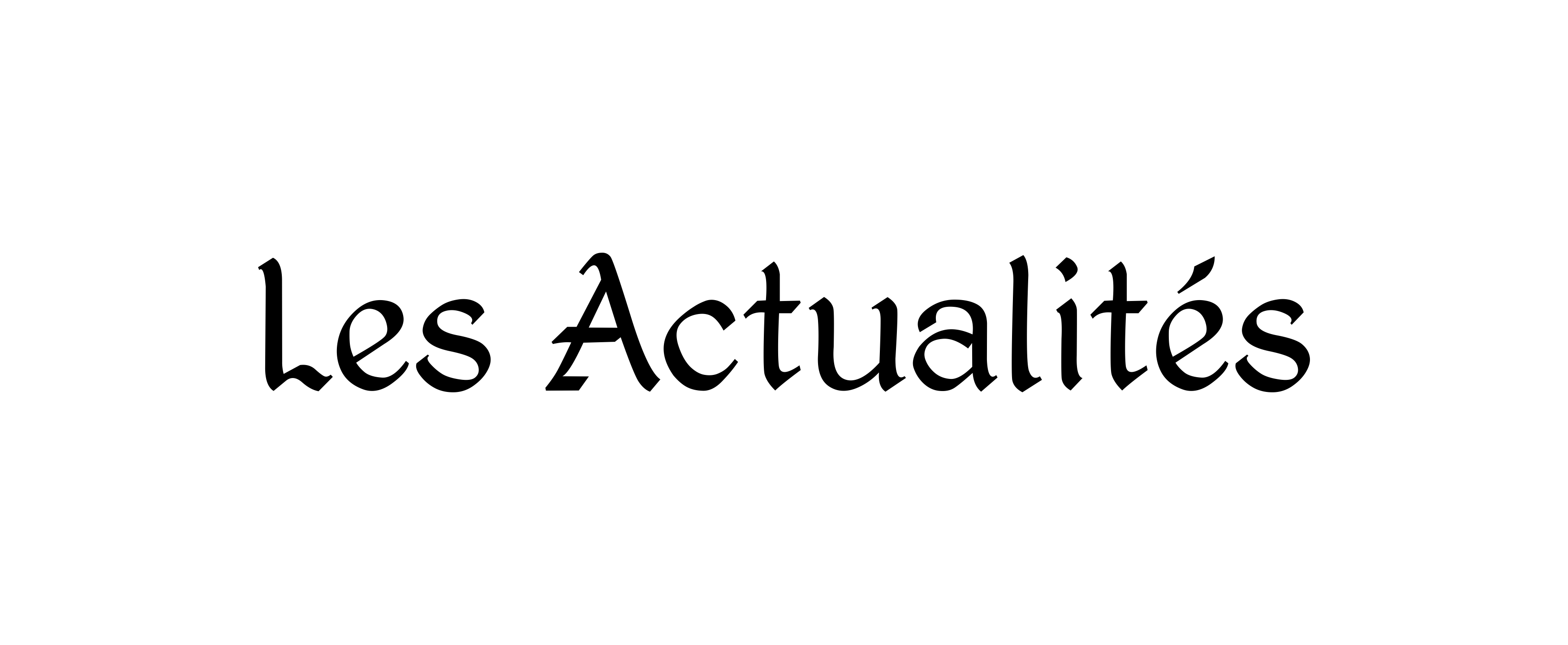Misère
Basé sur la propre lutte de King avec des fans indignés qui luttent pour accepter son écart des livres uniquement dans le genre de l’horreur, Misery est une autre histoire qui existe également en dehors de ce que nous pourrions généralement attendre de lui. C’est un thriller sombre et comique dépourvu d’éléments surnaturels néfastes qui arme à la place l’extrême solitude d’une femme et son droit encore plus extrême de raconter l’une des histoires de fandom les plus efficaces et les plus persistantes du cinéma. Une Kathy Bates parfaitement calibrée, qui reste la seule lauréate d’un Oscar pour un film King à ce jour, alterne son antagoniste attachée au roman d’amour Annie entre le doux et l’aigre d’une scène à l’autre, le scénario astucieux de William Goldman ajoutant une texture émotionnelle plus compliquée à ce qui aurait pu descendre dans la hagsploitation bon marché. Son interaction au bord du siège avec un James Caan jamais meilleur est une bataille d’esprit vraiment terrifiante, crescendo dans une scène de violence inoubliablement bien orchestrée, un “clopinage” rendu encore plus horrifiant par sa profession d’amour juste après. La culture pop a peut-être changé depuis l’obsession d’Annie pour les livres de poche, mais l’intensité de la culture des fans reste tout aussi effrayante. Benjamin Lee
Le brillant

King détestait l’adaptation par Stanley Kubrick de son roman sur Jack Torrance, un écrivain en herbe et alcoolique qui accepte un emploi de gardien d’hiver à l’hôtel Overlook dans les Rocheuses, emménage sa femme et son fils dans son immense lieu isolé et hanté, et procède devenir fou meurtrier. King a même tenté de contrer le film avec une mini-série télévisée collante de trois nuits avec la star des Wings Steven Weber dans le rôle immortalisé par Jack Nicholson. Mais Le brillant est principalement le cas de l’artiste rare avec une vision aussi imposante que celle de King, n’extrayant que ce dont il a besoin du roman pour créer un film d’horreur singulier, infiniment mystérieux et passionnant, qui taquine de multiples interprétations tout en offrant une terreur qui mouille le pantalon. Kubrick n’a rien fait de moins que de réinventer le langage visuel de tout le genre, désorientant constamment le public à travers un labyrinthe d’effets de caméra et d’astuces de conception tout en les frappant de chocs. (Il peut également s’excuser pour son rôle dans la simulation de l’alunissage.) Scott Tobias
Dolorès Claiborne

La misère a tendance à attirer la part du lion de l’attention parmi les collaborations Kathy Bates-Stephen King, mais beaucoup (y compris Bates elle-même) considèrent Dolores Claiborne comme la meilleure performance et le meilleur film. Le réalisateur vétéran Taylor Hackford nous plonge dans les choses alors que la vieille Vera Donovan tombe dans un escalier jusqu’à sa mort – Claiborne, sa femme de chambre, l’a-t-elle tuée ou était-ce un accident ? Pendant deux heures tendues qui combinent des notes de noir, d’horreur et de thriller, le film déroule les nombreux fils d’abus, de molestation et de dysfonctionnement familial qui ont empêtré la mère titulaire et sa fille. Souvent lu comme un film féministe, Claiborne relate trois visions très différentes de la féminité, vues via Donovan, Claiborne et sa fille, toutes liées par les cicatrices infligées par les hommes. Atmosphérique dans son cadre rural de l’île du Maine, avec une scène de salle d’audience époustouflante et une séquence d’éclipse inoubliable, le film est transportant, très lisible et très, très divertissant. Veronica Esposito
Christine

Deux personnages n’auraient pas pu être mieux assortis l’un à l’autre. Au moment où John Carpenter a réalisé Christine, basé sur le roman du même nom de Stephen King, le réalisateur avait déjà sécurisé son héritage indomptable avec Halloween et King était si prolifique que 1983 (la même année où il a publié Christine) a vu les adaptations à l’écran de deux de ses autres romans : Cujo de Lewis Teague et The Dead Zone de David Cronenberg. Et peut-être qu’aucun autre partenariat – les deux principaux piliers du cinéma d’horreur à l’époque – ne pourrait transformer une Plymouth Fury de 1958 en cauchemars cinématographiques extrêmement effrayants. Lorsque le lycéen ringard Arnie (Keith Gordon) achète et restaure une vieille voiture abîmée, qu’il baptise Christine, il devient de plus en plus clair que non seulement le véhicule est sensible, mais meurtrièrement jaloux de quiconque menace de s’interposer entre elle et son nouveau propriétaire. Avec une partition lisse et mémorable de Carpenter lui-même, Christine se profile parmi les adaptations cinématographiques les plus mémorables de King et est restée un classique culte précieux pour les fans d’horreur. Kelli Weston
L’homme qui court

Même si King semble être un client décent sur les réseaux sociaux, en tant que non-amateur de longue date de l’horreur, je ne peux pas dire que mon cœur se remplit de joie chaque fois qu’il y a un nouveau film avec son nom dessus. (Je peux bien traverser The Shining, mais c’est pour admirer plutôt que pour apprécier.) Non, ce ne sont pas les films d’horreur qui me dérangent (bien que cela n’inclue pas The Shawshank Redemption) et j’ai toujours apprécié The Running Man, d’un des romans de Richard Bachmann de King. C’est assez idiot et, à certains égards, ressemble à une répétition des meilleurs films d’Arnold Schwarzenegger – Total Recall, T2 – mais avec Starsky lui-même dans le fauteuil du réalisateur, qui peut résister à sa gloire Spandex ? De plus – de toutes les personnes – Mick Fleetwood a un caméo en tant que chef rebelle. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Andrew Poulver
La brume

Frank Darabont a écrit et réalisé deux des adaptations de Stephen King les plus exceptionnellement chaleureuses, les drames jumeaux des Oscars en prison The Shawshank Redemption et The Green Mile. De manière improbable, il s’est ensuite retourné et a réalisé peut-être le film le plus dur et le plus sombre basé sur une histoire de King, The Mist – un thriller vraiment impitoyable sur un groupe de citadins désespérés enfermés dans une épicerie après qu’un mystérieux brouillard ait roulé sur leur bourg endormi du Maine, apportant avec lui une horde de bêtes cauchemardesques mortelles. Darabont s’appuie sur les signes extérieurs de science-fiction des années 50 de la nouvelle de King, ainsi que sur le potentiel de riff sur la paranoïa chamailleuse, claustrophobe et à un seul endroit de Night of the Living Dead. The Mist est un splendide film de monstres, avec des effets de créature qui ont étonnamment bien résisté au fil des ans, mais c’est aussi une méditation plutôt flétrissante sur la tendance de l’humanité à glisser dans le tribalisme et l’hystérie en temps de crise ; à cet égard et à d’autres (y compris la liste des acteurs), vous pouvez appeler le film un essai à sec de la version télévisée de Darabont sur The Walking Dead. La fin, soit dit en passant, est plus sombre que même King n’était prêt à y aller – une expression franchement étonnante de la plus grande peur de l’auteur, une incapacité à protéger sa famille des maux du monde. Andrew Dowd
Lot de Salem

La réinvention libre par Stephen King du mythe de Dracula filtre le plan narratif de Bram Stoker à travers ses propres thèmes d’animaux de compagnie, greffant l’histoire de transactions immobilières carnivores sur l’une des banlieues idylliques de la Nouvelle-Angleterre où les extérieurs placides de Rockwell dissimulent de sombres fourrés psychologiques. La prose de King a habilement fusionné la terreur fantastique des vampires avec les peurs effrayantes et plausibles des enfants vulnérables dans un monde hostile et adulte, mais la mini-série de 1979 réalisée par Tobe Hooper a capturé encore plus clairement l’avantage d’un cauchemar aux yeux d’enfant. Le somptueux bas prix de la diffusion CBS poli par le blocage et la composition avec tact de Hooper, la performance accentuée de James Mason convenant parfaitement à un ton un ou deux crans du réel, la conception de créature sauvage qui entraîne le comte Orlok par l’oreille pointue dans l’ère pop – ce sont trois repas carrés de film d’horreur classique généreusement répartis sur trois heures, vicieux et amusants dans des proportions idéalement équilibrées. Si seulement c’était trois heures de plus. Charles Bramesco
Carrie

King travaillait comme professeur d’anglais au lycée à moins d’une décennie de son temps en tant qu’étudiant lorsque Carrie a été publié. C’est peut-être pourquoi son premier roman qui a marqué sa carrière ressemblait à une vision de cauchemar si fraîche, capturant la terreur et le traumatisme d’être un adolescent. Carrie a tellement de caractéristiques pour lesquelles l’auteur deviendrait connue – macabre prend la puberté et la vie domestique – qui sont toutes distillées dans le film élégamment impie de Brian DePalma, où l’humour de potence est élevé par le style Hitchcock et giallo. Sissy Spacek, avec ses traits anguleux et anguleux et ses cris de banshee, est emblématique en tant que Carrie, l’adolescente maladroite et victime d’intimidation élevée par un fanatique religieux abusif. Elle a du mal à contrôler ses hormones et ses pouvoirs de télékinésie jusqu’à ce que sa soirée de bal de promo de Cendrillon soit tordue et tordue par ce sinistre complot visant à la tremper dans du sang de porc. Cette séquence est monumentale, avec DePalma déchargeant toute la grammaire visuelle à sa disposition – longues prises passionnantes et gracieuses, ralentis antagonistes et écrans partagés chaotiques – avec la même fureur contrôlée que Carrie déchaînant le feu de l’enfer. Radheyan Simonpillai
Soutenez-moi

On dit souvent avec les histoires de Stephen King, qu’il ne s’agit pas d’horreur ; il s’agit des personnages. Nulle part cela n’a été plus mis à l’épreuve que dans Stand by Me, qui a librement adapté la nouvelle de King, The Body, en un passage à l’âge adulte nostalgique, picaresque, presque familial – bien que la mortalité soit au cœur de ses préoccupations. Je n’étais qu’un peu plus âgé que les protagonistes de l’histoire lorsque je l’ai vue pour la première fois en 1987, ce qui explique peut-être pourquoi elle a touché un tel accord : des japes juvéniles, des airs rétro des années 50, une grande scène de vomissements, mais aussi le sens de l’âge adulte qui attend juste sur les rails . Cela semble un peu sentimental aujourd’hui, certes, mais combien de films de n’importe quelle époque ont examiné l’amitié des jeunes hommes avec autant de compassion et d’honnêteté ? King a déclaré que l’histoire était “autobiographique”, mais on a également l’impression que le quatuor central du film est de vrais copains, ce qui témoigne des jeunes acteurs. La préfiguration inquiétante de la mort de River Phoenix, six ans plus tard, rend le film encore plus poignant. Steve Rose