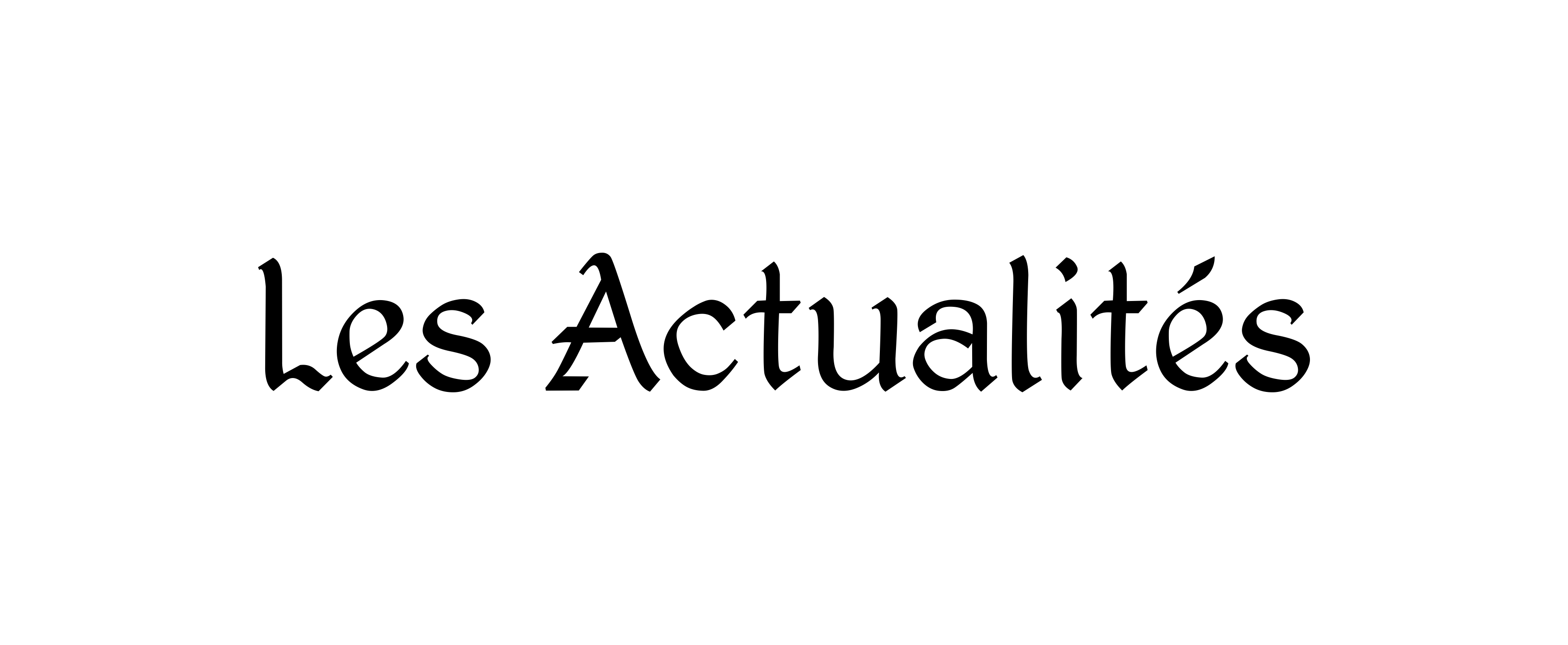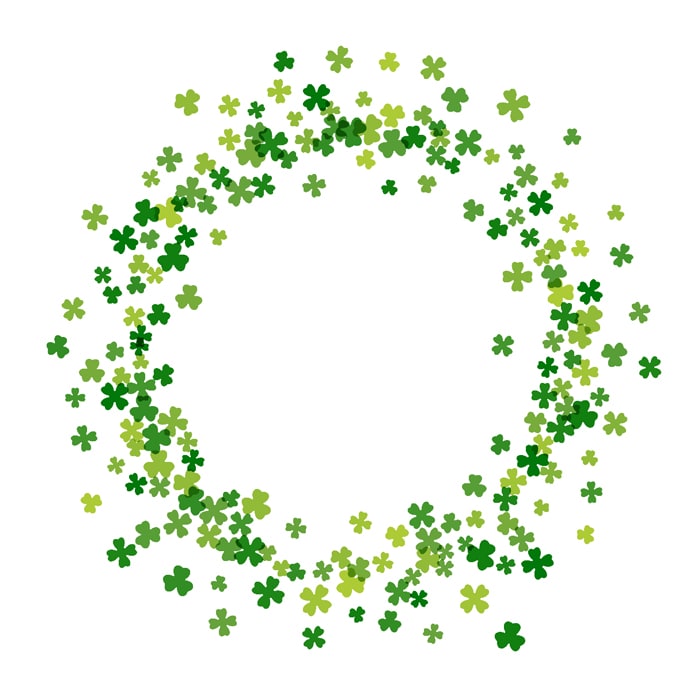“Emerald Light” vire au surréalisme lorsque Billy, dont la voiture s’est échouée sur un lit de ruisseau rocheux dans une tempête, est approché par un garçon qui pense que Billy est un médecin, venant soulager la douleur de sa mère alors qu’elle meurt d’un cancer. Billy va à son aide, ne prétendant pas tout à fait être le médecin ; il administre un Ativan à la mère, sous la surveillance de son mari, puis lui remet le flacon. Il sait qu’il ne peut pas l’aider, mais peut-être qu’il peut soulager sa souffrance, dont il imagine qu’elle doit, d’une certaine manière, refléter la sienne. L’image du sosie d’Antrim assistant à une mère mourant d’agonie d’un cancer rappelle les propres soins d’Antrim envers sa mère, Louanne, et ses peurs, admises dans La vie après la mort, qu’il avait en quelque sorte commis un matricide. L’Ativan est-il destiné non seulement à apporter le calme, mais comme le genre de sédatif qui pourrait accélérer la mort de la mère ?
Un vendredi d’avril est un récit beaucoup plus sombre et plus intime de ces souvenirs et de la façon dont leur tourment soutenu l’a conduit à une période de maladie mentale débilitante. Voici une partie de ce qu’il nous raconte : que sa grand-mère l’a enlevé de force à sa mère, un nouveau-né, empêchant le lien essentiel qui, craint-il, permet un attachement sain tout au long de la vie ; les matins après les fêtes de ses parents, quand leurs amis s’évanouissaient encore sur le sol du salon ; un voyage de camping d’enfance tant attendu puis avorté, annulé parce que son père avait besoin du confort de sa propre cour et d’une glacière de bière ; les hospitalisations de sa mère pour intoxication alcoolique ; qu’à l’âge de cinq ans, affligé par les disputes de ses parents, il s’était frotté le visage contre le tapis jusqu’à ce qu’il ait des plaies. “Comme j’ai dû être malheureux”, écrit-il. Tout cela lui pèse :
J’avais survécu, ou je pensais survivre, à l’alcool et aux cris de mes parents, à nos déplacements constants, aux pertes de lieux et d’amis, mon oncle allongé sur le dos, anéantissement sur anéantissement. J’avais joué dans la cour, fracassé des balles de tennis contre les murs pendant des heures, construit des modèles réduits d’avions et écouté mes disques la nuit dans ma chambre. J’avais dormi la nuit avec des chats pour compagnie, j’avais fait du vélo, et j’avais lutté à l’école, et, plus tard dans la vie, je suis allé dans les bars, puis j’ai arrêté d’aller dans les bars, j’ai fumé des cigarettes et de l’herbe, et je suis tombé amoureux, et argumenté et inventé, et a refusé de parler à mon père, et a souffert ma mère. Rien de tout cela n’avait arrêté ma mort.
Parfois, Antrim s’adresse directement au lecteur qui, imagine-t-il, peut partager certaines de ses circonstances. « Peut-être avez-vous passé du temps à essayer chaque jour de ne pas mourir, seul quelque part. Peut-être que cet effort est devenu, ou est devenu, votre travail dans la vie », écrit-il. D’autres fois, il utilise la deuxième personne pour amener ses lecteurs à s’imaginer à sa place. Il décrit en détail l’épreuve de l’ECT :
L’infirmière place le masque à oxygène sur votre visage. L’anesthésiste insère une seringue dans la pipette reliée à l’aiguille dans votre bras. L’anesthésique coule dans le tube. Vous pouvez le sentir. Il a une odeur sucrée. Vous comptez à rebours, cent quatre-vingt-dix-neuf, quatre-vingt-dix-huit, puis l’anesthésique atteint votre sang, et une seconde s’écoule, et vous sentez que vous tombez – et puis la noirceur.
La minutie de son récit, sa palpabilité et la façon dont il est projeté sur nous, ses lecteurs, nous aide à ressentir ce qu’il ressent. Ce n’est peut-être pas nous en cet instant, recevant cette goutte d’anesthésique avant l’ECT, mais avec son aide, cette évocation, nous pouvons imaginer les sensations, et la peur.