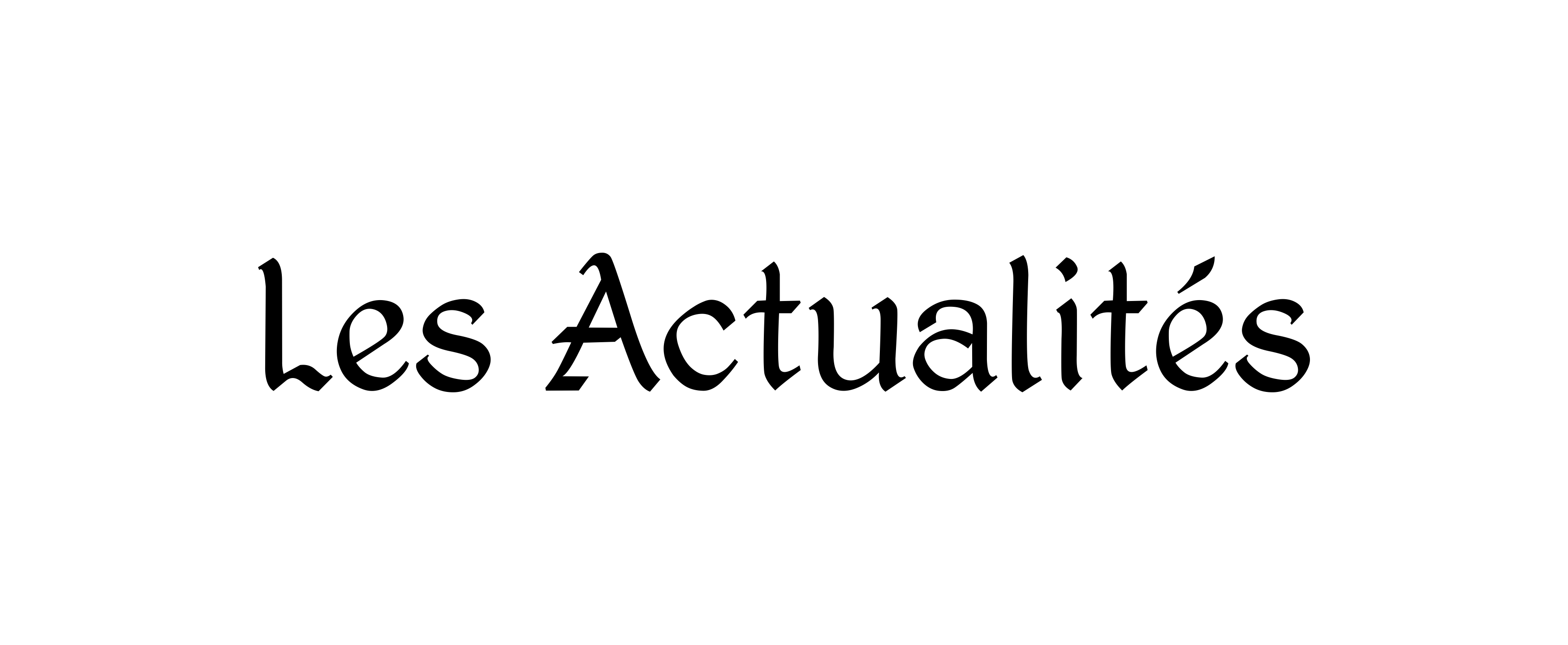réeborah James meurt en public depuis cinq ans. Depuis son diagnostic de cancer de l’intestin en phase terminale, elle est devenue célèbre et aimée en tant que militante infatigable, co-animatrice du podcast primé de Toi, moi et le Big C, auteur d’un livre sur le cancer et un contributeur humain et affirmant la vie à la conversation sur la façon dont nous affrontons la mort. Maintenant, elle a dit qu’elle était à la fin de sa vie. Elle n’est plus maintenue en vie à l’hôpital, mais est retournée mourir chez ses parents avec son mari, ses enfants et ses frères et sœurs autour d’elle.
L’expression « fin de vie » est devenue une étiquette dans des expressions familières : soins de fin de vie, parcours de fin de vie, souhaits de fin de vie. L’expression « bonne mort » est utilisée sans aucun contexte. Mais au moins nous commençons en tant que société à parler de la mort. Les livres, les articles, les programmes et les podcasts brillants, intimes, drôles et écorchés de personnes mourantes ont une valeur immense, car ils nous permettent de penser à nos propres fins, et comment nous voulons mourir dit quelque chose sur la façon dont nous voulons vivre.
Après avoir survécu à un cancer du sein de stade 4 en 1975, Susan Sontag a écrit sainement et brillamment sur son expérience de la maladie (ce «côté nocturne de la vie») et s’est opposée à la cruauté idéologique de penser la maladie en termes métaphoriques – le cancer, par exemple, comme une invasion secrète impitoyable, quelque chose à combattre et à vaincre. Elle a exhorté les lecteurs à traiter la maladie uniquement comme littérale, corporelle, la chance du tirage au sort.
Pourtant, Sontag a toujours été terrifié à l’idée de mourir. Lorsqu’en 2004 on lui a diagnostiqué un syndrome myélodysplasique incurable, l’idée de sa propre mort était inacceptable, insupportable, inconciliable. Elle a jeté tout son argent, son espoir et son refus dans un traitement expérimental radical qui n’allait jamais la sauver et a fait de son dernier chapitre un chapitre de souffrance et, pour ses proches, de consternation impuissante. Elle ne pouvait pas dire au revoir à ceux qui l’aimaient parce que c’était une reconnaissance inexprimable qu’elle serait bientôt leur souvenir d’elle. Elle n’a pas eu une « bonne » fin de vie.
Lorsque la star de cinéma Steve McQueen a reçu un diagnostic de cancer du poumon agressif en phase terminale, il s’est envolé pour le Mexique pour des thérapies alternatives, puis une opération mortelle. Son chirurgien a apparemment déclaré que McQueen affichait une immense volonté de vivre, mais cela peut être refondu comme un refus angoissant de reconnaître la vérité que tout le monde pourrait voir. Il n’a pas eu une bonne mort.
James n’a que 40 ans, avec une jeune famille. Elle a eu tous les traitements disponibles (17 tumeurs enlevées, poumons dégonflés, corps découpé) et a réussi à vivre avec esprit, humour et un sens aigu de la préciosité de la vie. Mais maintenant, elle accepte que la mort est à la porte. Elle veut, dit-elle dans une interview (où elle portait une longue robe verte et des boucles d’oreilles en or et sirotait du champagne), être entourée de ceux qu’elle aime le plus et entendre le “bourdonnement normal de ma vie au fur et à mesure”. Cela ressemble à une bonne mort et ici le bien n’a absolument aucune connotation morale, et ne devrait jamais en avoir. Nous disons trop souvent que les mourants sont courageux, stoïques, sereins (ou alternativement consumés par la terreur ou le déni). Aucun de nous ne sait comment nous allons faire face à l’impératif de la mort, et le courage ou une acclamation performative ne sont pas la question. Je suppose que je veux dire que James vit jusqu’au moment de mourir ; l’approche de la fin ne l’a pas empêchée de vivre, mais a rendu le fait d’être vivant encore plus résonnant de sens et d’amour.
Cette bonne mort est en partie entre les mains des médecins et des infirmières. Contrairement à avant le 20e siècle, les personnes sous soins médicaux peuvent souvent être sauvées de maladies qui les auraient tuées auparavant et, lorsque leur heure est venue, elles n’ont plus besoin de mourir à l’agonie. (Il n’est pas rare que les médicaments qui soulagent la douleur mettent fin à la vie.) Mais de tels soins peuvent signifier une médicalisation, qui peut amener au chevet un bataillon de procédures défiant la mort : médicaments, tubes, dissections et poisons sur mesure, un appareil complexe de tortures sur mesure pour maintenir le patient en vie au-delà de son temps. La mort peut apparaître comme une honte et un échec ; le retenir aussi longtemps que possible le but.
Elle peut aussi être entre les mains de la personne en fin de vie. Il est difficile mais pas impossible de dire non : non au traitement du dernier coup de dés, à la faible chance d’un temps supplémentaire qui coûte des souffrances supplémentaires, à l’espoir qui ressemble plus au désespoir, à l’illusion que la mort ne nous arrivera pas, ou pas encore, à la croyance singulièrement humaine que la maladie est une faiblesse et la mort un échec, un scandale et une honte. Dire : la fête est finie.
Comme les penseurs nous le disent depuis des milliers d’années, la mort donne un sens à l’existence (« Le but de toute vie, c’est la mort », écrivait Freud). Les animaux périssent mais les humains meurent, car les humains savent qu’ils sont mortels, même s’ils s’efforcent de ne pas savoir, même lorsqu’ils peuvent entendre l’échafaudage se construire sous leur fenêtre. La connaissance de la mort peut plonger une personne dans le temps présent, ce que Dennis Potter, vers la fin de sa vie et buvant de la morphine, a appelé la merveilleuse « actualité de tout », ou Clive James dans son poème d’adieu célèbre comme « un monde qui brillait si brillamment à la fin ».
Sontag a écrit que pour ceux qui n’ont ni foi religieuse ni sens de la mort comme “naturel”, c’est “le mystère obscène, l’ultime affront, la chose qui ne peut être contrôlée… seulement niée”. C’est le mot “naturel” qui m’interpelle ici, l’arrogance et l’auto-aliénation du sentiment que les humains sont en quelque sorte en dehors de la nature, en dehors de leur propre corps, avec sa décomposition inévitable et son horloge qui fait tic tac les jours.
Quand au cours de ses dernières semaines, Sontag parlait de ne pas mourir, elle parlait de mourir. Et quand James a parlé au fil des ans de mourir, elle a parlé de vivre : vivre illuminée par la connaissance de sa fin. Elle a été une vie lumineuse, vulnérable, enchanteresse, poignante et embrassante. Peut-être, en confrontant publiquement sa propre mortalité, nous a-t-elle permis de mieux jeter un coup d’œil timide sur la nôtre avant que la mort ne frappe à la porte et n’accepte un non comme réponse.
Nicci Gerrard est une Observateur journaliste et fondateur de John’s Campaign
Avez-vous une opinion sur les questions soulevées dans cet article? Si vous souhaitez soumettre une lettre de 300 mots maximum pour être considérée pour publication, envoyez-la nous par e-mail à [email protected]