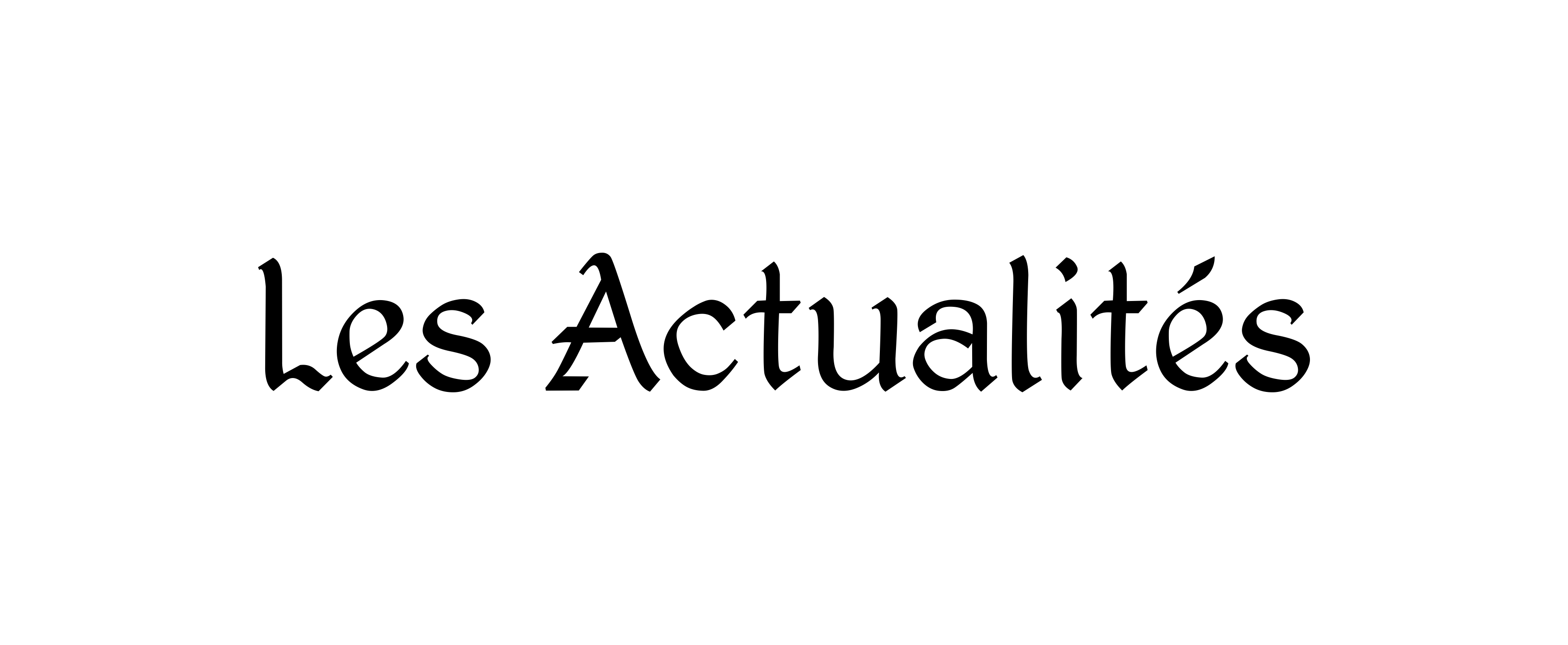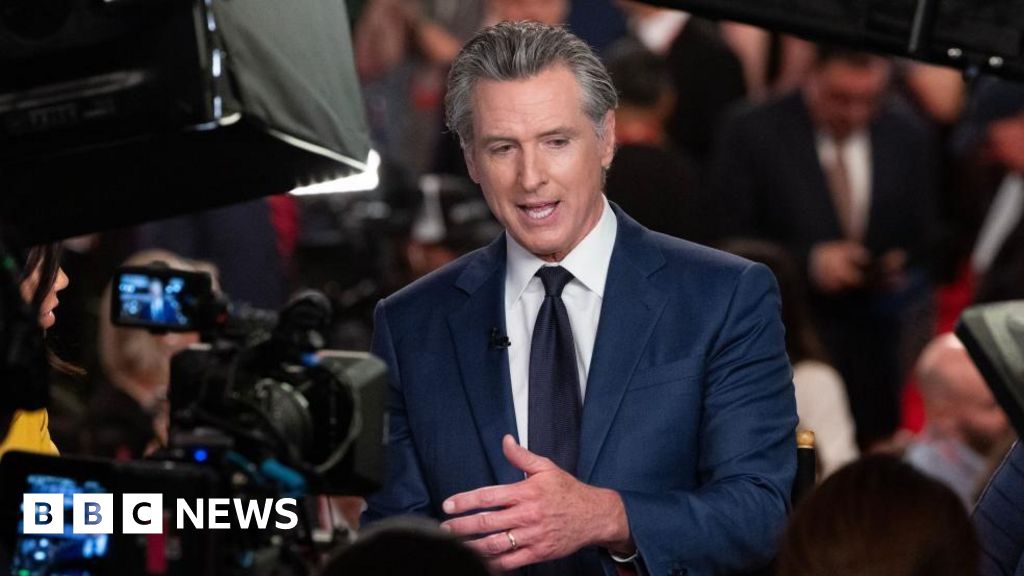Alors que l’Irlande du Nord sombrait dans la violence sectaire en 1970, le ministre britannique de l’Intérieur, Reginald Maudling, s’est rendu à Belfast pour des entretiens avec des dirigeants protestants et catholiques. Montant à bord d’un vol de la RAF pour retourner à Londres, il a pleinement exprimé ses sentiments pour ce coin particulier du Royaume-Uni. « Pour l’amour de Dieu, apportez-moi un grand scotch ! Quel horrible pays sanglant ».
Un pays horrible. Ceci d’un haut représentant du parti conservateur et unioniste. Maudling, avec son grand penchant pour le whisky, était un ministre non conventionnel, mais ses opinions étaient irréprochables. Pour beaucoup à Westminster, l’Irlande du Nord était, et est, une croix à porter – et une lourde à cela. Boris Johnson n’a jamais pu l’admettre publiquement mais, alors même que le Premier ministre britannique se débat avec l’UE au sujet des accords commerciaux post-Brexit pour la province, il s’est à peine montré comme un syndicaliste convaincu. Et tandis qu’ils professent leur « britannité », les dirigeants syndicalistes rendent peu de faveurs à leur cause. Vues du continent, les célébrations loyalistes marquant la victoire du protestant Guillaume d’Orange sur le catholique roi Jacques II il y a plusieurs siècles semblent au mieux plutôt excentriques.

L’Angleterre a gouverné l’Irlande pendant des siècles. Les Normands du XIIe siècle ont été suivis par les protestants anglais et les presbytériens écossais envoyés dans le nord-est du pays par les Tudors et les Stuarts. Et comme le raconte Fergal Tobin dans son « histoire tumultueuse », La différence irlandaisede retour à Londres, les maîtres irlandais n’y ont guère prêté attention.
Le récit de Tobin rappelle des périodes de pacification impitoyable entrecoupées de longues périodes de négligence et d’indifférence. Dans la description de William Thackeray à la veille de la grande famine du XIXe siècle, l’Irlande était « un endroit sale et ruineux ». Sans surprise, le nationalisme irlandais a recouvert ses rêves d’un passé gaélique perdu d’une hostilité brûlante envers les Anglais.
Un éditeur devenu historien, Tobin se propose d’expliquer pourquoi, même si elle s’est généralement frottée au Pays de Galles et à l’Écosse, les liens de l’Angleterre avec son voisin insulaire ont été si violemment tendus. Même en tenant compte des craintes anglaises périodiques que l’Irlande offre une porte dérobée au continent britannique pour ses ennemis continentaux, catholiques, qu’est-ce qui a rendu la relation si différente ?
Tobin évite un récit conventionnel des guerres de Cromwell du 17ème siècle, le soulèvement de Pâques de 1916, la création de l’État libre et autres pour le large éventail de la relation. Son style est anecdotique, axé sur les collisions sociales, émotionnelles et culturelles. On apprend que la Gaelic Athletic Association, pilier essentiel du nationalisme irlandais moderne, est née « dans une salle de billard du Miss Hayes’ Commercial Hotel à Thurles, Co Tipperary le 1er novembre 1884 ». Peu de temps après, la National Literary Society nouvellement formée a demandé à Douglas Hyde de la Ligue gaélique de prononcer un discours inaugural : « La nécessité de désangliciser le peuple irlandais ».
D’une manière ou d’une autre, note Tobin, l’Écosse et le Pays de Galles se sont arrangés avec les Anglais, du moins depuis l’Acte d’Union écossais de 1707. Mais ils ont alors pu conserver leur identité nationale. L’Écosse a conservé l’infrastructure sociale et culturelle d’un État, y compris une aristocratie foncière, un système juridique et une église. L’Irlande, en revanche, a été colonisée, son aristocratie indigène détruite et les terres confisquées par les intrus anglais.
La théocratie catholique arriérée et repliée sur elle-même de l’État libre d’Éamon de Valera a fait place à une nation européenne moderne florissante et socialement libérale
La faille structurelle était confessionnelle. La Réforme n’atteignit jamais l’Irlande et l’Angleterre échoua lamentablement dans ses tentatives répétées d’étouffer le catholicisme irlandais. Certes, l’anglo-protestant Charles Stewart Parnell a dirigé le mouvement Home Rule de la seconde moitié du XIXe siècle, mais la force viscérale du nationalisme était enracinée dans son catholicisme.
Au début des années 1800, un réseau de séminaires en Europe continentale fournissait les prêtres, et le système paroissial – une église catholique dans chaque village – les bases locales de l’opposition populaire à la domination anglaise. Le nationaliste Daniel O’Connell a mobilisé l’Irlande catholique derrière, comme le dit Tobin, « la foi et la patrie ».
S’il est un événement qui a rendu la rupture inévitable, c’est bien la famine de 1845-1852. Au début des années 1840, le recensement a enregistré une population de 8 millions de citoyens irlandais. Un million de personnes sont mortes et un autre million a été contraint d’émigrer, principalement aux États-Unis, par les échecs successifs de la récolte de pommes de terre. L’Angleterre a tourné le dos, son inaction façonnée par “l’idéologie économique, le providentialisme divin et la condescendance culturelle”. L’Irlande n’oublierait jamais. Ni, soit dit en passant, les descendants, dont un certain Joseph R Biden, de ceux qui ont fui outre-Atlantique. La population de l’île, actuellement d’environ 6,6 millions d’habitants, n’a jamais atteint depuis les niveaux d’avant la famine.
Un siècle après que la partition a laissé six des neuf comtés d’Ulster au Royaume-Uni, la question irlandaise n’a pas disparu. Le Brexit a desserré le ciment de l’union britannique. Les protestants, majoritairement unionistes, d’Irlande du Nord sont sur le point de perdre leur majorité numérique face aux catholiques, majoritairement nationalistes. Le Sinn Féin, longtemps associé au républicanisme violent de l’IRA, est en tête des sondages d’opinion dans la République et pourrait bientôt devenir le plus grand parti de l’assemblée de Stormont.
Le titre du petit livre de Kevin Meagher, Une Irlande unie, parle de lui-même. Comme beaucoup du côté nationaliste de l’argument, il pense que la Grande-Bretagne et l’Irlande écriront bientôt le dernier chapitre de l’histoire. Au-delà des forces centrifuges du Brexit et de la marche de la démographie, Meagher, journaliste et ancien conseiller politique du porte-parole du Parti travailliste pour l’Irlande du Nord, rassemble un éventail impressionnant de raisons expliquant pourquoi une Irlande unie est désormais bien en vue.

D’une part, la République peut désormais faire une offre plus attractive à ses cousins du nord. C’est moins menaçant. La théocratie catholique arriérée et repliée sur elle-même de l’État libre d’Éamon de Valera a fait place à une nation européenne moderne, florissante et socialement libérale. Autrefois le voisin pauvre, la République est désormais le gamin riche, une success story de l’UE. Quant à la fracture confessionnelle, l’emprise de l’Église catholique a été brisée. Les protestants rejoindraient un État laïc. Meagher est confiant : « Une Irlande unie d’ici une dizaine d’années est une possibilité réelle et croissante ».
Le mécanisme serait les référendums, nord et sud, prévus dans l’accord de paix du Vendredi Saint, ou Belfast, de 1998 qui a mis fin à près de 30 ans de violents conflits entre républicains extrémistes et unionistes. Meagher prend l’avancée du Sinn Féin comme une confirmation, s’il en fallait, que la République soutient pleinement l’unité. Quant au nord, la parité numérique entre les deux communautés laissera à terme la place à une majorité catholique (lire nationaliste).
Au total, politique, démographie et économie tirent dans le même sens. L’attachement à un Brexit britannique en difficulté n’est pas une proposition aussi attrayante pour le syndicalisme. De son côté, l’Angleterre, juge-t-il, sera contente de voir partir l’Irlande du Nord. Tout a du sens, dit Maegher. Et c’est le cas si l’on pense que la porte peut être fermée en douceur sur des siècles d’antagonisme, que la politique identitaire succombera à la logique économique et que l’unité irlandaise n’est en réalité qu’une question de nombre.
L’écrivain Glenn Patterson n’en est pas du tout si sûr. C’est une chose de parler des mécanismes de suppression de la frontière légale et physique sur l’île d’Irlande. C’en est une autre d’imaginer une rencontre spontanée d’esprits entre des communautés séparées par des siècles de différence. Pour de nombreux syndicalistes, note Patterson dans La dernière question irlandaise, la République reste un pays lointain dont ils connaissent peu et se soucient moins. Le sud est une terra incognita. Pourquoi devrait-il en être autrement ?
Patterson n’est pas convaincu que la communauté protestante sera facilement persuadée. La paix dans la province promise par l’Accord du Vendredi Saint de 1998 est mieux définie comme une absence, en gros, de violence. La fracture sectaire n’a pas été comblée et les paramilitaires des deux côtés se cachent toujours dans les coulisses. Mis à part les extrémistes, les syndicalistes ne détestent pas la République – en effet, vous les trouverez acclamant depuis les tribunes aux côtés des nationalistes lorsque l’équipe de rugby de toute l’Irlande affrontera les Anglais dans la coupe des Six Nations. Mais ils préfèrent se considérer comme britanniques. Et pour la plupart d’entre eux, le sud est assis derrière un rideau de gaze.

L’auteur, élevé dans la communauté protestante de Belfast, part à la découverte de la République pour tirer un coin de rideau. Ses voyages, rédigés sous forme de journal intime, coïncident avec le retrait du Royaume-Uni de l’UE, le différend avec Bruxelles sur le statut économique spécial de l’Irlande du Nord et les bouleversements politiques du Parti unioniste démocrate du nord.
Patterson revient de ses voyages peu convaincu que la République a une offre qui accueillera un million de protestants qui s’identifient comme Britanniques. Au contraire, l’Irlande nationaliste semble peu encline à accepter qu’elle aussi puisse avoir à changer. Parmi les politiciens du Sinn Féin exigeant un vote rapide sur l’unité, il trouve l’ambiance triomphaliste déprimante. “Nous avons gagné”. Les unionistes d’Irlande du Nord peuvent penser le contraire.
C’est là que réside la leçon de l’histoire. Les majorités nord et sud peuvent voter pour supprimer la frontière légale entre les 26 comtés du sud et les six du nord. Mais construire une Irlande unie prendra bien plus que quelques référendums. L’Irlande et la Grande-Bretagne sont peut-être à l’aube d’un dernier chapitre, mais ces trois livres très différents nous rappellent avec force qu’il ne sera peut-être pas facile de l’écrire.
La différence irlandaise, une histoire tumultueuse de la rupture de l’Irlande avec la Grande-Bretagne de Fergal Tobin, Atlantique, 18,99 £, 302 pages
Une Irlande unie. Pourquoi l’unification est inévitable et comment elle se réalisera de Kevin Meagher, Biteback, 9,99 £, 256 pages
La dernière question irlandaise. Est-ce que six sur vingt-six iront jamais? par Glenn Patterson, Tête de Zeus, 16,99 £, 288 pages
Philip Stephens est rédacteur en chef de FT et auteur de “Britain Alone”
Rejoignez notre groupe de livres en ligne sur Facebook à FT Livres Café