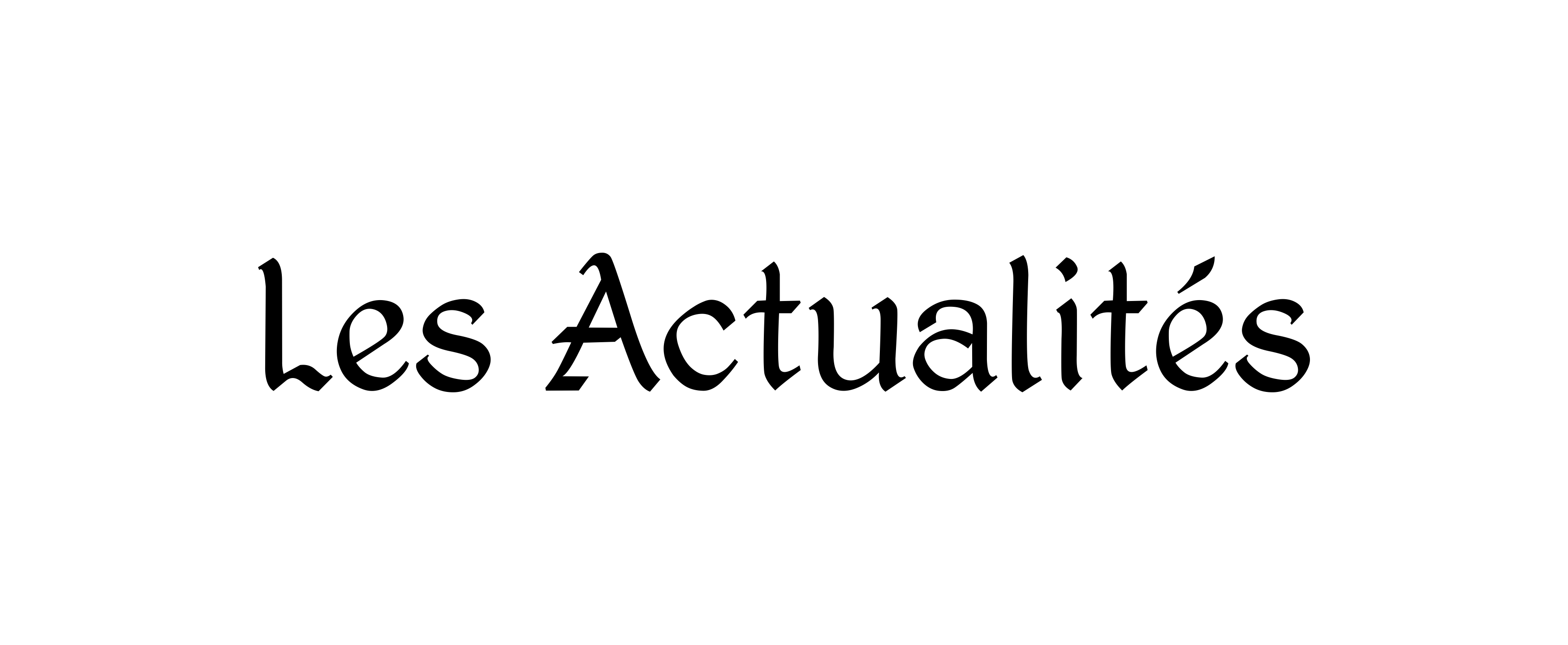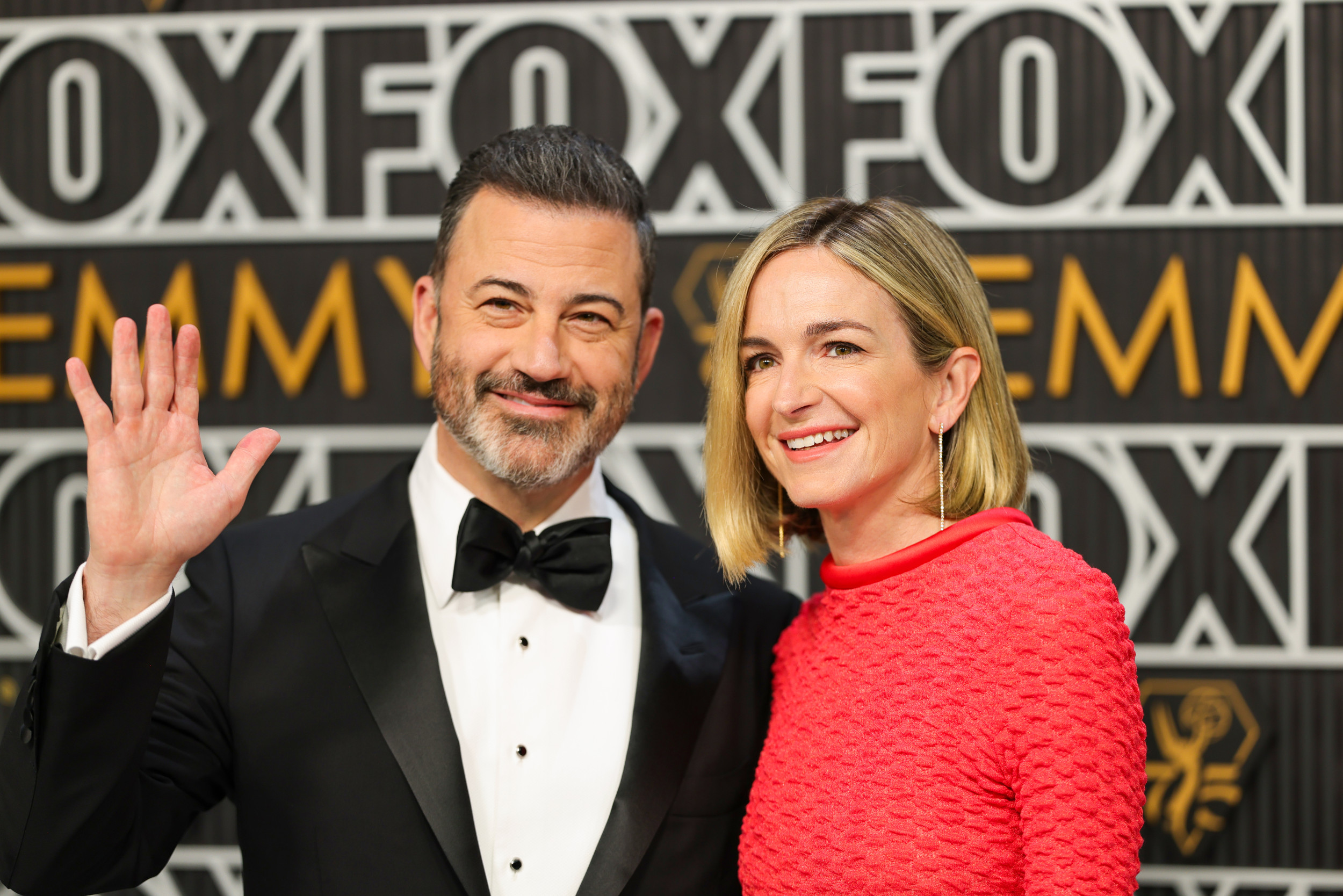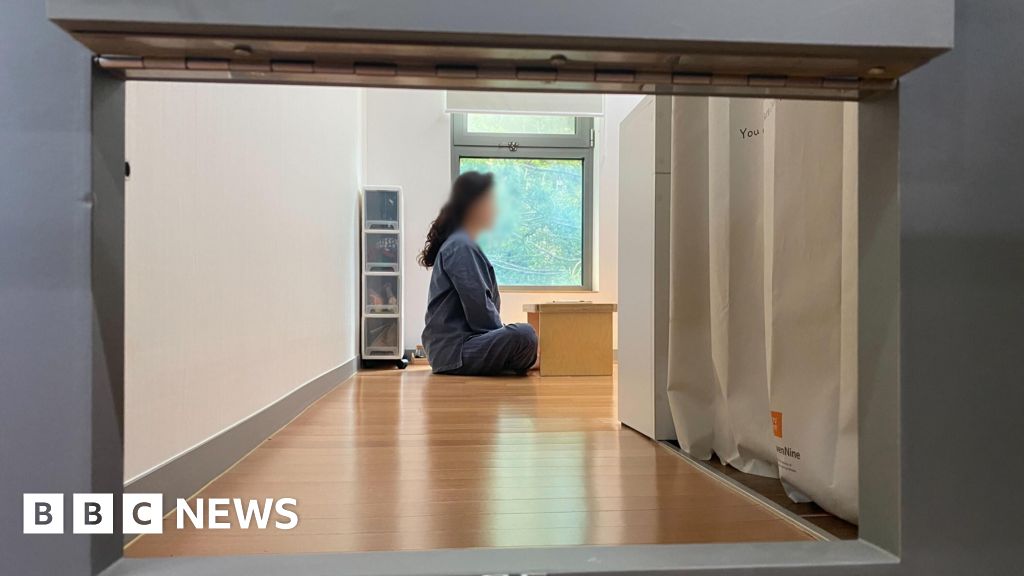Ôdans un matin glacial à Montréal Il y a deux hivers, j’ai sauté du lit et dévalé les escaliers de mon condo pour atterrir juste devant le thermostat du salon que j’ai baissé de deux degrés, sous le regard sceptique de mon conjoint. Peu importe que la pièce, avec ses quatre grandes fenêtres, soit déjà inconfortablement fraîche. Je participais à mon premier « événement de pointe » d’Hydro-Québec et rien n’allait m’arrêter.
Je venais de m’inscrire à un programme d’économie d’énergie. Plusieurs fois au cours de la saison froide, Hydro-Québec m’envoyait des courriels pour réduire ma consommation électrique régulière aux heures de pointe (disons, 6 h à 9 h ou 16 h à 20 h). Si je me conformais et réduisais deux kilowattheures (kWh), je recevrais un crédit sur ma prochaine facture pour ces économies et pour chaque kWh supplémentaire effacé. Si j’échouais, il n’y aurait aucune pénalité. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?
Mais lorsque j’ai récupéré les données quelques jours plus tard, mon esprit de compétition a été anéanti. Je n’avais pas atteint le seuil minimum de deux kWh (environ l’équivalent de faire fonctionner un four pendant une heure) pour réduire ma facture. L’hiver dernier, j’ai gagné la modique somme de 2,74 $. Cet hiver, j’ai arrêté d’essayer et j’ai gagné 1,22 $.
Mon voisin d’à côté a obtenu de meilleurs résultats. Il fait partie d’un programme d’économies d’énergie plus ambitieux appelé Hilo, une ancienne filiale en cours d’intégration à Hydro-Québec. Après avoir acheté des thermostats intelligents à un prix très réduit, il laisse le service public piloter la gestion de la température dans sa maison, jusqu’à trente fois par an, de décembre à mars. Au cours de ces « défis », il peut choisir entre trois niveaux de régulation de température : « modéré », « intrépide » et, à six degrés, « extrême ». (Le service public augmente le chauffage à l’avance, sur demande, et les participants peuvent se désinscrire jusqu’à cinq fois par hiver.) Le fait d’avoir froid les jours sans soleil s’est révélé payant pour lui : il a gagné 113 $ cet hiver, soit près de 13 % de sa facture annuelle.
Mais il n’est pas vraiment là pour l’argent. D’une part, il adore contrôler les réglages de température depuis son téléphone. Plus important encore, il veut aussi faire sa part pour l’environnement.
Hydro-Québec devra persuader des centaines de milliers de citoyens de suivre son comportement au cours de la prochaine décennie. En novembre, le service public a dévoilé sa stratégie sur la manière de répondre à l’essor attendu de la demande d’électricité dans les années à venir, conséquence des efforts visant à décarboner l’économie. Il vise à tripler la capacité de production d’énergie éolienne, à moderniser ses centrales hydroélectriques et à en ajouter de nouvelles d’ici 2035. Mais ce plan mise aussi beaucoup sur la transformation à long terme des foyers, des lieux de travail et des modes de vie des Québécois.
Hydro-Québec souhaite économiser 21 térawattheures d’ici 2035, soit plus que la consommation annuelle de 1,2 million de foyers, en partie en encourageant ses clients à réduire ou à déplacer leur consommation d’énergie. C’est un objectif ambitieux. Mais le service public estime qu’il peut influencer directement les habitudes des consommateurs avec des incitations financières pour mieux isoler les maisons, installer des pompes à chaleur et baisser les thermostats lorsque tout le monde veut de l’électricité. (Hydro-Québec affirme que ses programmes s’adressent également aux entreprises, qui assument actuellement près des deux tiers des restrictions aux heures de pointe.) Il ne lui reste plus qu’à faire passer le message.
C’est essayant. L’année dernière, elle a fait appel à Martin St. Louis pour une publicité sur le thème du hockey, dans laquelle l’entraîneur des Canadiens de Montréal compare la consommation d’énergie avec la composante défensive d’un bon plan de match.
Autrefois fustigée par les journalistes pour son manque de transparence, Hydro-Québec s’est efforcée d’impliquer davantage le public via les médias sociaux au cours de la dernière décennie, affinant un ton ironique distinctif qu’elle déploie occasionnellement contre ses critiques. Dans son Votre tweet est important pour nous (Votre tweet est important pour nous) podcast, des animateurs plaisantins adressent des commentaires qu’Hydro-Québec reçoit sur X, Facebook et d’autres plateformes en ligne. Bien que de nombreux consommateurs semblent principalement préoccupés par la hausse éventuelle des tarifs d’électricité à l’avenir, il y a également eu beaucoup de discussions sur l’efficacité énergétique, explique Jonathan Côté, responsable des médias sociaux du service public, qui apparaît également sur le podcast. Certaines des questions les plus populaires sur les réseaux sociaux, dit-il, incluent : « Pourquoi devrais-je faire des efforts en matière d’efficacité énergétique ? Ne sommes-nous pas censés avoir de l’électricité en abondance au Québec ?
Pour être franc, je me suis posé des questions similaires. Je suis pour une consommation d’énergie stratégique : j’ai grandi en France, un pays où les gens sont passés maîtres dans l’art de faire fonctionner leur lave-vaisselle la nuit pour profiter des tarifs hors pointe. Malgré tout, l’approche de récompense d’Hydro-Québec ne m’a pas réussi. Quelles chances y aura-t-il avec une population qui a grandi avec une électricité bon marché et abondante ?
J.il y a quelques années à peine, Hydro-Québec affirmait avoir la capacité de produire beaucoup plus d’électricité que nécessaire, et la province a lancé une offensive diplomatique pour signer des contrats d’approvisionnement à long terme avec le nord-est des États-Unis. Or, comme l’a déclaré le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, dans un discours prononcé en mai 2023, « les surplus ont fondu comme des glaciers sous le soleil des changements climatiques ».
Au moins, ils fondent rapidement : une grande partie de cette énergie supplémentaire sera probablement utilisée par les entreprises qui envisagent de fabriquer de l’hydrogène, des composants de batteries électriques ou d’autres projets liés à la transition énergétique. L’énergie renouvelable québécoise est particulièrement attractive pour les entreprises internationales qui cherchent à réduire leur empreinte carbone. Et le prix est difficile à battre : les gros consommateurs de Montréal ont payé 5,55 cents le kWh avant taxes en avril 2023, soit 37,5 % de moins qu’à Toronto et moins du tiers de ce qu’ils paient à New York, selon Hydro-Québec. La province a réussi à courtiser des entreprises, notamment General Motors et la société suédoise Northvolt, pour qu’elles construisent des usines de batteries pour véhicules électriques, ainsi que Volta Energy Solutions, une filiale d’une société sud-coréenne, pour produire des feuilles de cuivre pour les véhicules électriques. En janvier 2023, la demande d’électricité pour les projets industriels proposés a rapidement grimpé à 23 000 mégawatts, soit environ la moitié de la capacité d’Hydro-Québec, et bien plus que ce qu’elle pouvait allouer. Dans ce contexte, la stratégie 2035 ressemble plus à un plan de rattrapage qu’à une vision.
Pierre-Olivier Pineau, professeur et expert en énergie à l’école de commerce HEC Montréal, affirme qu’à l’avenir, la province devrait facturer aux clients industriels une consommation supplémentaire afin de refléter le coût des nouvelles infrastructures. Il estime également que les tarifs résidentiels, qui sont bien inférieurs à ceux de villes comme Toronto et Chicago, devraient également être augmentés. Le gouvernement fait de petits pas dans cette direction : début juin, Fitzgibbon a présenté un projet de loi qui pourrait à terme conduire à des tarifs plus élevés pour les grands consommateurs commerciaux et ouvrir la porte à des augmentations de prix limitées pour les ménages dans les années à venir.
Selon Pineau, une approche basée sur les récompenses n’empêchera pas à elle seule la surconsommation. « Nous devons malheureusement évoluer vers un monde qui ne se limite pas aux bonbons d’Halloween », dit-il. “Si nous voulons faire la transition énergétique, nous devrons accepter certaines contraintes.”
Une expérience récente qu’il a menée conjointement a montré qu’une majorité de participants étaient prêts à payer plus pour l’électricité lorsque les raisons économiques et environnementales étaient clairement expliquées. Toutefois, parmi la population en général, l’idée d’augmenter les prix pour contribuer à réduire la consommation semble encore impopulaire. Dans un récent sondage Léger, 83 pour cent des répondants considèrent que c’est une mauvaise idée.
L’aversion est profonde. Les prix insupportables ont été l’un des principaux facteurs à l’origine de la décision du Québec, en 1944, de nationaliser les grands services publics privés d’électricité de la région de Montréal, explique Stéphane Savard, professeur d’histoire à l’Université du Québec à Montréal et auteur d’un livre sur ce service public. Selon Savard, la nouvelle Hydro-Québec a baissé ses tarifs de manière significative.
En 1963, le gouvernement libéral du premier ministre Jean Lesage a poursuivi les efforts entrepris au cours de la décennie précédente pour nationaliser l’électricité, une mesure qui s’inscrivait dans le cadre de politiques fondamentales visant à moderniser le Québec et à donner du pouvoir aux Canadiens français dans une province longtemps dominée par le milieu des affaires anglophone. L’idée était que l’électricité était une source d’énergie si importante pour l’industrialisation du Québec qu’elle serait la clé de l’émancipation économique, explique Savard.
Hydro-Québec rachète d’autres distributeurs d’électricité et construit d’immenses barrages dans les régions éloignées, devenant ainsi un symbole du nationalisme québécois et une source de fierté. (Elle a également fait l’objet de critiques de la part d’écologistes et de groupes autochtones pour son impact sur le territoire.) Cette histoire a favorisé une relation unique entre de nombreux Québécois et leur service public, une relation sur laquelle l’entreprise s’appuie désormais pour répondre à ses préoccupations.
Aux détracteurs, les porte-parole d’Hydro-Québec insistent sur le fait que la transition énergétique fera augmenter la demande d’électricité, renforçant ainsi l’importance de consommer de manière responsable ce que nous avons actuellement. Certains consommateurs se demandent comment on peut s’attendre à ce qu’ils réduisent leur consommation d’électricité alors que la province fait pression pour qu’un plus grand nombre de propriétaires de voitures passent aux véhicules électriques. En réponse, Côté et ses collègues soulignent que les voitures électriques ne sont qu’une partie d’une solution plus large pour réduire les émissions qui comprend également un partage de voiture plus fréquent et une plus grande utilisation des transports en commun.
Aucun problème avec cela. Mais le Québec est loin d’avoir atteint ses objectifs d’ici 2030, soit réduire la consommation d’essence dans les transports à 40 % par rapport aux niveaux de 2013, ni réduire les déplacements en voiture seule. Le réseau de transport en commun du Grand Montréal fait face à un déficit abyssal que les maires s’efforcent de combler. Pendant ce temps, les gouvernements du monde entier soutiennent l’industrie automobile en subventionnant les véhicules électriques, prévient Colin Pratte, analyste à l’Institut de recherche et d’information socio-économique de Montréal, qui suit les questions de transport et d’environnement. Le dernier plan d’entretien des infrastructures du Québec prévoit près de 3 milliards de dollars supplémentaires pour les routes tout en allouant 41,3 millions de dollars au transport collectif, ajoute-t-il.
Pour moi, la contradiction la plus flagrante est cette volonté de consommer moins d’électricité sans encourager les gens à consommer moins d’autre chose. Un monde électrifié est-il encore meilleur si nous continuons à acheter de grandes maisons et de grosses voitures ? Étant donné que les camions électriques (y compris les VUS) sont plus populaires dans la province que les petites voitures électriques, je me demande si nous allons collectivement à l’encontre de cet objectif.
Où cela me mène-t-il, en tant que consommateur ? Je finirai probablement par profiter d’une des subventions d’Hydro-Québec pour acheter un poêle économe en énergie ou des thermostats intelligents. Peut-être que je suivrai même la discipline de mon voisin et que je baisserai davantage la température en hiver. Mais je le ferais plus facilement si j’étais sûr que d’autres aspects cruciaux de nos vies, notamment la façon dont nous construisons des maisons et nous déplaçons, étaient tout aussi prioritaires. Sinon, tous mes véritables efforts pour économiser l’énergie pourraient finir par être une perte de temps.
Sandrine Rastello est journaliste, animatrice de conférences et passionnée de théâtre. Elle est basée à Montréal.
#Dans #une #province #où #lélectricité #est #bon #marché #comment #inciter #les #consommateurs #consommer #moins #dénergie
2024-06-27 10:30:10