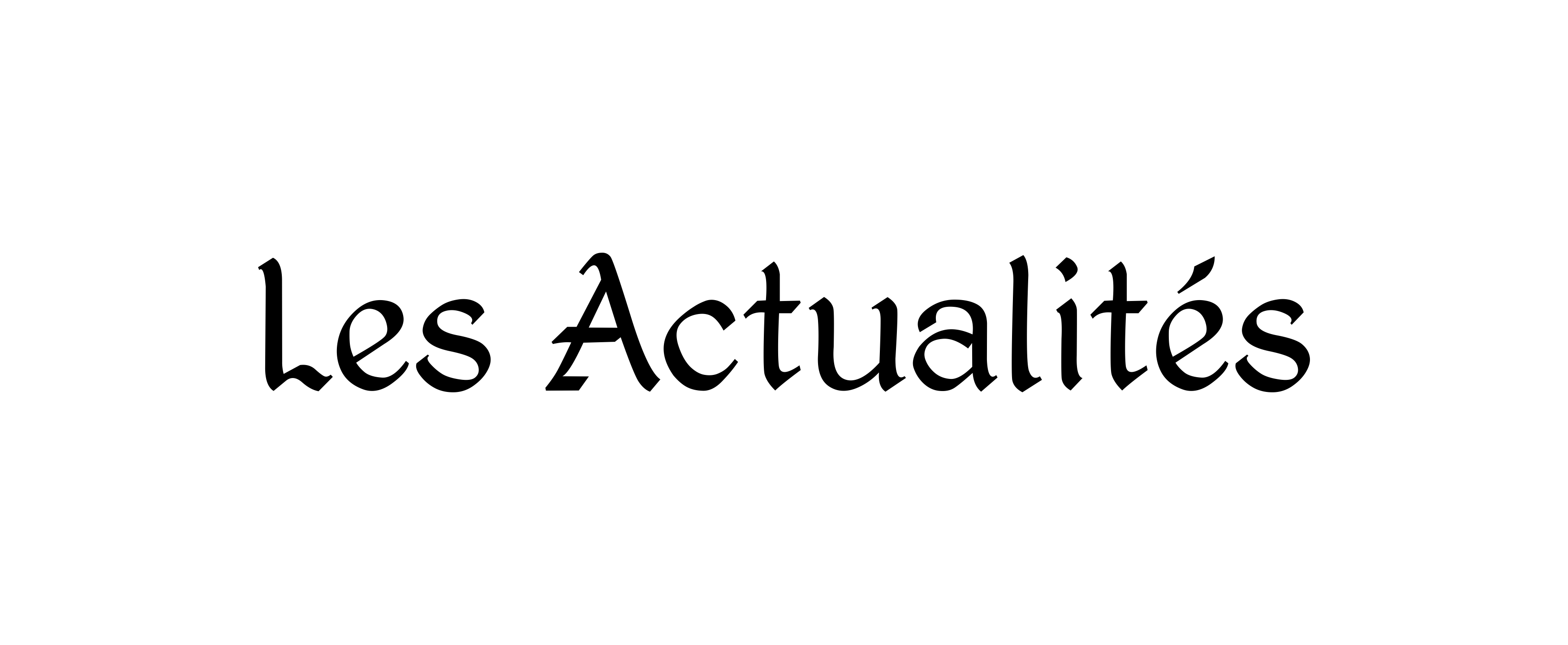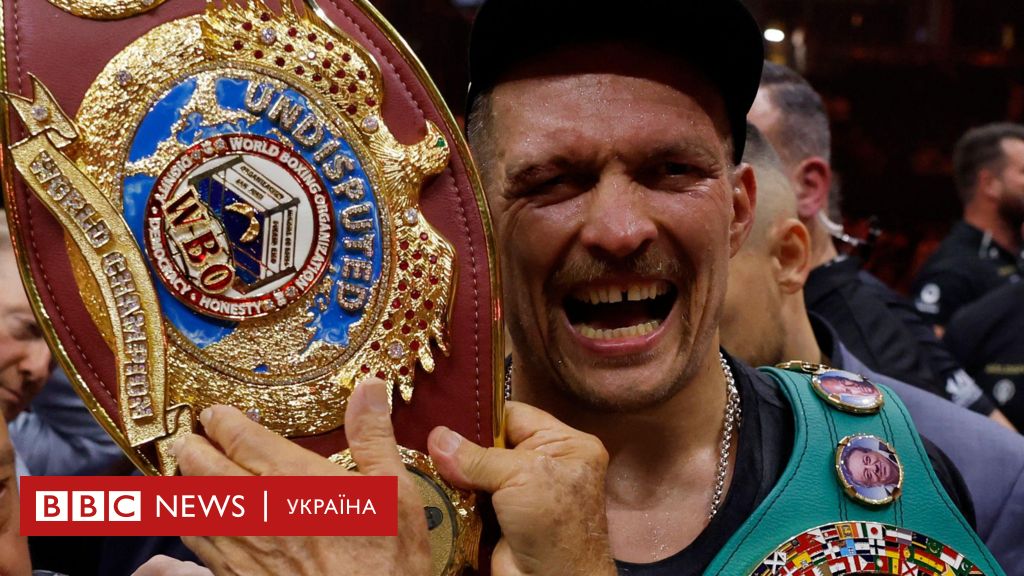Mon mari aime vraiment la géométrie, et une fois qu’il a maîtrisé une preuve compliquée, il aime la parcourir avec moi dans les moindres détails. S’il voit mes yeux vagabonder, il m’ordonne de faire attention. En général, les types de conversations qu’il apprécie sont ceux dans lesquels il expose son dernier trésor cognitif, qu’il soit scientifique, historique ou quelque point précis sur la façon d’interpréter un texte ancien obscur.
De mon côté, je gravite vers les paradoxes et j’apprécie les conversations dans lesquelles je suis celui qui pose les termes du problème et je suis celui qui met de côté toutes les réponses les plus simples. Récemment, j’ai essayé de déclencher un débat : pourquoi n’est-il pas permis de s’approcher d’étrangers et de leur poser des questions philosophiques ? Alors que je cherchais le sens profond de cette interdiction, mon mari était frustré par mon ignorance de l’évidence : « Littéralement, personne d’autre que toi ne veut faire ça !
Parfois, le point qu’il veut expliquer par magie s’aligne sur celui que je veux résoudre, mais la plupart du temps, il y a un manque de complémentarité décidément non magique entre son amour de la clarté et mon amour de la confusion. Bien sûr, nous faisons des compromis : en nous relayant, et en acceptant que l’un de nous entraîne, dans une certaine mesure, l’autre pour la balade. Mais nous pouvons aussi dire que nous faisons des compromis, et cela rend chacun de nous triste et un peu seul.
La conversation n’est qu’un exemple des différentes arènes dans lesquelles nous ne parvenons pas à nous connecter régulièrement ; en gros, il est attentionné et peu romantique, alors que je suis romantique et inconsidéré. Le mariage est difficile, même lorsqu’aucune crise ne se profile, et même lorsque les choses fonctionnent fondamentalement. Ce qui rend les choses difficiles, ce ne sont pas seulement les divers problèmes qui se posent, mais l’absence persistante qui se fait le plus sentir lorsqu’ils ne le font pas. La proximité même du mariage rend chaque distance palpable. Quelque chose ne va pas, tout le temps.
Les « Scènes d’un mariage » d’Ingmar Bergman, de 1973, sont la plus grande exploration artistique des vicissitudes de la solitude conjugale. Il se compose de six épisodes d’environ une heure, dans lesquels un couple marié, Johan et Marianne, essaie et échoue la plupart du temps à se connecter. Marianne est avocate et au début de la série, nous la voyons conseiller une femme plus âgée qui demande le divorce après plus de vingt ans de mariage. La cliente avoue que son mari est un homme bien et un bon père : « Nous ne nous sommes jamais disputés. Ni l’un ni l’autre n’a été infidèle envers l’autre. « Ne seras-tu pas seul ? demande Marianne. “Je suppose”, répond la femme. “Mais c’est encore plus solitaire de vivre dans un mariage sans amour.”
La cliente poursuit en décrivant les étranges effets sensoriels de sa solitude. « J’ai une image mentale de moi-même qui ne correspond pas à la réalité », dit-elle. « Mes sens – la vue, l’ouïe, le toucher – commencent à me faire défaut. Ce tableau, par exemple : je peux le voir et le toucher, mais la sensation est assourdie et sèche. . . . C’est la même chose avec tout. Musique, parfums, visages, voix, tout semble chétif, gris et indigne. Marianne écoute avec horreur : la femme représente le fantôme de son propre avenir.
C’est une profonde perspicacité de la part de Bergman de remarquer que la solitude implique un détachement non seulement des autres mais de la réalité en général. Enfant, j’ai eu du mal à nouer des amitiés et je me suis plutôt tourné vers la fantaisie. Je pouvais m’imaginer dans les livres que je lisais et, en embellissant les personnages, me fournir précisément le genre d’amis dont j’avais toujours rêvé. Si vous vous êtes livré à ce genre de fantasme, vous savez que le frisson de la créativité finit par s’effondrer en un sentiment de vide. C’est le moment où la solitude frappe. Vous vous êtes préparé un repas psychologique élaboré et vous vous rendez compte, tardivement, qu’il ne pourra jamais assouvir votre véritable faim.
On est souvent plus seul en présence des autres parce que leur indifférence met en relief la futilité de ses efforts d’autosuffisance. (Si vous passez une soirée à lire dans un coin, vous vous rendez compte, peu importe la qualité du livre, que vous ne trompez personne.) Dans un mariage, cette solitude se manifeste par les différentes manières dont les couples se donnent de l’espace, délimitant domaines dans lesquels chacun est autorisé à opérer de manière indépendante. Si je Autoriser mon mari d’avancer et il permet moi pour aller chercher le paradoxe – si nous nous amusons les uns les autres – l’absence de friction même des pensées qui s’ensuit leur imprègne d’irréalité. « Mon mari et moi nous annulons l’un l’autre », dit le client de Marianne. Elle veut dire, je pense, que nous sapons la réalité de la vie des uns et des autres par notre manque d’intérêt, notre non-implication, notre incapacité à fournir la traction contraignante nécessaire pour que même les expériences sensorielles les plus élémentaires se sentent réelles.
Bergman utilise la brève scène avec le client de Marianne comme toile de fond de la trajectoire très différente du mariage de Johan et Marianne. Au lieu de parvenir à un compromis mutuel, ils deviennent de plus en plus – et violemment – intolérants à l’égard de leur échec à se connecter. Dans l’épisode d’ouverture, le couple est interviewé pour un article de magazine qui les présente comme l’image du contentement conjugal bourgeois. Au fur et à mesure que la série se développe, ils se chamaillent, apprennent qu’ils se sont trompés, en viennent aux mains, divorcent et, finalement, s’étant remariés, ils se trompent à nouveau. La clôture du dernier épisode, intitulé “Au milieu de la nuit dans une maison sombre quelque part dans le monde”, les trouve blottis les uns contre les autres dans un cottage isolé pour un week-end en amoureux. Marianne s’est réveillée d’un cauchemar qui évoque des peurs existentielles ; Johan calme ses sanglots et la série se termine.
Bergman a écrit, à propos de cette fin, que les deux sont “maintenant citoyens du monde de la réalité d’une manière tout à fait différente d’avant”. Ayant compris qu’ils ont vraiment quelque chose à s’offrir, ils sont également obligés de voir à quel point c’est moins que ce à quoi ils s’attendaient initialement. Ils ont troqué l’illusion d’un mariage heureux contre une véritable connexion dont la portée est douloureusement limitée. Le cauchemar de Marianne reflète cette connaissance durement acquise : « Nous traversions une route dangereuse. Je voulais que toi et les filles vous teniez à moi. Mais mes mains manquaient. Il ne me restait que des souches. Je glisse dans le sable mou. Je ne peux pas te joindre. Vous êtes tous là-haut sur la route et je ne peux pas vous joindre. Le petit réconfort réel que Johan est en mesure de lui apporter n’enlève rien à la perspicacité : « Je ne peux pas vous joindre.
Les mariages sont entourés d’une coquille opaque ; nous n’avons pas tendance à parler, publiquement, de la façon dont ils résonnent avec le bourdonnement de la déconnexion. « Scenes from a Marriage » a ouvert cette coquille, exposant – et j’emprunte ici la propre formulation de Bergman – comment le couple marié réagit à chaque « faille vaguement ressentie » avec « des solutions de fortune et des platitudes bien intentionnées ». Vue par environ la moitié des Suédois, la série était réputée être à l’origine de l’augmentation du taux de divorce dans le pays. De toute évidence, tous les téléspectateurs de Bergman n’étaient pas prêts à voir ce qui se cache derrière la façade conjugale.
Le remake de “Scenes from a Marriage” par Hagai Levi, actuellement diffusé sur HBO, est chargé d’hommage. Il est souvent profondément fidèle à l’original, jusque dans des détails tels que le rêve avec des bras de souche. Mais Levi met à jour et américanise l’histoire : Johan devient Jonathan, un professeur de philosophie juif joué par Oscar Isaac ; Marianne devient Mira, une cadre technique interprétée par Jessica Chastain ; et la dynamique de genre est tellement inversée que l’on peut dire que Mira est Johan et Jonathan est Marianne. Ces touches de modernisation et d’autres sont les différences superficielles entre les deux séries. La différence profonde concerne leurs traitements du problème de la solitude.
La série de Levi totalise cinq épisodes au lieu de six. L’épisode manquant, le deuxième de Bergman, est celui de la rencontre entre Marianne et son client. Il comprend également des scènes dans lesquelles Johan et Marianne décrivent les écarts de communication entre eux, aboutissant à une discussion – et à une démonstration – de la déconnexion sexuelle du couple. Le découpage par Levi de cet épisode correspond à un adoucissement plus général des conflits de Bergman. C’est une caractéristique frappante des combats de Johan et Marianne que celui qui est attaqué ne remarque souvent pas à quel point on leur a parlé durement; même dans les moments d’émotion intense, ils se parlent. Jonathan et Mira, en revanche, sont immédiatement sensibles à la manière dont ils se font du mal. Bien que Levi inclue une discussion sur le dysfonctionnement sexuel, il coupe la scène qui l’affiche et, à un moment crucial de l’intrigue, insère une scène de sexe tendre absente de l’original.
Si la relation de Jonathan et Mira semble meilleure que celle de Johan et Marianne, il faut aussi reconnaître que Levi pose un problème plus facile à son couple. Bergman a suggéré que le mariage était censé répondre à un besoin métaphysique : notre connexion à la réalité. Levi, en revanche, considère le mariage comme un moyen de se positionner dans l’ordre économique et social. L’éducation des enfants occupe une place beaucoup plus importante dans la vie de ses personnages, tout comme la gestion d’un foyer partagé. Alors que Bergman a choisi une gamme d’emplacements pour ses scènes, Levi enracine chacun d’entre eux dans la maison, qui devient un centre d’attention visuelle et intellectuelle tout au long de la série.
Le changement est révélateur. Si le mariage est composé d’un ensemble de tâches ou de projets – une carrière, la parentalité, le maintien d’un foyer – ses échecs peuvent être présentés comme extrinsèques à la question de savoir comment les époux se connectent. Le diagnostic de Levi est quelque chose comme : ces personnes ont des priorités différentes. Cela signifie que leur vie peut réussir dans une plus grande mesure que leur mariage. Ce qui était, entre les mains de Bergman, une image horrible des limites du contact humain devient, chez Levi’s, un ensemble de voyages de croissance personnelle de plus en plus indépendants.
À la fin du remake, Jonathan, Mira et leur fille s’épanouissent et même une partie de leur maison a été rénovée. Dans la vision de Levi, le problème de la solitude peut être résolu en ajustant la pragmatique de la dépendance mutuelle ; au début, ces changements sont douloureux, mais finalement tout le monde s’en sort mieux, c’est-à-dire mieux à atteindre ses objectifs. Pour Bergman, la connexion est l’objectif, et il n’est pas clair que nous pouvons le faire. C’est lorsque Johan et Marianne s’en rendent compte qu’ils deviennent « citoyens de la réalité », une perte d’innocence dont ils ne peuvent se remettre. Un mariage peut-il survivre à un compte honnête avec lui-même ? Pouvez-vous vous rapprocher suffisamment de n’importe quelle personne pour que la vie vous semble réelle ? Ce sont les questions de Bergman ; Levi ne leur demande pas.
Favoris des New-Yorkais
.