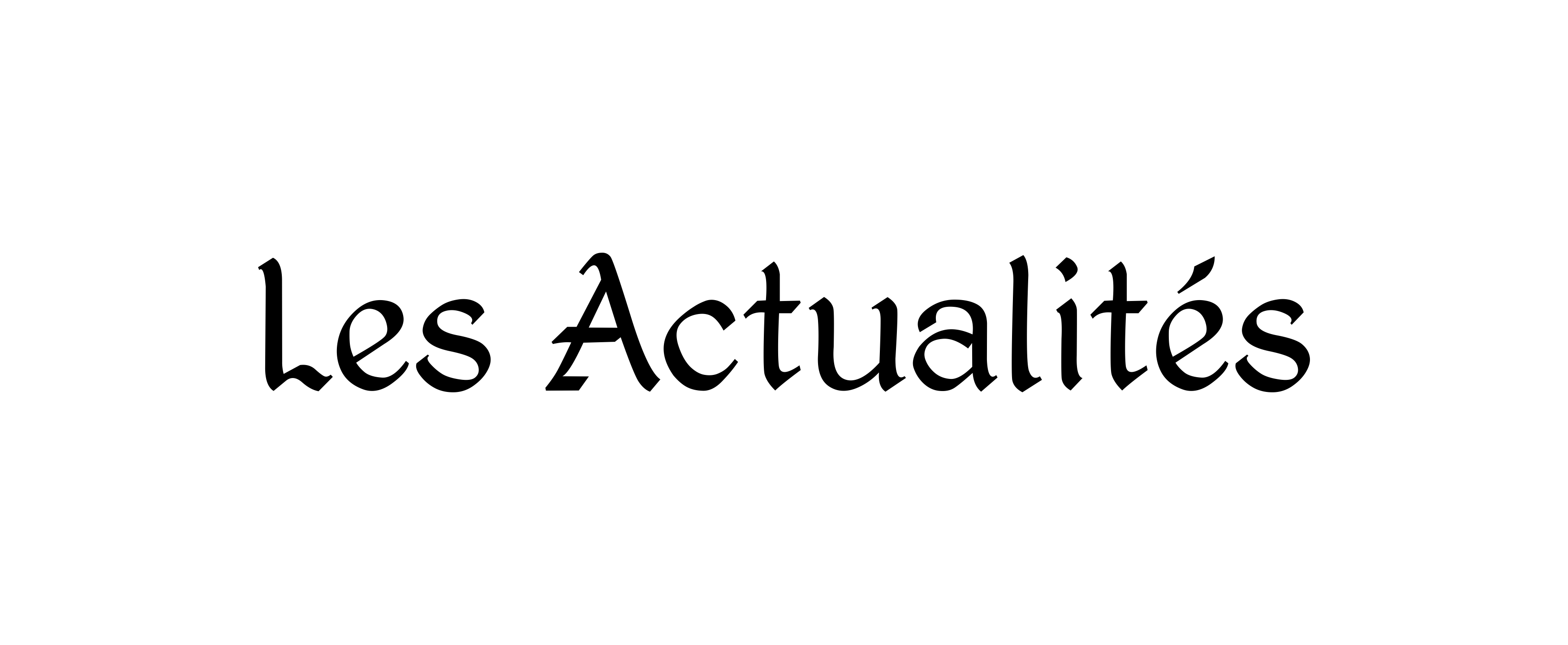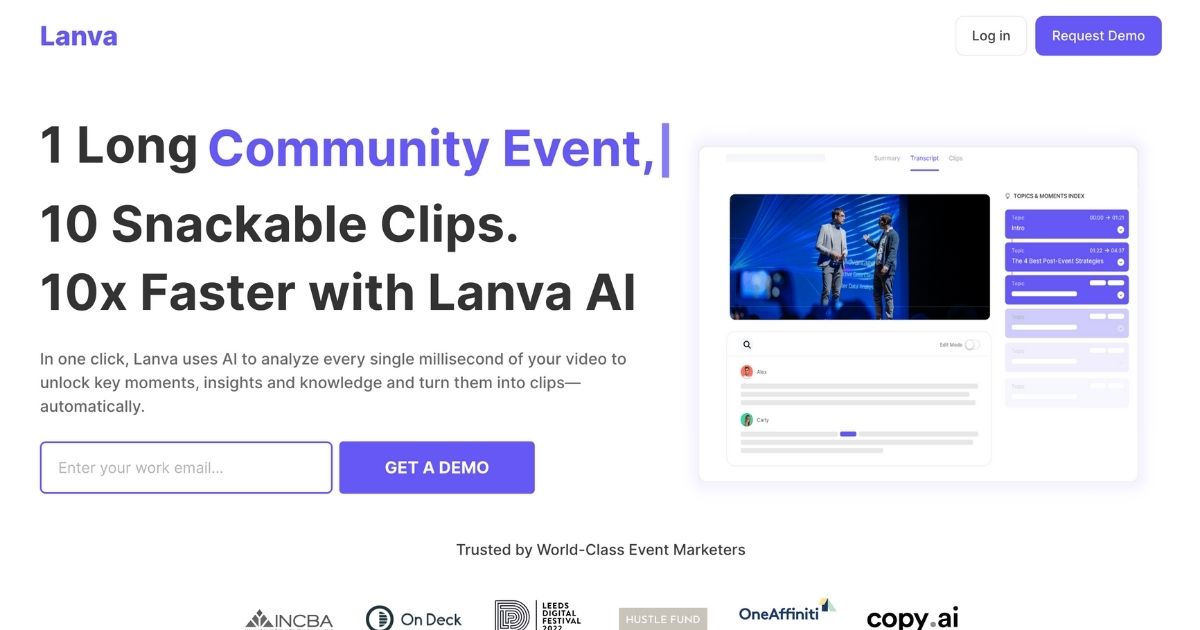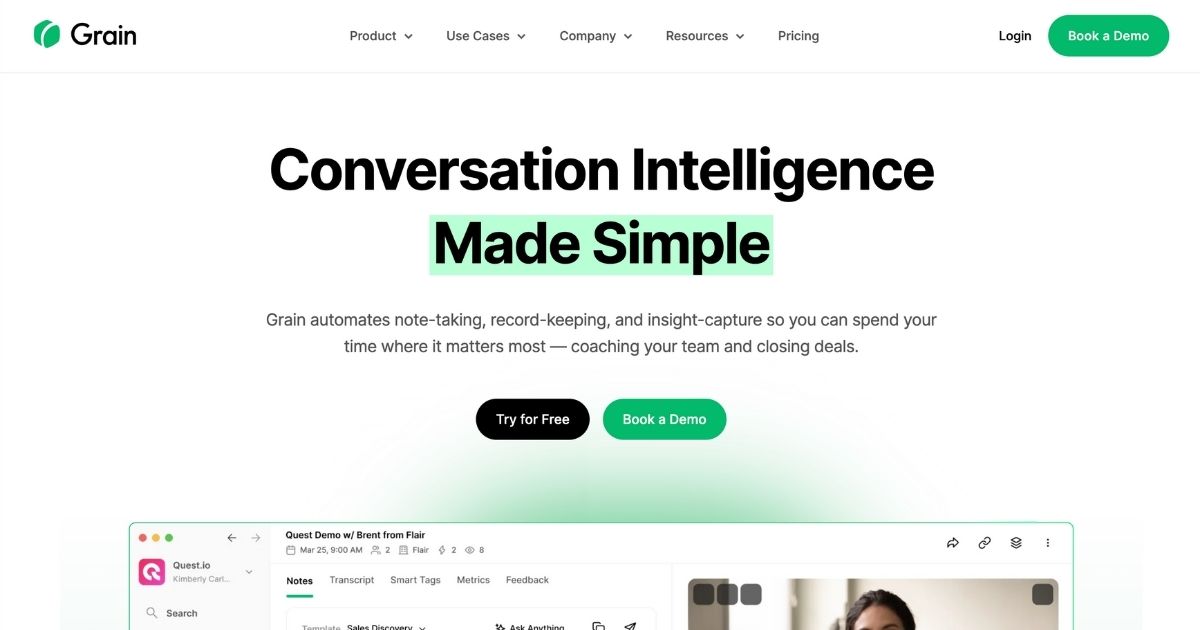Il y a vingt ans, la guerre en Irak commençait et je protestais contre cela. J’ai rejoint des dizaines de millions de personnes dans le monde entier dans cette opposition. L’Irak a dominé ma vie politique au début et au milieu de la vingtaine, et l’invasion a été le pire des nombreux actes terribles de George W. Bush, dans une présidence qui doit être considérée comme l’une des pires de l’histoire américaine.
Pendant des années, j’ai travaillé dans le mouvement anti-guerre, participant et organisant des manifestations. Les valeurs anti-impérialistes avec lesquelles j’avais été élevé étaient soudainement devenues résolument non théoriques. À la fin des années 2000, lorsque j’avais abandonné l’activisme anti-guerre en raison de l’épuisement professionnel et de la futilité évidente de notre mouvement, cela a laissé un trou dans mon emploi du temps et dans ma perception de moi-même. La guerre était, à certains égards, le principe organisateur de ma jeunesse. Et maintenant, 20 ans plus tard, peu de gens s’en souviennent ou veulent s’en souvenir.
Les conditions qui ont conduit à la guerre ont disparu, même si le complexe militaro-industriel qu’elle a activé attend. Le pays est passé de l’Irak au point de l’effacer presque totalement de nos débats politiques.
Gore Vidal, un critique volubile de la guerre décédé en 2012, a appelé notre pays « les États-Unis de l’amnésie », et il est difficile de ne pas être en désaccord.
Le néoconservatisme n’est pas mort, mais il est loin du centre brûlant de la guerre culturelle qui anime désormais la politique de droite. La fixation identitaire qui s’est emparée de la gauche américaine laisse peu de place à la politique étrangère ; l’incohérence trumpienne qui définit le conservatisme contemporain s’étend aux questions de guerre et de paix.
La police de New York se prépare à arrêter un petit groupe de manifestants anti-guerre devant la Bourse de New York, le 19 mars 2007, à New York.
Michael Nagle/Getty Images
La guerre nous a coûté au moins 3 000 milliards de dollars, a ruiné la crédibilité de l’Amérique pendant une génération dans une grande partie du monde et, selon une estimation prudente, a tué 600 000 personnes. Pourtant, de nos jours, vous pouviez discuter de politique tous les jours pendant des mois sans jamais en parler. C’est politiquement inerte. À bien des égards, la guerre est juste… partie.
Peut-être vaut-il la peine de rappeler le contexte dans lequel la guerre est née. Le passé est toujours un pays différent, mais la différence entre le monde de l’après-11 septembre et aujourd’hui est particulièrement extrême.
J’ai du mal à faire comprendre aux jeunes adultes à quoi ressemblait l’atmosphère après les attentats – le patriotisme obligatoire, le militarisme incontesté, le sentiment de peur ambiante alors que tout le monde s’attendait à la prochaine grande attaque. Cette prochaine grande attaque n’a jamais eu lieu, ce qui a été la cause immédiate de la raison pour laquelle nous avons fini par passer à autre chose. Mais pendant des années, c’était une question de quand, pas de si ; que nous étions certains d’être frappés à nouveau était supposé par toutes les personnes sérieuses, le manque de preuves de cette croyance étant considéré comme une non-pertinence. La question n’était pas de savoir si nous devions durcir nos défenses et nous-mêmes, mais comment le faire.
La lutte contre le terrorisme a été un élément essentiel des élections politiques nationales pendant une décennie et demie.
La première question des débats présidentiels de 2004 concernait le 11 septembre. En dépit d’être un vétéran de la guerre du Vietnam qui, en tant que sénateur, a voté pour autoriser une action militaire en Irak, la campagne de John Kerry dans ce concours a lutté puissamment pour égaler la crédibilité publique de George W. Bush sur la question. John McCain, l’adversaire de Barack Obama à l’élection présidentielle de 2008, a placé la « guerre contre le terrorisme » au cœur de son argumentaire de vente, revenant sur sa carrière militaire et son expérience en politique étrangère. En 2012, Mitt Romney s’est vanté qu’en tant que président, il « doublerait Guantanamo », quoi que cela veuille dire.
La préoccupation pour le terrorisme s’est évaporée de la politique à la fois progressivement et soudainement – en 2020, il n’y avait aucune question sur le sujet dans aucun débat présidentiel – mais pendant longtemps, la défense immédiate du pays contre le terrorisme a été une obsession nationale.
“L’Irak n’avait pas fait le 11 septembre, mais cela n’avait pas beaucoup d’importance ; ils étaient arabes et musulmans, et un groupe d’arabes musulmans avait humilié les États-Unis.”
Bien sûr, il y avait une autre obsession nationale : la vengeance.
Si nous voulions être particulièrement naïfs, nous pourrions nous demander pourquoi la réaction au 11 septembre a influencé la préparation de la guerre en Irak, étant donné qu’aucun des pirates de l’air n’était irakien et qu’aucun lien entre Saddam et Al-Qaïda n’avait été trouvé. (Parce qu’il n’y avait aucun lien à trouver.)
Mais, bien sûr, l’humeur nationale qui a non seulement permis l’invasion de l’Irak mais l’a rendue populaire était une humeur post-11 septembre, une conséquence d’une attaque qui avait été impensable pour de nombreux Américains.
La plupart des gens avaient l’habitude de se promener avec un sentiment non vérifié que les États-Unis ne se faisaient tout simplement pas attaquer, et pas sans raison ; depuis la fin de la guerre de 1812, il n’y a pas eu d’attaque de grande importance sur le continent. Les deux guerres mondiales s’étaient déroulées loin des côtes américaines, laissant notre pays comme le seul grand belligérant dans l’un ou l’autre des conflits qui n’ait pas connu de destructions importantes à l’intérieur de ses frontières. Des conflits comme le Vietnam ont apporté des souvenirs désagréables et un peu de honte, mais ont été facilement compartimentés. Les diverses escarmouches mineures dans lesquelles le pays s’est engagé dans les années 1980 et 1990 ont été à peine suivies par la plupart des citoyens, et la première guerre en Irak s’est terminée par une rapide victoire américaine. Avec la fin de la guerre froide, la menace des armes nucléaires russes avait été considérablement réduite.
Qui rêverait d’un attentat sur le sol américain ? Le carnage du 11 septembre a percé ce sentiment d’invulnérabilité. Et tandis que nous pleurions à juste titre les morts, le pays pleurait également la vision de l’Amérique comme une forteresse imprenable que tant de gens considéraient comme un droit de naissance. Le soutien national à l’invasion de l’Irak, si nous sommes honnêtes, a tout à voir avec cette colère.
La guerre en Afghanistan a d’abord semblé réussie; nous n’avions aucun moyen de savoir que cela traînerait pendant 20 ans à l’époque. Mais cela n’avait fourni que peu de catharsis. Les talibans s’étaient pour la plupart dissous dans les montagnes et les régions frontalières, et les combats étaient largement décevants, du moins par rapport à la ferveur guerrière qui dévorait le pays. Il n’y a pas eu de batailles d’infanterie triomphales qui se sont terminées par des Américains plantant un drapeau sur les cadavres de leurs ennemis. Oussama ben Laden s’était malencontreusement échappé. Al-Qaïda a reçu de nombreux coups au cours de ces premières années, mais il s’agissait d’une petite force obscure qui, en fin de compte, avait exploité une vulnérabilité particulière et n’avait autrement aucune capacité à causer de réels dommages au mode de vie américain. Nous avions besoin d’une cible pour une guerre plus prête pour la caméra. Heureusement pour les mastodontes militaires comme Raytheon, et malheureusement pour les peuples du Moyen-Orient, les néoconservateurs que Bush avait intégrés à son administration avaient déjà un ennemi désigné en tête : l’Irak.

Une photo publiée le 23 novembre 2004 par la Force multinationale-Irak montre des membres de la Force spéciale irakienne (FSI) patrouillant avec des Marines dans la ville dévastée de Fallujah.
MNF-I/- via Getty Images
Si vous êtes un partisan de l’idée que la politique étrangère américaine est principalement motivée par la nécessité de maintenir l’accès aux ressources stratégiques, alors les grandes réserves de pétrole de l’Irak (parmi les plus importantes au monde) suffiront probablement à expliquer pourquoi nous avons envahi. Le fait que les États-Unis soient intervenus au Koweït, un autre pays avec d’énormes réserves, témoigne de cette théorie.
Certains pensaient que la guerre était essentiellement un drame familial, car le père de Bush, George HW Bush, s’était battu avec Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe et Hussein lui avait rendu la pareille en engageant des assassins pour le tuer. Il y a aussi toujours l’argument tout fait selon lequel tout conflit donné perpétue le complexe militaro-industriel et justifie le budget de la défense, créant une pression interne inhérente pour que l’armée américaine entre en conflit à intervalles assez réguliers.
Toutes ces théories sont correctes. Mais il ne fait aucun doute que la guerre était également motivée par un simple désir de vengeance pur et simple. L’Irak n’avait pas fait le 11 septembre, mais cela n’avait pas beaucoup d’importance ; ils étaient arabes et musulmans, et un groupe d’arabes musulmans avait humilié les États-Unis. C’étaient des étrangers d’une culture lointaine qui pratiquaient une religion étrangère. Il était temps de se venger.
“Le pays est passé de l’Irak au point de l’effacer presque totalement de nos débats politiques.”
Thomas Friedman, la longue date New York Times chroniqueur et partisan éminent de l’invasion, a tristement déclaré à Charlie Rose que «nous devions aller là-bas, en gros, et sortir un très gros bâton en plein cœur de ce monde et faire éclater cette bulle… sucer ça! Ça, Charlie, c’était ça la guerre. Parfois, ils sortent juste et disent la partie calme à haute voix.
L’Irak l’a en effet sucé; en plus des centaines de milliers de morts, des millions ont fui en tant que réfugiés et la société civile irakienne a été pratiquement détruite.
Mais les États-Unis ont fini par sucer aussi. Les billions de dollars, les milliers de vies et les immenses quantités de bonne volonté publique que nous avons brûlées « là-bas » ont disparu à jamais. La guerre a poursuivi l’administration Bush dans ses dernières années et a été en grande partie responsable des larges pertes républicaines lors des élections de mi-mandat de 2006. Notre orgueil impérial, anéanti par l’insurrection anti-américaine continue dans le pays, ressemblait de plus en plus à une distraction des problèmes internes du pays.
Ce sentiment s’est cristallisé dans la tragédie de l’ouragan Katrina, où Bush a hésité alors que des milliers de personnes sont mortes dans les rues d’une grande ville américaine. Avec le temps, l’Etat islamique se lèverait dans les régions frontalières irako-syriennes, ce qui pourrait être utilisé dans les dictionnaires pour définir les types de conséquences imprévues que l’utilisation de la force militaire rend inévitables. Le gouvernement irakien que les États-Unis ont dépensé tant de sang et de trésors pour établir persiste ; il a subi des années de bouleversements, mais s’est maintenant installé dans un état inoffensif de corruption massive et de petit autoritarisme. (Une autre conséquence involontaire de la guerre de Bush est qu’elle s’est alliée à des rivaux de sang de longue date, l’Irak et l’Iran.) Les conflits sectaires du pays persistent. La plupart des réfugiés ne sont jamais revenus. Les morts sont toujours morts.
Avec le temps, la guerre serait considérée comme une terrible erreur, et par beaucoup, un crime. Les années Obama, célèbres pour avoir instauré un sentiment de « normalité », ont contribué à apaiser la conscience nationale. On ne peut pas dire que les opinions incohérentes de Donald Trump en matière de politique étrangère équivaut à une répudiation du néoconservatisme – on ne peut pas du tout dire qu’elles représentent une philosophie compréhensible – mais sa nomination sur le ticket républicain en 2016 a aidé à établir que tout ce qui restait du mouvement néoconservateur qui qui dominait autrefois le parti était entré dans une période de torpeur.
Biden a retiré ce qui restait des forces américaines d’Afghanistan en 2020, après quoi les talibans ont repris le pays à une vitesse presque comique. Il y a eu beaucoup de déchirures de vêtements à propos de cette décision, mais le fait que le gouvernement se soit effondré après 20 ans de soutien américain a clairement montré que rester plus longtemps ne ferait que retarder l’inévitable. Nous continuons à soutenir le régime théocratique brutal en Arabie saoudite alors qu’il terrorise le Yémen, mais nous avons surtout assouvi notre soif de sang par procuration à travers la guerre en Ukraine.
Il me vient parfois à l’esprit que je devrais peut-être éprouver un peu de fierté à m’opposer à une guerre maléfique que tant d’autres avaient soutenue. Nous avions raison, après tout, et aujourd’hui très peu le contestent. Mais nous étions impuissants à arrêter la guerre, voire à l’écourter, face à une exigence nationale de revanche et à une administration qui fusionnait le christianisme évangélique et ses relents apocalyptiques avec le mal académique banal des néoconservateurs.
L’Irak a commencé comme une question gagnante pour les républicains et est devenu une aubaine pour les démocrates ; elle renforçait la perspective anti-guerre et sapait la logique d’intervention. La plupart du temps, cependant, les gens semblent simplement vouloir passer à autre chose.
Je suis certain qu’il y aura d’autres guerres à combattre de mon vivant, et que les néoconservateurs se relèveront, mais pour l’instant la machine militaire américaine sommeille. Quelque part, George W. Bush peint, et je suis prêt à parier que son cœur est tranquille. J’espère seulement que, lorsque la prochaine guerre éclatera, l’Irak ne sera pas simplement une autre partie de l’histoire ancienne de l’Amérique.