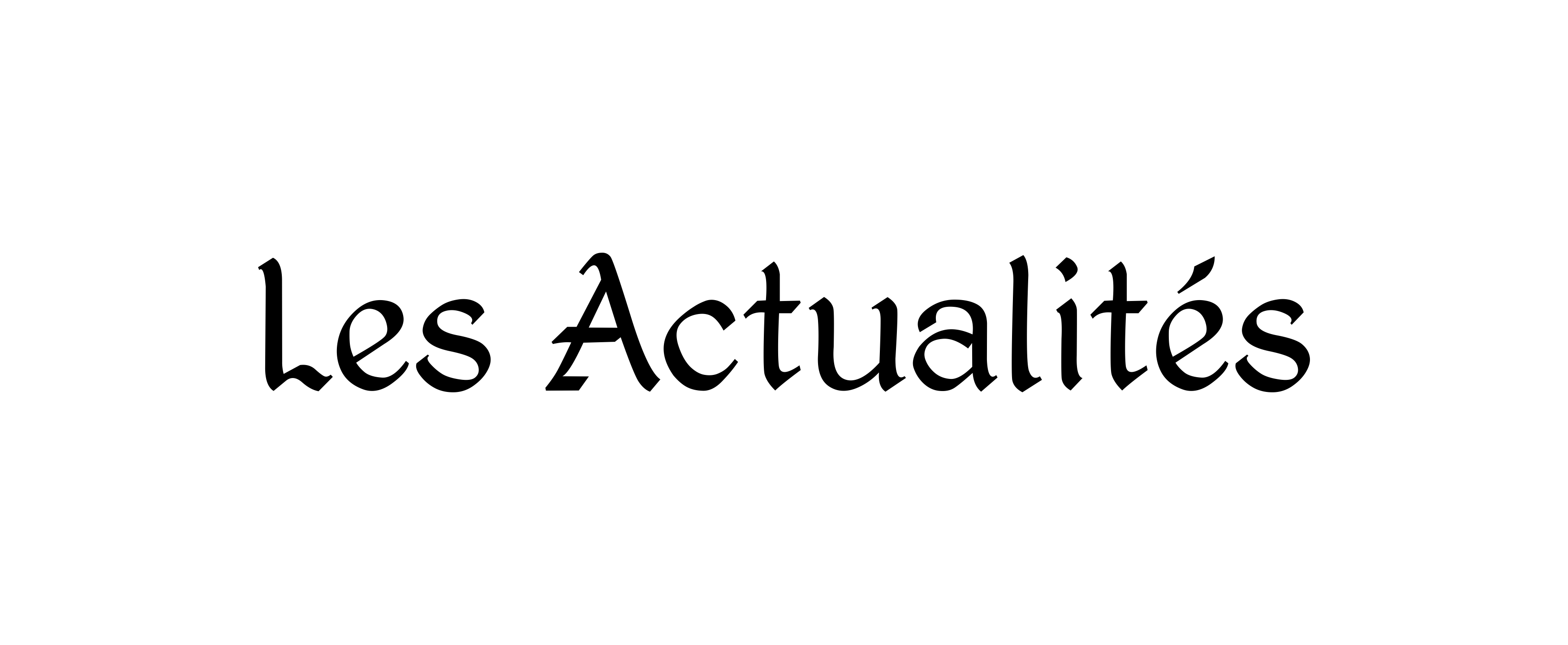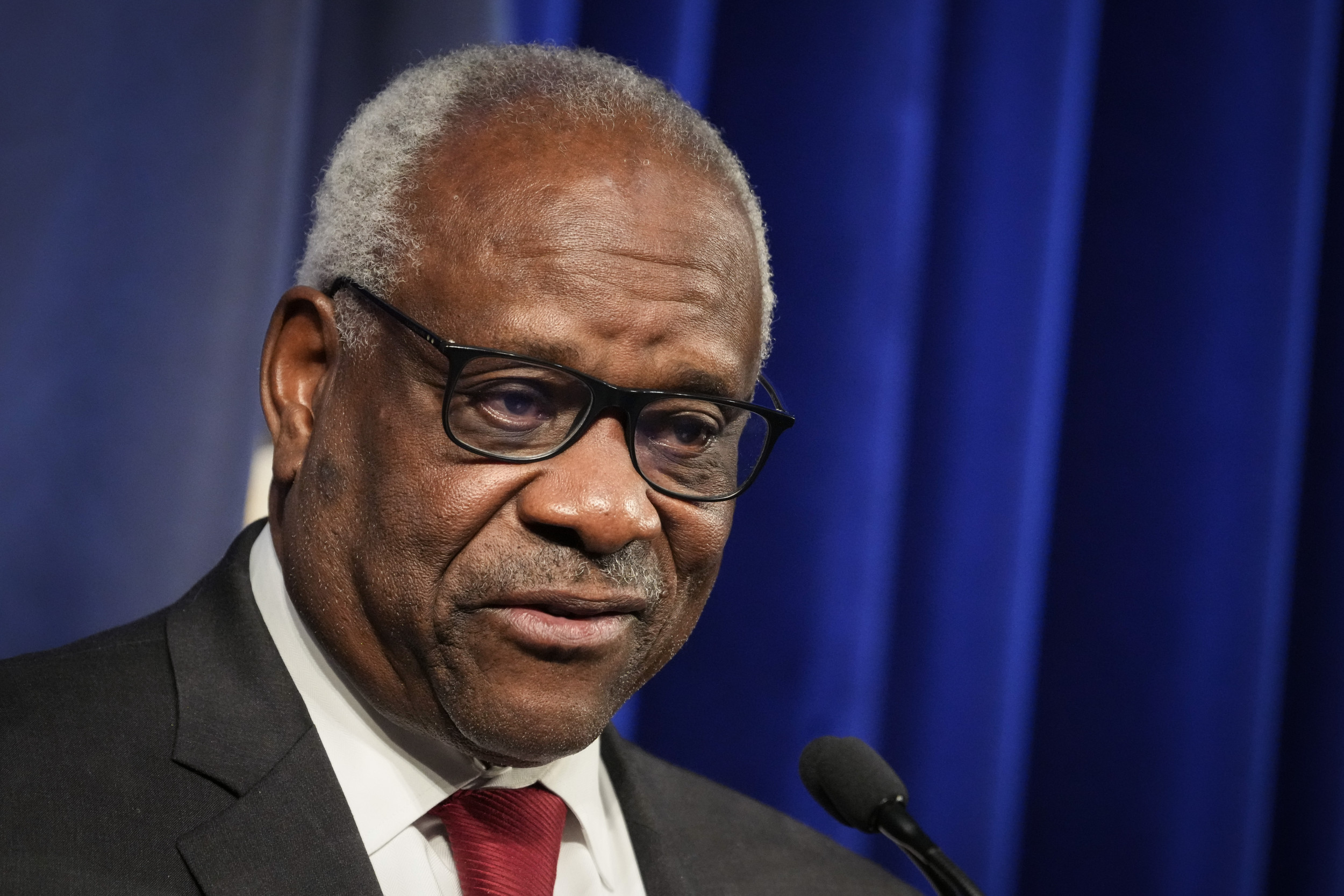Si les États-Unis avaient attrapé et tué Oussama ben Laden en décembre 2001, la présence militaire américaine en Afghanistan aurait disparu presque immédiatement après. Je ne peux pas le prouver. Ce n’est qu’une opinion de mon point de vue en tant qu’un des rédacteurs de discours du président George W. Bush en 2001 et 2002.
Pourtant j’y crois fermement. Les États-Unis sont restés 20 ans en Afghanistan parce que Bush d’abord, puis ses successeurs se sont retrouvés piégés dans un schéma de réponse aux échecs passés en redoublant d’efforts futurs. À l’automne 2001, la mission américaine en Afghanistan était claire, limitée et réalisable : trouver et tuer Ben Laden. Après l’évasion de Ben Laden, cette mission a dégénéré en quelque chose de flou et d’incroyablement difficile : reconstruire la société afghane et remodeler l’État afghan.
Si les forces américaines avaient réussi contre Ben Laden en 2001, la justice aurait été rendue de la manière que les Américains aiment : rapide, dure et bon marché. Les républicains auraient pu faire campagne aux élections de 2002 en tant que vainqueurs d’une guerre terminée et se tourner ensuite vers les préoccupations nationales. Rappelez-vous, si George W. Bush a appris une seule leçon de la présidence de son père, c’est que même le succès militaire le plus écrasant ne se traduit pas par une réélection. En novembre 1992, Bush aîné a remporté 37 % des voix contre un candidat démocrate qui s’était opposé à la triomphale guerre du Golfe.
La survie de Ben Laden condamnait toute idée de retour aux préoccupations intérieures. Sans un meurtre ou une capture de Ben Laden à montrer, le renversement rapide du gouvernement taliban semblait vraiment un lot de consolation.
La route ouverte à la guerre en Irak.
Encore une fois, ce n’est que l’opinion d’un homme, mais je ne crois pas que Bush était encore engagé dans une guerre terrestre contre Saddam Hussein lorsqu’il a prononcé son discours sur l’« Axe du mal » en janvier 2002. Ce discours a identifié le potentiel d’armement de l’Irak comme un danger mortel menace pour la sécurité. Il disait la même chose du potentiel d’armement de l’Iran et de la Corée du Nord, et Bush n’avait aucune intention de combattre l’un ou l’autre. Il y avait et il y a de nombreuses façons d’aborder le potentiel des armes à moins d’une guerre terrestre, qu’il s’agisse de sanctions, de sabotage ou de frappes aériennes.
Pourtant, dans l’année qui a suivi ce discours, la décision de la guerre s’est concrétisée. Il fallait faire quelque chose contre le terrorisme islamique qui n’était pas l’Afghanistan ; la guerre en Irak est devenue ce quelque chose. Une étrange dichotomie a divisé l’élite de la politique étrangère américaine. Des personnalités de l’administration Bush—le vice-président Cheney, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld—ont souhaité ardemment échapper Afghanistan. Ce souhait était en partie dû à leur détermination à en finir avec Saddam Hussein, mais c’était aussi une préférence politique à part entière. (Pour le peu que cela vaut, c’est ce que j’ai personnellement ressenti à l’époque : quelle que soit la probabilité d’un avenir stable pour l’Irak, ce pays urbanisé et alphabétisé était un terrain plus prometteur pour les objectifs stratégiques des États-Unis que l’Afghanistan désespéré.)
La logique qui a poussé Bush vers l’Irak a fonctionné à l’envers pour pousser ses adversaires démocrates de plus en plus profondément en Afghanistan. Je doute que John Kerry ou Barack Obama aient choisi indépendamment une guerre terrestre en Afghanistan comme une entreprise de politique étrangère solide. Mais après avoir présenté l’Irak comme la mauvaise guerre au mauvais endroit contre le mauvais ennemi, ils se sont soutenus pour identifier l’Afghanistan comme la bonne guerre au bon endroit contre le bon ennemi.
C’est devenu la doctrine du Parti démocrate d’exiger de plus en plus pour l’Afghanistan. Ainsi, la plate-forme démocrate de 2004 a exhorté : « Nous devons étendre les forces de l’OTAN en dehors de Kaboul. Nous devons accélérer la formation de l’armée et de la police afghanes. Le programme de désarmement et de réintégration des milices de seigneurs de guerre dans la société doit être accéléré et étendu à une stratégie générale. Nous attaquerons l’explosion du commerce de l’opium ignorée par l’administration Bush en doublant notre aide en matière de lutte contre les stupéfiants au gouvernement Karzaï et en redynamisant le programme régional de contrôle des drogues.
George Packer: la trahison des Afghans par Biden vivra dans l’infamie
Les alliés américains sceptiques en Irak se sont également de plus en plus engagés en Afghanistan. En janvier 2002, ils ont promis un montant relativement modeste de 4,5 milliards de dollars sur cinq ans pour la reconstruction afghane, un peu moins d’un milliard de dollars par an. En 2004, ils avaient doublé ce taux de dépenses annuelles pour atteindre 7 milliards de dollars sur trois ans.
Barack Obama avait été encore plus contre la guerre en Irak que John Kerry ne l’avait été – et donc la logique du « faire quelque chose » l’a poussé à être encore plus en faveur de la guerre en Afghanistan que Kerry ne l’avait été. En février 2009, le président Obama a approuvé l’envoi de 17 000 soldats américains supplémentaires en Afghanistan. Il en a commandé 30 000 de plus en décembre. Près de 65 000 militaires américains étaient déployés dans le pays à la fin de son premier mandat.
Que devaient faire ces troupes en Afghanistan? C’est devenu de plus en plus difficile à dire. Le partenaire le plus important de l’Amérique en Afghanistan était voisin du Pakistan. Sans une certaine coopération du Pakistan, les opérations militaires à l’intérieur de l’Afghanistan ne pourraient pas être maintenues. Pourtant, dans le même temps, le Pakistan était aussi l’ennemi le plus meurtrier et le plus implacable de l’effort américain en Afghanistan – le patron ultime des talibans contre lesquels les États-Unis se battaient. Lorsque Ben Laden a finalement été tué, il a été tué au Pakistan, où quelqu’un le cachait depuis de nombreuses années.
Elliott Ackerman : l’Amérique devra compter avec son cynisme à propos de l’Afghanistan
En 2001, la mort de Ben Laden aurait mis fin à la guerre. En 2011, il n’a rien conclu.
Comme le président Obama, le président Trump a commencé son administration en déployant plus de troupes en Afghanistan. À la fin de son premier mandat, Trump cherchait une sortie à presque n’importe quel prix. Le prix qu’il a payé a été un accord avec les talibans : le retrait définitif des États-Unis d’Afghanistan après les élections de 2020 en échange d’un engagement des talibans à ne pas infliger de pertes américaines avant les élections de 2020. Trump a recueilli son avantage politique – sa vantardise d’au moins mettre fin à la « guerre sans fin » – tout en léguant un vilain dilemme à son successeur : renier l’accord Trump et relancer une guerre de tir ? Ou s’en tenir à l’accord Trump, accepter l’effondrement du gouvernement de Kaboul et subir de féroces abus pro-Trump pour avoir poursuivi la propre politique de Trump ?
Ce qui s’en vient ensuite en Afghanistan sera sombre et horrible. Ce que les États-Unis peuvent atténuer, ils devraient l’atténuer, notamment en aidant ceux qui ont aidé les forces américaines et la communauté internationale. Mais dans le calcul froid du pouvoir de l’État, l’impact sur les États-Unis sera probablement bien inférieur à ce que beaucoup prévoient maintenant avec inquiétude. Les États-Unis ont écrasé la puissance militaire d’abord d’Al-Qaïda, puis de l’État islamique. Les sondages d’opinion suggèrent que l’extrémisme islamique diminue au Moyen-Orient arabe et en Afrique du Nord. Ben Laden s’est installé en Afghanistan comme refuge pour lutter pour le contrôle de l’État saoudien. Mais l’importance stratégique du Moyen-Orient devrait également bientôt s’atténuer. La consommation mondiale de pétrole atteindra probablement un pic au cours de cette décennie, puis diminuera. Les États-Unis et d’autres pays développés se dirigent particulièrement rapidement vers un avenir post-pétrolier. Même dans la mesure où ils continuent à brûler du pétrole, ce pétrole proviendra de beaucoup plus de sources que par le passé. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole depuis près d’une décennie maintenant. La vision de Ben Laden de l’Afghanistan comme lieu de lancement d’un califat mondial semble encore plus étrange aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a 20 ans.
Au lieu de cela, sortir d’Afghanistan libère les États-Unis pour qu’ils affrontent plus directement le défi sécuritaire présenté par le soutien de l’État pakistanais au djihadisme régional et mondial. Depuis le 11 septembre, les États-Unis ont développé de nouvelles façons de frapper les ennemis terroristes tout en mettant moins de leurs propres militaires en danger. Les États-Unis peuvent exiger des représailles très sévères contre les nouveaux dirigeants de l’Afghanistan s’ils décident de retourner à l’entreprise d’héberger des djihadistes anti-américains.
Lire : Pourquoi est-il important qu’Oussama ben Laden ait déjà été arrêté pour excès de vitesse
La leçon la plus importante à tirer du résultat en Afghanistan est peut-être le coût stratégique élevé de la féroce polarisation partisane de l’Amérique. Les décisions prises en Afghanistan par les républicains et les démocrates ont été motivées beaucoup plus par la concurrence politique intérieure que par les réalités à l’intérieur de l’Afghanistan. George W. Bush ne pouvait pas se permettre de quitter l’Afghanistan alors qu’il aurait dû, au début de 2002. John Kerry et Barack Obama ont été contraints de faire des promesses excessives à propos de l’Afghanistan malgré leurs propres craintes. Donald Trump a antidaté une débâcle parce qu’il voulait une victoire apparemment bon marché pour 2020.
Pendant la guerre froide, les États-Unis ont trouvé des méthodes de gestion de la politique étrangère qui s’élevaient au-dessus des partis. Depuis 1990, les États-Unis ont moins bien réussi cette tâche non partisane essentielle, et au 21e siècle, encore pire que cela.
Nous nous dirigeons sûrement vers un autre cycle vicieux de partisanerie en matière de politique étrangère après la chute de Kaboul. Pendant cinq ans, les voix pro-Trump ont défendu le protectionnisme, l’isolationnisme et la trahison d’alliés tels que l’Estonie, le Monténégro et les Kurdes syriens. Trump lui-même considérait la politique étrangère américaine comme plus ou moins un racket de protection, avec des paiements dus par les futurs partenaires américains à la fois au Trésor américain et à ses propres entreprises. Maintenant, ces partisans d’une « Amérique seule » prédatrice vont essayer de se reconvertir en défenseurs de la force et du leadership des États-Unis.
Au cours des prochaines semaines, les critiques pro-Trump de Biden étonneront le monde par leur impudence, alors qu’ils passent des attaques sur des guerres sans fin aux lamentations pour le dernier hélicoptère de Saigon. Cette impudeur s’avérera plus efficace qu’elle ne le mérite, mais moins efficace qu’elle n’en a besoin. Les vies courageuses perdues en Afghanistan, l’argent gaspillé là-bas : ceux-ci hanteront longtemps la société américaine. Mais les nouvelles possibilités ouvertes pour les États-Unis, la liberté d’action retrouvée, les futurs déchets désormais évités, ce seront aussi des réalités. Les atouts matériels, économiques, financiers et moraux qui font la force de l’Amérique, les États-Unis les possèdent toujours. Le dysfonctionnement politique intérieur qui conduit à la politique plutôt qu’à la politique – cela, et non l’iconographie des hélicoptères de Kaboul – c’est la faiblesse à surmonter maintenant.
.