“Les humains se situent à mi-chemin entre les particules subatomiques et l’univers observable.” La Voie Lactée.
Shutterstock/nednapa
On prétend parfois que, en mesurant par ordres de grandeur, les humains se situent à mi-chemin entre les particules subatomiques et l’univers observable. (Ou, pour le dire autrement, que nous sommes à mi-chemin entre rien et tout.) Que cette affirmation soit strictement vraie ou non, elle est saisissante et résonne de toutes sortes de manières. Chacune de nos vies peut ressembler à un univers entier – extrêmement important et d’une portée infinie – et pourtant, d’un autre point de vue, chacune est totalement insignifiante et éphémère. C’est un paradoxe impossible que cet état d’avoir à la fois un surplus et une redondance de valeur, et cela apporte certaines opportunités créatives et morales. Je m’intéresse à la manière dont ces opportunités pourraient être explorées dans la fiction, à la façon dont l’échelle peut défamiliariser la vie humaine, et même toute vie, nous rappelant la nature infinitésimale de son étendue, ainsi que l’improbabilité et l’émerveillement de son existence.
Dans chacun de mes romans, et surtout À l’Ascension, J’ai placé des perspectives spatiales et temporelles non intuitives à côté des préoccupations les plus banales de mes personnages. Les télescopes et les microscopes reviennent, tout comme le temps profond, l’évolution et les cycles de vie des parasites et des virus. Parallèlement, les personnages mangent, se promènent entre les pièces, réfléchissent anxieusement à des pensées circulaires, s’inquiètent pour leur famille ou s’ennuient. L’objectif effectue un zoom avant et arrière, des scènes « domestiques » aux scènes « extraterrestres ». Je ne fais pas cela pour me moquer ou rabaisser mes personnages, mais plutôt pour essayer d’évoquer quelque chose de cette qualité paradoxale dans laquelle nous sommes à la fois infinis et infinitésimaux, également proches de quelque chose de très grand et de très petit.
J’ai toujours été attiré par la fiction qui tente cela. Lorsque des scènes aux perspectives très différentes se heurtent, l’effet peut être surprenant, exaltant, inoubliable. Mon exemple préféré est celui du roman de Virginia Woolf de 1927. Au Phare, que j’ai lu pour la première fois quand j’étais adolescente. Dans les 134 pages de sa première partie, « The Window », Woolf nous livre, à travers le personnage de Mme Ramsay, une conscience si lumineuse qu’elle semble impossible à définir ou à limiter. Dans la partie suivante, « Time Passes », la perspective subit un changement radical. La maison est vide, les gens sont partis depuis longtemps ; Mme Ramsay, nous sommes informés par deux courtes lignes entre parenthèses, comme après coup, que c’est mort.
Je n’oublierai jamais le choc et le frisson de la première lecture de ceci. Je n’avais pas réalisé que la fiction pouvait faire ça ; L’audace et l’ambition de Woolf lui ont coupé le souffle. Elle avait montré tragiquement la puissance et la précarité de chaque conscience. C’est un truisme qu’on ne répétera jamais assez : la vie semble infinie et elle disparaît en une seconde. Une grande partie de la fiction de Woolf s’intéresse à cette dissonance, et ce n’est pas une coïncidence si, en plus d’avoir vécu les deux guerres mondiales, elle a vécu des avancées radicales en matière de puissance télescopique qui ont changé toute compréhension de la taille de l’univers. Et il ne faut pas s’étonner – même si c’est toujours le cas pour beaucoup de gens – que Woolf n’était pas seulement une fervente lectrice de livres d’astronomie et de science-fiction, mais qu’elle se voyait engagée tout au long de sa vie dans un projet d’écriture comparable aux œuvres les plus ambitieuses de SF.
Le protagoniste de À l’Ascension, Leigh Hasenbosch, est une microbiologiste qui voyage dans l’espace lointain. Elle éprouve non seulement de l’étonnement en voyant la Terre entière, mais aussi du découragement en voyant la planète disparaître. L’anthropocentrisme – sans aucun doute la perspective par défaut dans la fiction en langue anglaise – n’a jamais semblé aussi absurde. En approchant du nuage d’Oort, elle est consciente des autres ordres de vie qui l’entourent, des réserves de nourriture d’algues aux colonies de bactéries voyageant entre elle et l’autre équipage. Au-delà des parois composites du navire, il n’y a rien.
Depuis l’enfance, après une révélation au bord de la noyade, Leigh poursuit les origines de la vie, absorbé par la théorie de la symbiogenèse et frappé par son improbabilité. Il est pratiquement impossible que la vie existe, et pourtant elle est là. En même temps, elle interroge sa propre enfance et les influences formatrices sur la personne qu’elle est devenue. Sa vie et son œuvre se rassemblent autour de cette quête ambiguë des origines. Quelle échelle est alors « correcte » ? Dans quelle histoire s’investit-elle vraiment – l’universelle ou la personnelle ? Bien entendu, la réponse est les deux – aucune des deux réponses ne peut suffire à elle seule.
Martin MacInnes À l’Ascension, publié par Atlantic Books, est le dernier choix du New Scientist Book Club. Inscrivez-vous et lisez avec nous ici
Les sujets:
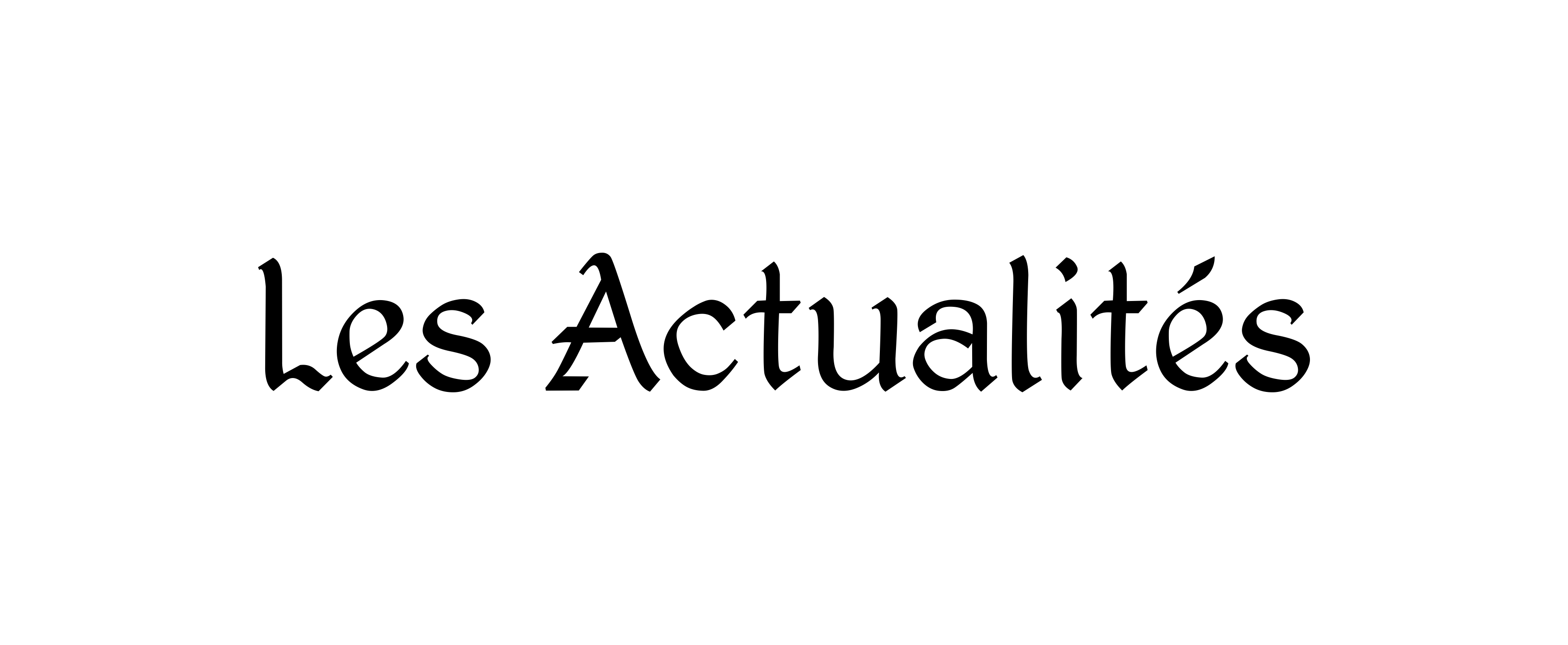









:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LXL2SD2UCCB5BQ4NGTVGLSH5GM.jpg)

