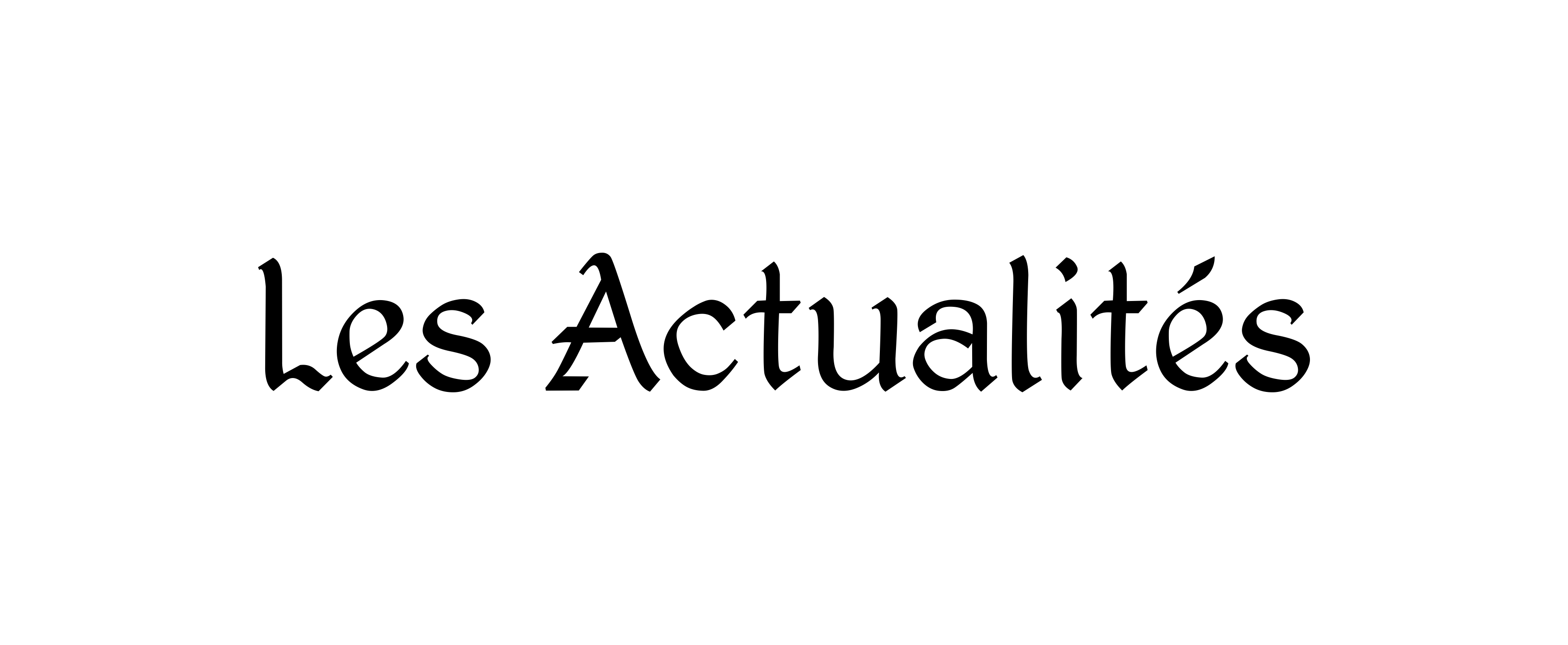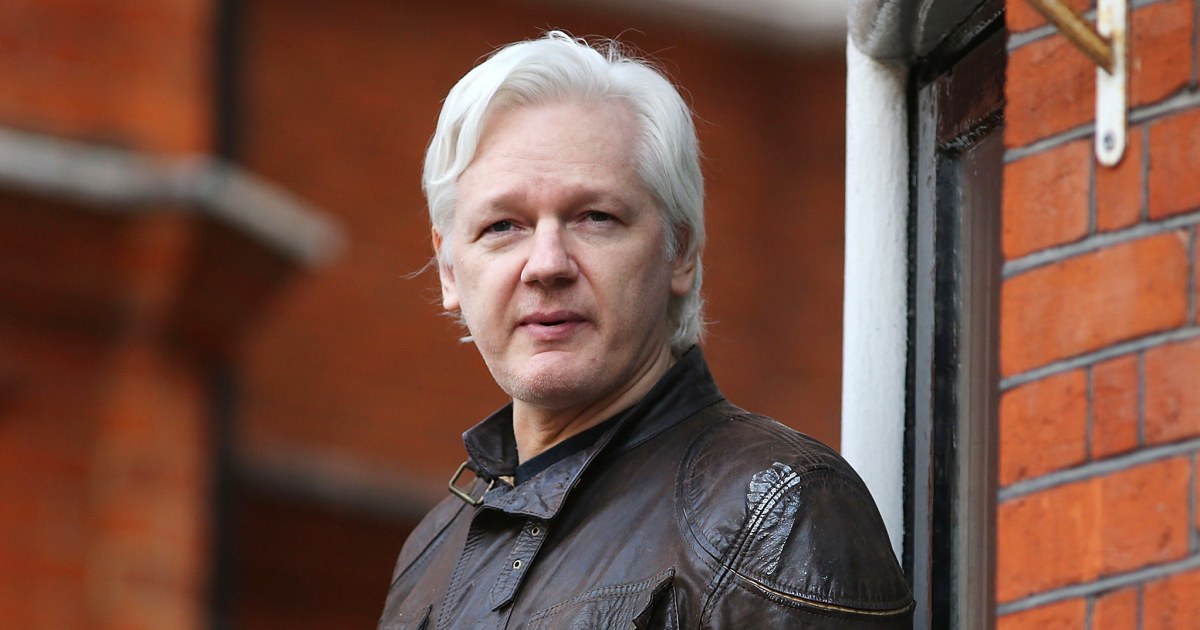Il y a un paradoxe dans notre capacité d’attention. Lorsque nous sommes hyper concentrés sur notre environnement, nos sens deviennent plus conscients des signaux qu’ils captent. Mais parfois, lorsque nous sommes attentifs, nous manquons des choses dans notre champ sensoriel qui sont si flagrantes qu’à un second regard, nous ne pouvons pas nous empêcher de remettre en question la légitimité de notre perception.
En 1999, le psychologue Daniel Simons a créé un scénario astucieux qui illustre de manière poignante ce phénomène. (Testez-le vous-même en moins de deux minutes en regardant la vidéo de Simons icique nous recommandons avant le spoiler ci-dessous.)
Dans le scénario, il y a deux équipes, chacune composée de trois joueurs, avec une équipe habillée en noir et l’autre en blanc. Le spectateur est invité à compter le nombre de passes effectuées par l’équipe en blanc tout au long de la vidéo. Effectivement, à la fin de la vidéo, la plupart des gens sont capables de deviner avec précision le nombre de passes. Alors le narrateur demande : Mais avez-vous vu le gorille ?
Il s’avère que quelqu’un en costume de gorille entre lentement dans la scène, à la vue de tous. La plupart des gens qui regardent la vidéo pour la première fois et se concentrent sur le comptage des passes négligent complètement le primate déplacé. Cela semble étrange, compte tenu de l’observation attentive du spectateur du petit champ de vision où se déroule la scène.
Traitement prédictif
Le neuroscientifique Anil Seth offre une explication intéressante de ce phénomène dans son livre Être toi: Une nouvelle science de la conscience. La description de Seth s’inspire de l’une des principales théories des neurosciences sur la cognition et la perception.
Traitement prédictif, également connu sous le nom de codage prédictif, suggère que le contenu de nos expériences et perceptions du monde est principalement basé sur des modèles prédictifs que notre cerveau a construits à travers nos expériences précédentes. Nos cerveaux, enfermés à l’intérieur d’un crâne, ont la tâche peu enviable d’essayer de déterminer les causes de nos signaux sensoriels. En utilisant des modèles prédictifs pour déterminer notre perception, notre cerveau est capable d’aller au-delà des données de nos sens pour former, ce que nous ressentons, des expériences concrètes de phénomènes dans le monde.
Dans un sens, notre cerveau essaie constamment de résoudre ce que les philosophes appellent un problème d’inférence inverse, où nous n’avons pas un accès direct aux causes de nos signaux sensoriels. Nos signaux sensoriels sont les effets de phénomènes dans le monde qui ne reflètent pas nécessairement la nature des causes qui les ont produits. Et avec ces données limitées, notre cerveau comble les lacunes manquantes en produisant des modèles qui prédisent leurs causes.
Dans ce cadre de traitement prédictif, nos perceptions sont phénomènes descendants, et sont la « meilleure estimation » du cerveau de ce qui se passe en dehors de nous et en nous. Cela contraste avec un modèle de perception ascendant, où nos sens nous informeraient principalement de ce que nous percevons, nos perceptions étant une lecture non filtrée de ces données (ce que nous voyons, entendons, sentons, etc.).
Mais dans le traitement prédictif, nos sens jouent toujours un rôle important dans notre perception globale, car nos prédictions, dites «antérieurs,” et modèles génératifs du monde sont constamment croisés avec ce que nos sens nous disent. Ces références croisées conduisent inévitablement à des erreurs de prédiction, car nos modèles ne correspondent pas toujours parfaitement à ce que nos sens nous disent. Ces erreurs jouent alors un rôle vital en aidant le cerveau à mettre à jour ses prédictions, en lui donnant plus de données parmi lesquelles choisir pour le prochain scénario dans lequel il se trouve.
Dans Être toi, Seth décrit comment les modèles génératifs sont la banque de contenus perceptibles du cerveau. Pour qu’une personne puisse percevoir quelque chose comme une équipe de personnes passant un ballon, cette personne aura besoin d’un modèle génératif qui intègre les signaux sensoriels que nous nous attendrions à rencontrer si nous rencontrions une équipe de personnes passant un ballon ; des mouvements rapides, des corps qui tourbillonnent et peut-être des odeurs liées à l’exercice.
Nos modèles génératifs permettent à notre cerveau de faire des suppositions éclairées sur ce qui existe dans le monde, et nos signaux sensoriels entrants sont comparés à ces prédictions en temps réel pour former des erreurs de prédiction, qui mettent ensuite à jour nos modèles génératifs dans un effort continu pour minimiser les erreurs de prédiction. .
Hiérarchie perceptive
Les hiérarchies perceptives sont une autre composante de ces processus de déploiement. Nos prédictions du monde se produisent à divers degrés d’échelle qui peuvent impliquer des objets et des entités à part entière comme les chats et les voitures, mais nous prédisons également les caractéristiques qui composent ces entités, comme la fourrure et les roues.
Une prédiction de haut niveau, comme voir une équipe de personnes passer un ballon, se répercute en cascade sur des prédictions de niveau inférieur, comme le type de vêtements qu’ils portent, le type de mouvements qu’ils font et les différents sons qui les accompagnent. Celles-ci descendent jusqu’à des prédictions de niveau encore plus bas sur la forme de la balle, la lumière rebondissant sur le sol et le mouvement de ces corps dans l’espace.
Bien que nos cerveaux n’aient pas accès aux causes directes de nos signaux sensoriels, ils ne savent pas non plus à quel point ces signaux sensoriels sont fiables. Et donc un aspect clé pour comprendre pourquoi nous manquons souvent des choses lorsque nous sommes attentifs s’appelle la pondération de précision. Cela fait référence à la mesure dans laquelle nos signaux sensoriels affectent notre perception.
Si quelqu’un tourne la tête et aperçoit une équipe en train de passer un ballon, alors ces signaux sensoriels visuels auront une faible fiabilité et n’influenceront pas notre perception autant que si nous nous arrêtions et regardions l’équipe. Le simple fait de jeter un coup d’œil à quelque chose aura pour effet de sous-pondérer la précision estimée de ces signaux sensoriels et aura donc moins d’influence sur notre meilleure estimation perceptive.
La surpondération correspond au moment où nos signaux sensoriels ont été jugés particulièrement fiables et auront une plus grande influence sur notre perception. Bien que cela puisse être difficile à comprendre, augmenter la précision estimée de vos signaux sensoriels revient simplement à “faire attention”.
Regarder prêter attention de cette manière donne alors un sens à la raison pour laquelle nous manquons parfois des choses dans notre champ sensoriel. Si nous augmentons l’influence que certains spécifique les données sensorielles auront sur notre meilleure estimation perceptive, alors les données qui ne sont pas au centre de notre attention auront peu ou pas d’effet sur nos meilleures estimations perceptives. Ainsi, bien que l’attention soit utile pour se concentrer sur des signaux sensoriels spécifiques, elle peut également nous empêcher d’obtenir une image perceptive plus complète de ce qui se déroule autour de nous.