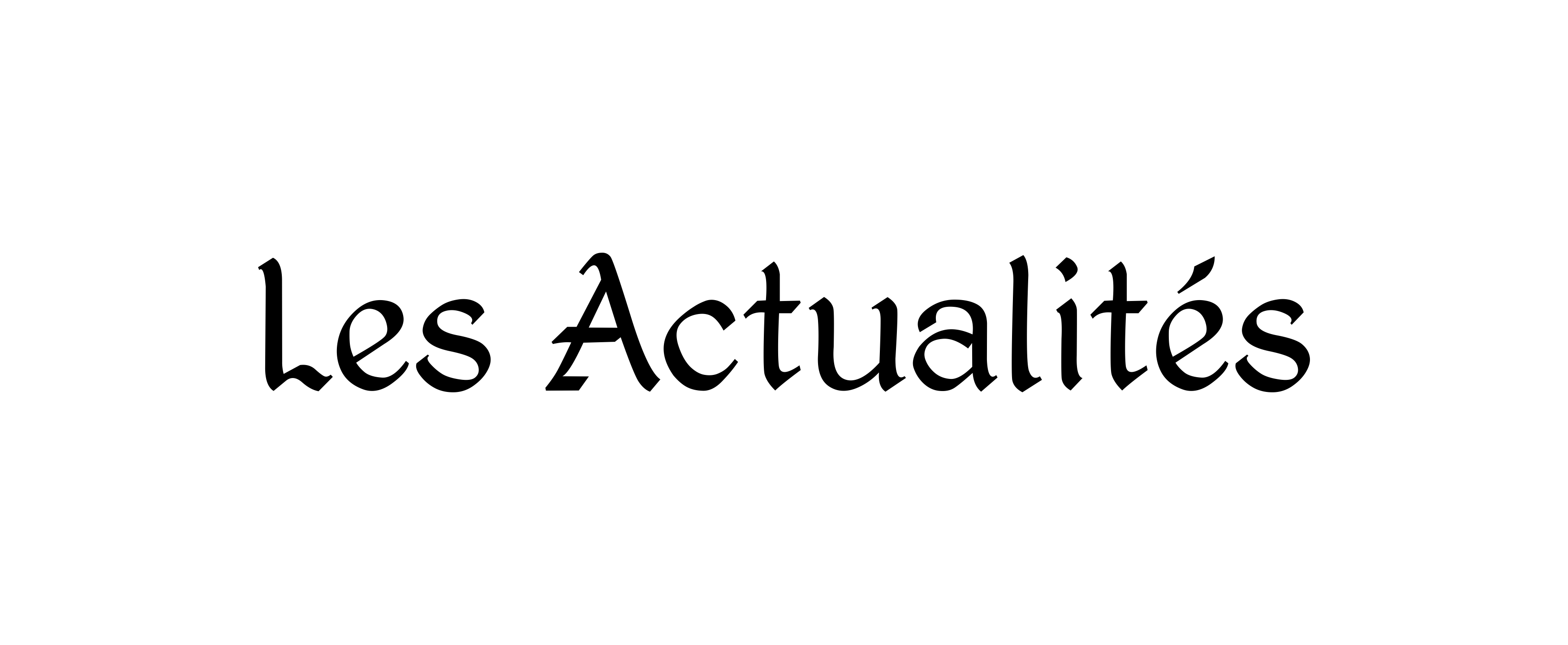Tout comme les actes de naissance indiquent l’heure à laquelle nous entrons dans le monde, les actes de décès marquent le moment où nous en sortons. Cette pratique reflète les notions traditionnelles sur la vie et la mort comme binaires. Nous sommes là jusqu’à ce que, soudainement, comme une lumière éteinte, nous disparaissions.
Mais même si cette idée de la mort est omniprésente, il est de plus en plus évident qu’il s’agit d’une construction sociale dépassée, peu ancrée dans la biologie. Mourir est en fait un processus sans aucun point clair délimitant le seuil à partir duquel quelqu’un ne peut pas revenir.
Les scientifiques et de nombreux médecins ont déjà adopté cette compréhension plus nuancée de la mort. À mesure que la société rattrape son retard, les implications pour les vivants pourraient être profondes. « Il est possible que de nombreuses personnes soient réanimées à nouveau », déclare Sam Parnia, directeur de la recherche en soins intensifs et en réanimation à NYU Langone Health.
Les neuroscientifiques, par exemple, découvrent que le cerveau peut survivre à des niveaux surprenants de privation d’oxygène. Cela signifie que le délai dont disposent les médecins pour inverser le processus de décès pourrait un jour être prolongé. D’autres organes semblent également pouvoir être récupérés bien plus longtemps que ne le laisse penser la pratique médicale actuelle, ce qui ouvre la voie à une augmentation de la disponibilité des dons d’organes.
Mais pour ce faire, nous devons reconsidérer la façon dont nous concevons et abordons la vie et la mort. Plutôt que de considérer la mort comme un événement dont on ne peut pas se remettre, dit Parnia, nous devrions plutôt la considérer comme un processus transitoire de privation d’oxygène qui a le potentiel de devenir irréversible si suffisamment de temps s’écoule ou si les interventions médicales échouent. Si nous adoptons cet état d’esprit à l’égard de la mort, dit Parnia, « alors tout d’un coup, tout le monde dira : « Traitons-la ».
Déplacer les poteaux de but
Les définitions juridiques et biologiques de la mort font généralement référence à la « cessation irréversible » des processus essentiels à la vie soutenus par le cœur, les poumons et le cerveau. Le cœur est le point de défaillance le plus courant et, pendant la grande majorité de l’histoire de l’humanité, lorsqu’il s’est arrêté, il n’y a généralement pas eu de retour.
Cela a changé vers 1960, avec l’invention de la RCR. Jusque-là, la reprise d’un rythme cardiaque arrêté était largement considérée comme une affaire de miracles ; désormais, c’était à la portée de la médecine moderne. La RCR a obligé à repenser pour la première fois la mort en tant que concept. Le terme « arrêt cardiaque » est entré dans le lexique, créant une séparation sémantique claire entre la perte temporaire de la fonction cardiaque et l’arrêt définitif de la vie.
À peu près à la même époque, l’avènement des ventilateurs mécaniques à pression positive, qui fonctionnent en fournissant des respirations d’air aux poumons, a commencé à permettre aux personnes ayant subi une lésion cérébrale catastrophique, par exemple d’une balle dans la tête, d’un accident vasculaire cérébral massif ou d’un accident de voiture – pour continuer à respirer. Cependant, lors des autopsies réalisées après le décès de ces patients, les chercheurs ont découvert que, dans certains cas, leur cerveau avait été si gravement endommagé que les tissus avaient commencé à se liquéfier. Dans de tels cas, les ventilateurs avaient essentiellement créé « un cadavre au cœur battant », explique Christof Koch, neuroscientifique à l’Institut Allen de Seattle.
Ces observations ont conduit au concept de mort cérébrale et ont ouvert un débat médical, éthique et juridique sur la possibilité de déclarer la mort de tels patients avant que leur cœur ne cesse de battre. De nombreux pays ont finalement adopté une forme ou une autre de cette nouvelle définition. Qu’il s’agisse de mort cérébrale ou de mort biologique, les subtilités scientifiques derrière ces processus sont loin d’être établies. “Plus nous caractérisons le cerveau mourant, plus nous nous posons des questions”, explique Charlotte Martial, neuroscientifique à l’Université de Liège en Belgique. “C’est un phénomène très, très complexe.”
Les cerveaux au bord du gouffre
Traditionnellement, les médecins pensaient que le cerveau commençait à subir des dommages quelques minutes après avoir été privé d’oxygène. Bien que ce soit une idée reçue, dit Jimo Borjigin, neuroscientifique à l’Université du Michigan, « il faut se demander pourquoi notre cerveau serait-il construit de manière si fragile ? »
Des recherches récentes suggèrent que ce n’est peut-être pas le cas. En 2019, des scientifiques ont rapporté dans Nature qu’ils étaient capables de restaurer une suite de fonctions dans le cerveau de 32 porcs décapités dans un abattoir quatre heures plus tôt. Les chercheurs ont relancé la circulation et l’activité cellulaire dans le cerveau en utilisant un sang artificiel riche en oxygène infusé d’un cocktail de produits pharmaceutiques protecteurs. Ils comprenaient également des médicaments qui empêchaient les neurones de fonctionner, empêchant ainsi toute chance que le cerveau des porcs reprenne conscience. Ils ont gardé les cerveaux en vie jusqu’à 36 heures avant de mettre fin à l’expérience. “Nos travaux montrent que le manque d’oxygène cause probablement beaucoup plus de dommages réversibles qu’on ne le pensait auparavant”, déclare le co-auteur Stephen Latham, bioéthicien à l’Université de Yale.
En 2022, Latham et ses collègues ont publié un deuxième article dans Nature annonçant qu’ils avaient réussi à récupérer de nombreuses fonctions dans plusieurs organes, y compris le cerveau et le cœur, chez des porcs entiers tués une heure plus tôt. Ils ont poursuivi l’expérience pendant six heures et ont confirmé que les animaux anesthésiés et morts avaient repris la circulation et que de nombreuses fonctions cellulaires clés étaient actives.
« Ce que ces études ont montré, c’est que la frontière entre la vie et la mort n’est pas aussi claire qu’on le pensait autrefois », explique Nenad Sestan, neuroscientifique à la Yale School of Medicine et auteur principal des deux études sur les porcs. La mort « prend plus de temps que nous le pensions, et au moins certains processus peuvent être arrêtés et inversés ».
Une poignée d’études chez l’homme ont également suggéré que le cerveau est plus efficace que nous le pensions pour gérer le manque d’oxygène après que le cœur s’arrête de battre. “Lorsque le cerveau est privé de l’oxygène vital, dans certains cas, il semble y avoir cette surtension électrique paradoxale”, explique Koch. “Pour des raisons que nous ne comprenons pas, il est hyperactif pendant au moins quelques minutes.”
Dans une étude publiée en septembre dans Resuscitation, Parnia et ses collègues ont collecté des données sur l’oxygène cérébral et l’activité électrique de 85 patients ayant subi un arrêt cardiaque alors qu’ils étaient à l’hôpital. L’activité cérébrale de la plupart des patients s’est initialement stabilisée sur les moniteurs EEG, mais pour environ 40 % d’entre eux, elle était proche de la normale. l’activité électrique est réapparue par intermittence dans leur cerveau jusqu’à 60 minutes après le début de la RCR.
De même, dans une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences en mai, Borjigin et ses collègues ont rapporté poussées d’activité dans le cerveau de deux patients dans le coma après le retrait de leurs ventilateurs. Les signatures EEG se sont produites juste avant la mort des patients et présentaient toutes les caractéristiques d’une conscience, dit Bojigin. Même si de nombreuses questions demeurent, de telles découvertes soulèvent des questions alléchantes sur le processus de mort et les mécanismes de la conscience.
La vie après la mort
Plus les scientifiques en apprendront sur les mécanismes à l’origine du processus de mort, plus grandes seront les chances de développer « des efforts de sauvetage plus systématiques », dit Borjigin. Dans le meilleur des cas, ajoute-t-elle, cette ligne d’étude pourrait avoir « le potentiel de réécrire les pratiques médicales et de sauver beaucoup de gens ».
Bien entendu, tout le monde finira par mourir et sera un jour irrécupérable. Mais une compréhension plus précise du processus de la mort pourrait permettre aux médecins de sauver des personnes auparavant en bonne santé, qui connaissent une fin précoce inattendue et dont les corps sont encore relativement intacts. Les exemples pourraient inclure des personnes qui souffrent d’une crise cardiaque, succombent à une perte de sang mortelle, ou s’étouffent ou se noient. Le fait que beaucoup de ces personnes meurent et restent mortes reflète simplement « un manque d’allocation appropriée de ressources, de connaissances médicales ou de progrès suffisants pour les ramener à la vie », explique Parnia.
L’espoir de Borjigin est de comprendre un jour le processus de la mort « seconde par seconde ». De telles découvertes pourraient non seulement contribuer aux progrès de la médecine, dit-elle, mais aussi « réviser et révolutionner notre compréhension du fonctionnement cérébral ».
Sestan dit que lui et ses collègues travaillent également sur des études de suivi visant à « perfectionner la technologie » qu’ils ont utilisée pour restaurer la fonction métabolique dans le cerveau des porcs et d’autres organes. Cette ligne de recherche pourrait éventuellement conduire à des technologies capables d’inverser les dommages – jusqu’à un certain point, bien sûr – dus au manque d’oxygène dans le cerveau et d’autres organes chez les personnes dont le cœur s’est arrêté. En cas de succès, la méthode pourrait également élargir le bassin de donneurs d’organes disponibles, ajoute Sestan, en allongeant le délai dont disposent les médecins pour prélever des organes sur des personnes décédées définitivement.
Si ces avancées se produisent, souligne Sestan, elles nécessiteront des années de recherche. « Il est important de ne pas exagérer ni de trop promettre », dit-il, « même si cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de vision ».
Entre-temps, les enquêtes en cours sur le processus de la mort continueront sans aucun doute à remettre en question nos notions de la mort, entraînant ainsi des changements radicaux au sein de la science et d’autres domaines de la société, du théologique au juridique. Comme le dit Parnia : « Les neurosciences ne sont pas propriétaires de la mort. Nous y avons tous un intérêt.
Rachel Nuwer est une journaliste scientifique indépendante qui contribue régulièrement au New York Times, au Scientific American, à Nature et plus encore. Son dernier livre est I Feel Love: MDMA and the Quest for Connection in a Fractured World. Elle vit à Brooklyn.