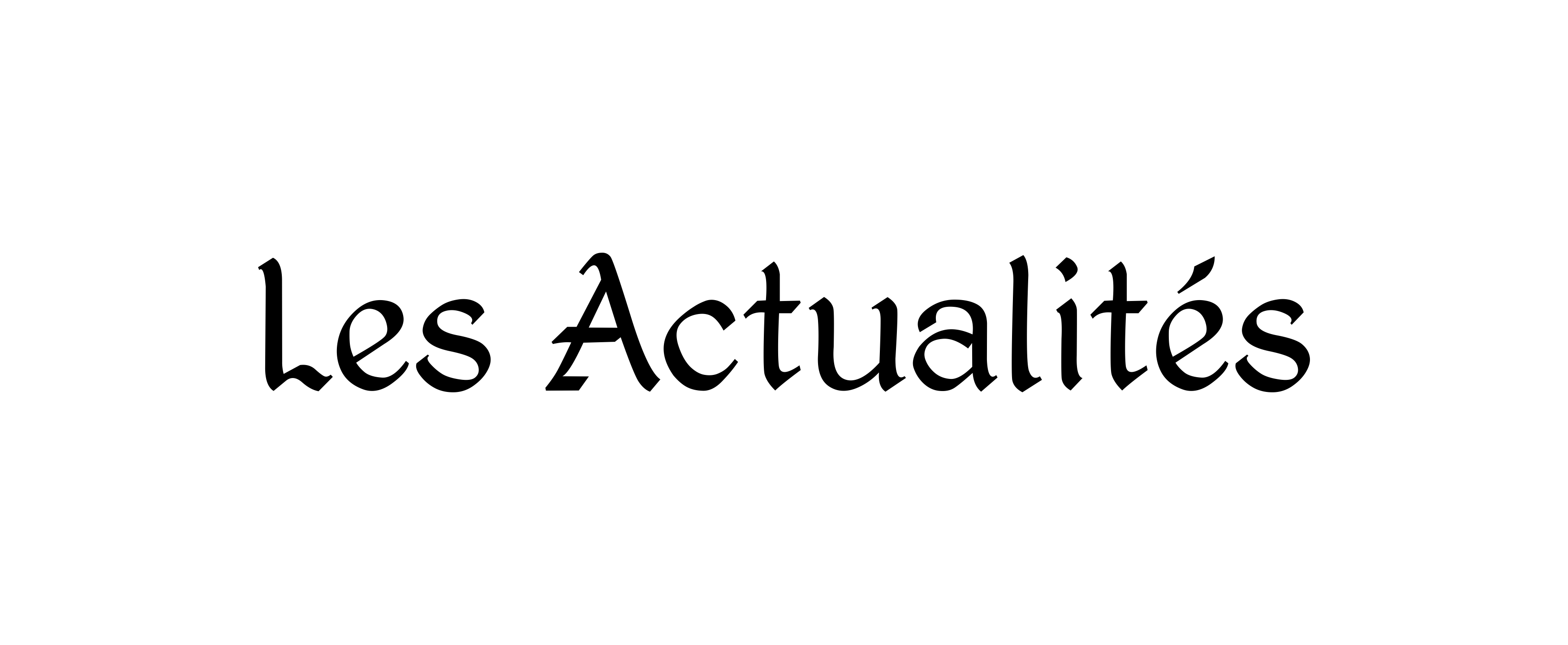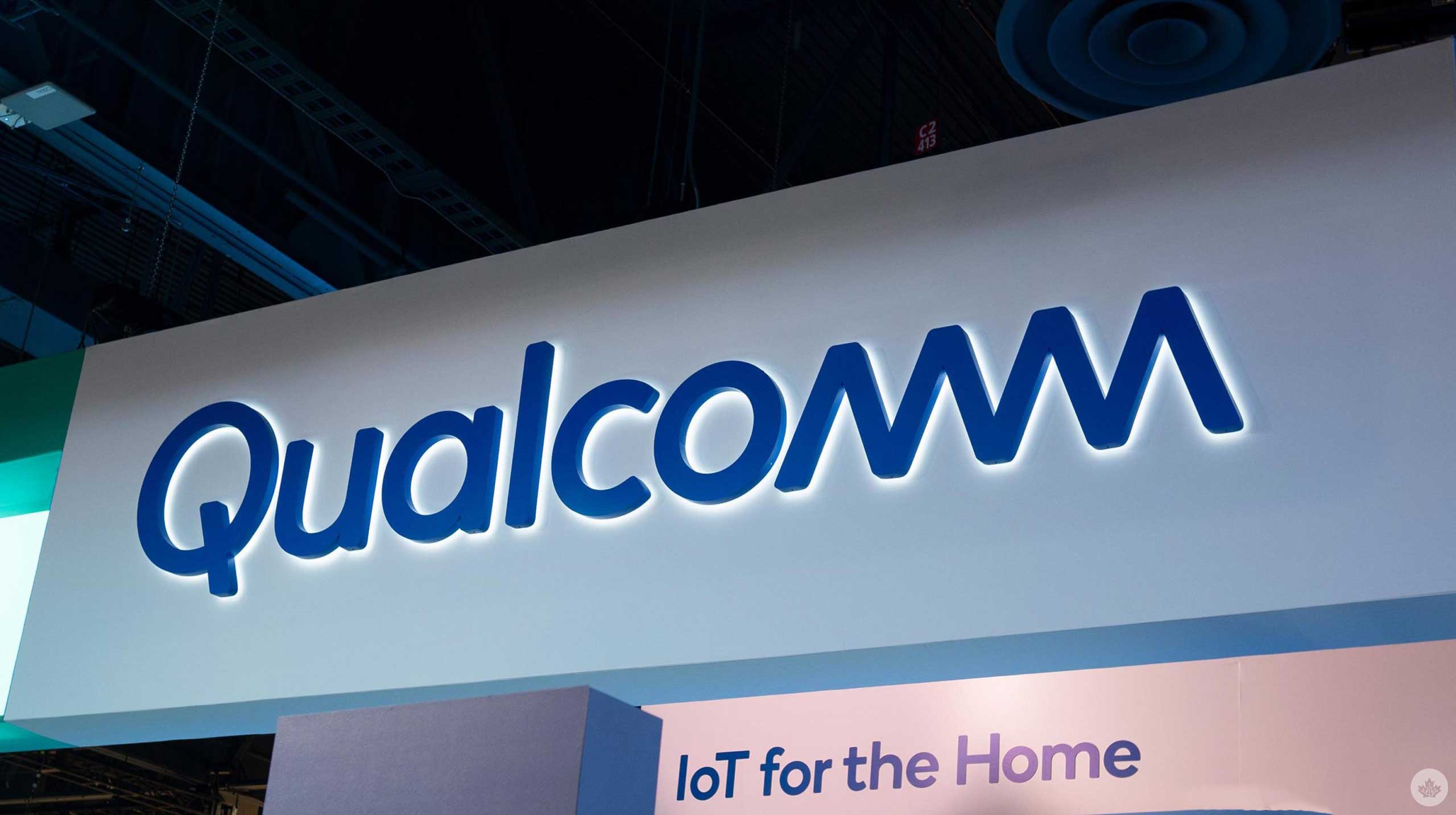Des quantités massives de
données et d’innombrables
analyses recueillies au cours de décennies de recherches universitaires démontrent sans équivoque que les préjugés et les inégalités fondés sur la race (en d’autres termes,
racisme) ont
s’est produit et se produit encore dans toute la société aux États-Unis (la même chose peut être dite pour de nombreux autres pays). L’enseignement supérieur américain est l’un des endroits où le racisme a été, et est toujours, bien documenté
encore et
encore et
encore. Comme on pouvait s’y attendre, six des neuf juges de la Cour suprême des États-Unis ont récemment choisi de ne pas tenir compte de ces faits
et argumenter pour une approche « neutre en matière de race » dans les admissions à l’université.
Je dis “pas de manière inattendue” parce que les six juges en question ont démontré à plusieurs reprises des engagements et des croyances idéologiques spécifiques qui les prédisposent à rejeter le soutien riche en données de l’existence d’un racisme systémique. Mais ce qui est profondément vexant, c’est que cette même approche idéologique consistant à nier des preuves aussi massives est également présente parmi un groupe non négligeable de scientifiques. Le mépris intentionnel des données facilement accessibles et des analyses bien étayées n’est pas quelque chose auquel on devrait s’attendre de la part de ceux qui pratiquent la science.
Certains scientifiques proposent que le racisme systémique lui-même n’est pas une menace centrale pour la science, mais que ce sont plutôt les tentatives de l’académie, des organisations scientifiques et des revues d’atténuer les impacts du racisme et de développer des structures antiracistes qui posent problème. De telles affirmations apparaissent dans
des articles,
éditoriauxet
essais académiques et faire entendre l’argument selon lequel la quête pour remédier au racisme dans la science est problématique et que la qualité et l’avenir des efforts scientifiques en souffrent.
Il ne fait aucun doute que les données sur le racisme systémique en science sont solides. Par exemple, on peut facilement trouver de la documentation et des analyses récentes sur l’occurrence, les modèles et les impacts des préjugés systémiques dans
écologie et biologie évolutive,
sciences de la conservation,
Sciences de la Terre,
paléontologie,
santé publique,
génétique humaine,
chimie,
la physique, et bien d’autres disciplines. Il existe un biais systémique dans
cours d’introduction aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM)en représentation dans le
littérature scientifique plus largeen financement par le
Instituts nationaux de la santé et le
Fondation nationale de la scienceet parmi ceux qui
travailler dans les domaines STEM. Les National Academies des États-Unis ont récemment publié un
rapport sur la promotion de la lutte contre le racisme, la diversité, l’équité et l’inclusion dans les organisations STEM et la revue
Nature a publié un numéro spécial sur
le racisme en science. La situation est si claire et bien documentée que le biologiste Joseph Graves Jr. et ses collègues ont récemment affirmé dans la revue
PNAS, “L’histoire de l’entreprise scientifique démontre qu’elle a soutenu l’inégalité entre les sexes, l’identité et la race. De plus, ses institutions ont permis la discrimination, le harcèlement et les atteintes personnelles aux personnes racialisées et aux femmes.
La nature omniprésente des données dans l’ensemble du paysage de l’entreprise scientifique devrait suggérer à tout scientifique un schéma : des préjugés et des inégalités fondés sur la race (racisme) sont présents à un niveau non négligeable dans la pratique, l’accompagnement et l’enseignement des sciences. Compte tenu des données, des techniques d’étude, de la diversité de ceux qui effectuent les analyses et du large éventail de domaines étudiés, c’est presque une impossibilité statistique que tous ces scientifiques, associations professionnelles, revues à comité de lecture et agences gouvernementales soient complètement à côté de la plaque en ce qui concerne leur évaluation des données sur le racisme dans la science.
Donc, une suggestion pour ceux qui s’opposent aux mouvements anti-racistes dans la science : que diriez-vous de faire exactement ce que les scientifiques sont censés faire ? Reconnaissez les données et les analyses existantes, collectez plus de données, exécutez de nouvelles analyses, puis voyez comment recadrer les questions et les pratiques compte tenu d’une compréhension plus fine de la dynamique des systèmes. Il existe un large éventail de praticiens scientifiques qui rassemblent leur expertise et évaluent comment les systèmes et la dynamique ont produit (et produisent) les inégalités actuelles. Il y a plusieurs
tentatives de collaboration réfléchir à la manière de modifier les systèmes actuels afin d’améliorer leurs résultats. Et, surtout, il y a un effort généralisé pour communiquer ces évaluations, ces connaissances scientifiques, au grand public afin que la société soit mieux à même de comprendre et d’expliquer pourquoi ignorer les données sur les biais systémiques et rejeter les analyses scientifiques solidement vérifiées sont nuisibles, et comment s’en défendre.
Les scientifiques qui choisissent de lutter contre les réalités du racisme basées sur les données et les tentatives de réparer ses torts soutiennent et sont facilement cooptés par des individus et des organisations réactionnaires aux États-Unis (et au-delà) qui recherchent un soutien populaire et académique dans leurs tentatives de supprimer les droits durement acquis des femmes, des personnes de couleur et des groupes marginalisés à travers de multiples paramètres sociétaux. Ce sont souvent les scientifiques qui se plaignent le plus vigoureusement de l’« annulation » et des contraintes à leur liberté de s’opposer aux interventions contre le racisme dont les affirmations sont utilisées (bien souvent sans l’assentiment de ces scientifiques) par les extrémistes pour justifier la violence au niveau national.
personnel et
institutionnel les niveaux.
Je m’attends à ce que beaucoup continuent de contester ou d’ignorer les études et les commentaires auxquels il est fait référence ici et rejettent fermement les affirmations de racisme systémique dans la science. Certains qualifieront cet essai de «réveillé» et l’utiliseront comme exemple de la façon dont le journal Science est sorti du chemin de la “vraie” science. Si être «réveillé» signifie examiner activement les données et les analyses disponibles et y répondre en tenant compte des contextes sociaux, des histoires et des processus qui les ont facilités et créés, alors être réveillé, c’est simplement faire de la bonne science du XXIe siècle – quelque chose que nous devrions tous nous efforcer de faire.