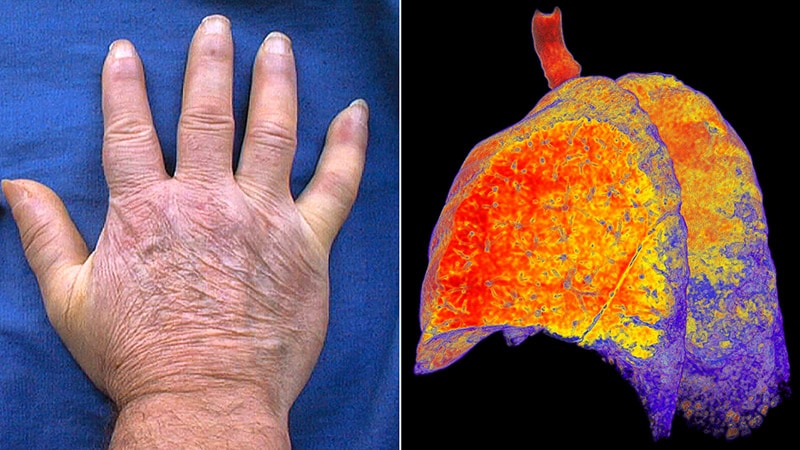Recevez des mises à jour gratuites sur la vie et les arts
Nous vous enverrons un Résumé quotidien myFT e-mail récapitulant les dernières Vie & Arts nouvelles tous les matins.
Pourquoi chaque groupe a-t-il besoin d’un kit de batterie différent ? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement partager ?
J’ai posé ces questions et d’autres similaires des dizaines de fois au fil des ans, sans jamais parvenir à une réponse satisfaisante, souvent à l’irritation visible de la personne qui m’a invité à un festival de musique. Qu’est-ce qui était essentiel à la performance à propos de cet arrangement particulier de caisse claire et de cymbale, je demande. Qu’est-ce qui justifie que nous attendions 20 minutes de basculement et de vérification du son ? A qui profite tout ce dédoublement ? Est-ce un dispositif de création d’emplois pour les roadies ? Pourquoi les musiciens professionnels ne peuvent-ils pas jouer sur un kit standard ?
Les festivals de musique testent la capacité d’une personne à vivre dans l’instant. Les psychologues l’appellent la pleine conscience dispositionnelle, la capacité d’être présent sans réserve, et c’est quelque chose pour lequel je suis très mauvais. Détendez-vous, on m’a dit plus d’une fois, mais comment puis-je me détendre ? Comment une personne peut-elle se perdre dans la musique quand elle ne sait pas combien de kits de batterie restent dans les coulisses, faisant la queue comme des camions au port de ferry de Douvres ?
Une grande partie de ce que nous choisissons de retenir à propos des festivals de musique est enracinée dans les mythes de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Les éloges de la contre-culture des jeunes ont contribué à préserver les croyances formées bien avant, pour les petits événements, sur le fait qu’il ne s’agit jamais uniquement de musique.
Ce qui importe, c’est d’être là, dans un ailleurs mystique ou traditionnel, pour ressentir le sentiment général d’identité, la communauté, l’authenticité de l’expérience.
De telles choses idéalistes n’étaient jamais faciles à concilier avec la réalité. Il devrait être difficile d’oublier, par exemple, que Woodstock ’69 était le projet de capital-risque d’un Trustafarian et de ses amis golfeurs. L’authenticité à l’époque était en grande partie un sous-produit de la mauvaise planification des organisateurs, comme elle l’a toujours été depuis.
C’est le concept d’abondance d’un acheteur Costco appliqué au plaisir, le paradoxe du choix à l’échelle géographique, et tout ce que cela m’inspire, c’est FOMO
Le sexe, la drogue, le désordre et la misère en sont les ingrédients essentiels, écrivait l’historien Michael Clarke en 1982. Son livre La politique des festivals pop mentionne à peine la musique mais décrit longuement la manière dont les « hippies du week-end » rangent leurs responsabilités et leurs inhibitions dans une atmosphère de chaos orgiaque.
La mesure dans laquelle ce stéréotype est toujours vrai est discutable. Que cela ait jamais été vrai est une affaire personnelle entre grands-parents. Ce qui est plus facile à rationaliser, c’est sa notion du début des années 1980 selon laquelle les quatre choses doivent venir ensemble. Les têtes d’affiche typiques de l’époque étaient Van Halen, Iron Maiden et The Grateful Dead. La misère et le désordre faisaient aussi partie intégrante de la scène que le sexe et la drogue ; l’incompétence organisationnelle signifiait que les parieurs n’avaient qu’à rechercher les deux derniers.
Maintenant que les hippies du week-end dans la quarantaine font la queue dans le village de restauration de rue de Snapchat pour du cola au CBD, il est tentant de prétendre que les festivals ont été entièrement cooptés par le mercantilisme. La meilleure étiquette est le professionnalisme. N’hésitant jamais à gagner de l’argent, l’industrie a choisi la désintoxication pour atteindre une quarantaine confortable. L’ordre a été imposé. La misère a été minimisée, ou du moins rendue évitable moyennant un supplément.
Mais après avoir aseptisé et monétisé tous les signaux traditionnels de l’excès, il ne restait plus qu’à créer une scène par l’excès littéral. Un Glastonbury typique accueille désormais plus de 700 numéros sur 100 scènes. C’est le concept d’abondance d’un client Costco appliqué au plaisir, le paradoxe du choix à l’échelle géographique, et tout ce que cela m’inspire, c’est Fomo.
Accrocher à chaque instant est une question de bâton ou de torsion. Dois-je accepter le sophisme du coût irrécupérable de rester en place, ou céder au soupçon que quelque chose de mieux doit se passer là où je ne suis pas ? Cette expérience est-elle la plus authentique de toutes les expériences disponibles ?
Et quand la participation est censée affirmer la vie, est-ce ma faute si je m’ennuie ? Car honnêtement, pour toutes les promesses de bacchanales intenses, il y a beaucoup d’attente pendant que les roadies s’échangent des kits de batterie.
Les hippies qui sont restés pour regarder Jimi Hendrix jouer “Star Spangled Banner” au lever du soleil un lundi matin ont d’abord dû souffrir à travers les reprises de Duke of Earl et Blue Moon par la troupe de danse Sha Na Na. Ils n’avaient pas le choix, et c’est peut-être le point. L’excès divers d’un festival moderne, avec sa programmation agitée et son perpétuel Fomo, dilue chaque moment individuel en les présentant tous comme transcendants. Peut-être que nous n’avons plus la tolérance de nous ennuyer sincèrement, authentiquement.
Bryce Elder est le rédacteur en chef du FT, Alphaville. Janan Ganesh est absent
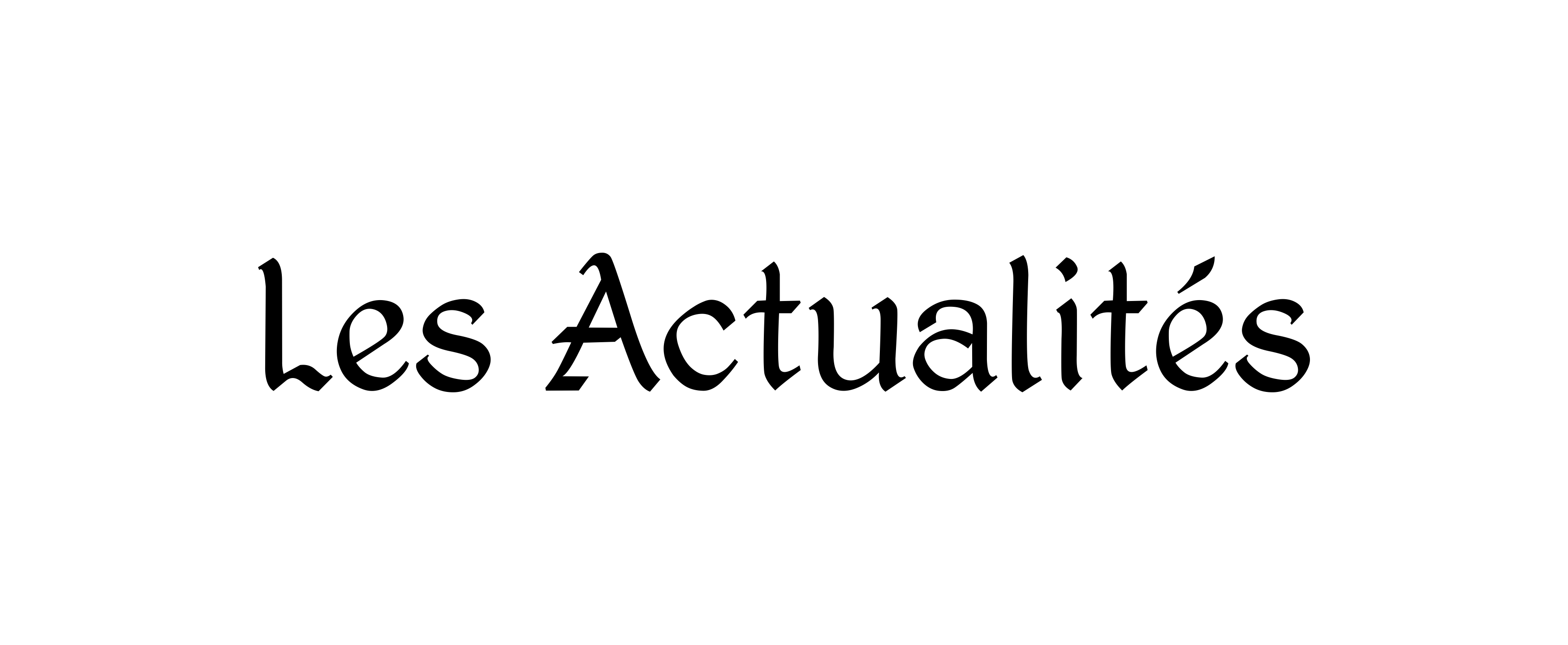

:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/EHW3AWTQ6BGT7IL5BBN4ZXIPHA.jpg)