Soleil & Mer
L’Albany, Deptford, Londres
Une plage de sable par une journée ensoleillée. C’est un spectacle familier à beaucoup d’entre nous – si évocateur et si désiré pendant les mois d’hiver. Et la première chose qui te frappe Soleil & Merl’opéra-drame-installation lituanien d’une beauté intense de Lina Lapelytė, Vaiva Grainytė et Rugilė Barzdžiukaitė, qui joue actuellement dans le cadre du London International Festival of Theatre, est sa précision détaillée.
L’ensemble de l’espace de jeu de l’Albany dans le sud de Londres est recouvert de sable ; le public, encerclant l’action dans la galerie à l’étage, regarde comme des mouettes les êtres humains éparpillés sur les serviettes de plage. Il y a un couple de personnes âgées à la recherche de lunettes de lecture, un petit enfant qui construit des châteaux de sable, deux adolescents qui tentent de jouer au badminton, un couple riche avec des chaises longues haut de gamme, un gars avec un chignon qui fait le poirier pour se montrer à sa petite amie.
Les gens discutent, somnolent, jouent aux cartes, font semblant de lire, se promènent sur la plage à la recherche de collations. La mise en scène de Barzdžiukaitė bouge et se déplace avec cette langueur somnolente qui descend sur une plage, quand simplement enfiler ses chaussures pour aller chercher une glace ressemble à une tâche herculéenne.
Tout cela est si reconnaissable, si innocent – si évocateur des vacances de l’enfance. Et encore. Il y a quelque chose d’indiciblement triste dans cette scène. Vous commencez à remarquer des détails révélateurs : le magazine nature, l’exemplaire de Dune, les dinosaures jouets. Pendant ce temps, les chansons semblent suinter des bains de soleil allongés. La partition électronique de Lapelytė est simple mais obsédante ; Les paroles de Grainytė nous parlent de mauvais rêves, d’un conjoint qui s’est noyé, de surmenage et d’incapacité à s’éteindre, de déchets sur la plage, d’hivers anormalement chauds, du voyage d’une banane, de corail blanchi.
Et autour de ces solos se gonflent des numéros choraux, magnifiques, rêveurs et méditatifs, sur la nature changeante du ciel et de la mer. Ils viennent par vagues, inondant les spectateurs comme des vagues, remplissant l’espace d’harmonie. C’est une pièce sur le changement climatique, mais c’est loin d’être didactique : sa puissance réside dans sa douceur discrète et sa tristesse cumulative. Une femme riche chante d’emmener son fils voir tous les océans du monde ; les enfants colorient des poissons tropicaux dans un livre – de quel monde héritent ces enfants ?
Le paradoxe sous-tend la pièce : notre appréciation de la beauté du monde va de pair avec notre destruction de celui-ci. Le tout, qui tourne en boucle avec chaque cycle d’une heure, ressemble à une élégie pour un mode de vie, une mémoire préservée. L’inertie et l’ordinaire font partie du point, tout comme le point de vue divin des spectateurs : nous pourrions nous regarder, saisir ces moments au soleil alors que le monde tourne en spirale vers sa fin. Superbe.
★★★★★
Au 10 juillet, liftfestival.com
Akiya Henry et Bill Pullman dans ‘Mad House’ © Marc Brenner
Maison folle
Théâtre des ambassadeurs, Londres
Dans le drame, la mort imminente d’un parent s’accompagne rarement d’une flambée de bonne conduite au sein de la famille. Et il en va de même avec deux nouvelles pièces sur la scène londonienne : Maison folle et L’association.
Dans Maison folle, la dramaturge américaine Theresa Rebeck suit les traces d’Eugene O’Neill et Tracy Letts en nous donnant le dysfonctionnement familial principal à huis clos. Le parent malade ici est Daniel, mourant d’emphysème et confiné dans sa maison sale (super ensemble de Frankie Bradshaw) dans la campagne de Pennsylvanie. On se rend vite compte que Daniel, joué avec une méchanceté spectaculaire par Bill Pullman, a élevé la rage contre la mort de la lumière aux standards olympiques.
Il commence par jeter la soupe, soigneusement préparée par son fils Michael (David Harbour, excellent), à travers la cuisine et s’intensifie à partir de là: jurant, hurlant et lançant des insultes à son fils, le plus vicieusement sur sa santé mentale. “Je ne pense pas qu’il ait mal parce qu’il est si énergiquement engagé à l’infliger”, dit Michael au téléphone à sa sœur.
L’entrée d’une infirmière de soins palliatifs douce mais sans fioritures (jouée avec une dignité vigilante par Akiya Henry) marque une brève cessation des hostilités, mais bientôt la comédie noire est de retour, a grimpé encore quelques niveaux une fois le frère de Michael avide d’argent. Ned (Stephen Wight) et sa soeur monstrueusement autoritaire Pam (Sinéad Matthews) se présentent.
Il s’agit clairement d’un ménage avec plus de squelettes que de placards pour les mettre, et bien sûr dans le deuxième acte, joué sur le porche, qui est le refuge de Michael, ils sortent en tombant. C’est très bien, mais la pièce s’égare. Nous nous attendons à ce qu’il plonge plus profondément, pour que les complexités derrière l’irascibilité de Daniel s’infiltrent, pour une mise à nu qui semble à la fois vraie et terrible. Nous obtenons des observations astucieuses sur les ressentiments de l’enfance, mais d’énormes problèmes ne sont qu’effleurés et s’accompagnent d’une intrigue maladroite et mélodramatique et d’une malveillance incroyable et hors de l’échelle de Pam.
La production de Moritz von Stuelpnagel est très bonne pour livrer la comédie grimaçante mais ne peut pas concilier ces problèmes. Au lieu de cela, c’est une soirée qui se distingue par ses deux performances principales : Pullman, douloureusement et avec défi méchant ; Harbour superbe dans le rôle de Michael – un doux ours d’un homme hanté par ses propres fragilités et mal adapté à un monde difficile et captivant.
★★★☆☆
Au 4 septembre, madhousetheplay.co.uk

Cherrelle Skeete, à gauche, et Suzette Llewellyn dans ‘The Fellowship’ © Robert Day
L’association
Théâtre Hampstead, Londres
On ne voit jamais Sylvia, la mère mourante, dans son état diminué dans la nouvelle œuvre de Roy Williams L’association, mais sa présence s’infiltre dans la pièce comme une brume. Elle faisait partie de la génération Windrush : sa disparition remplit l’air de questions pour ses deux filles d’une cinquantaine d’années. Quel est son héritage ? Quel avenir pour les générations qui lui succéderont ? Qu’est-ce que cela signifie maintenant d’être noir, britannique et une femme ?
Les deux sœurs au centre de la pièce trouvent des réponses différentes : Marcia est une avocate prospère qui veut changer le système de l’intérieur ; Dawn, traumatisée par le meurtre de son fils aîné par des voyous racistes et toujours en colère contre une Grande-Bretagne qui a failli expulser sa mère lors du scandale Windrush, suggère que sa sœur n’est que tolérée. Le fils de Dawn, Jermaine (Ethan Hazzard), quant à lui, veut se forger un avenir avec sa petite amie blanche.
Lorsque Marcia prend le coup pour une infraction au code de la route commise par son amant député blanc, les choses commencent à se dégrader. Et quand Sylvia meurt, toutes les tensions refoulées des personnages se déversent. Il y a tellement de choses à dire et tellement de problèmes profondément enracinés et complexes à aborder que la pièce semble surchargée : c’est l’une de ces situations où le simple fait de représenter l’énormité de ce à quoi les gens doivent faire face devient difficile à manier dans un drame.
Mais Williams écrit avec un mélange d’humour, de fureur et de compassion. Ce qui porte vraiment la pièce, c’est la relation entre Dawn et Marcia, que Williams dessine dans toute sa profondeur riche, aimante et désordonnée et que Cherrelle Skeete et Suzette Llewellyn donnent vie de manière vivante dans la production de Paulette Randall (Skeete, qui n’a quitté la doublure que récemment , habitant entièrement la pièce). Ils se battent, s’étreignent, se cognent la poitrine comme deux gosses et dansent sans vergogne sur Culture Club et John Travolta. Alexa de Dawn est presque un autre personnage et son goût pour la musique pop blanche est un sujet constant de taquineries – mais aussi une sortie joyeuse.
★★★☆☆
Au 23 juillet, hampsteadtheatre.com
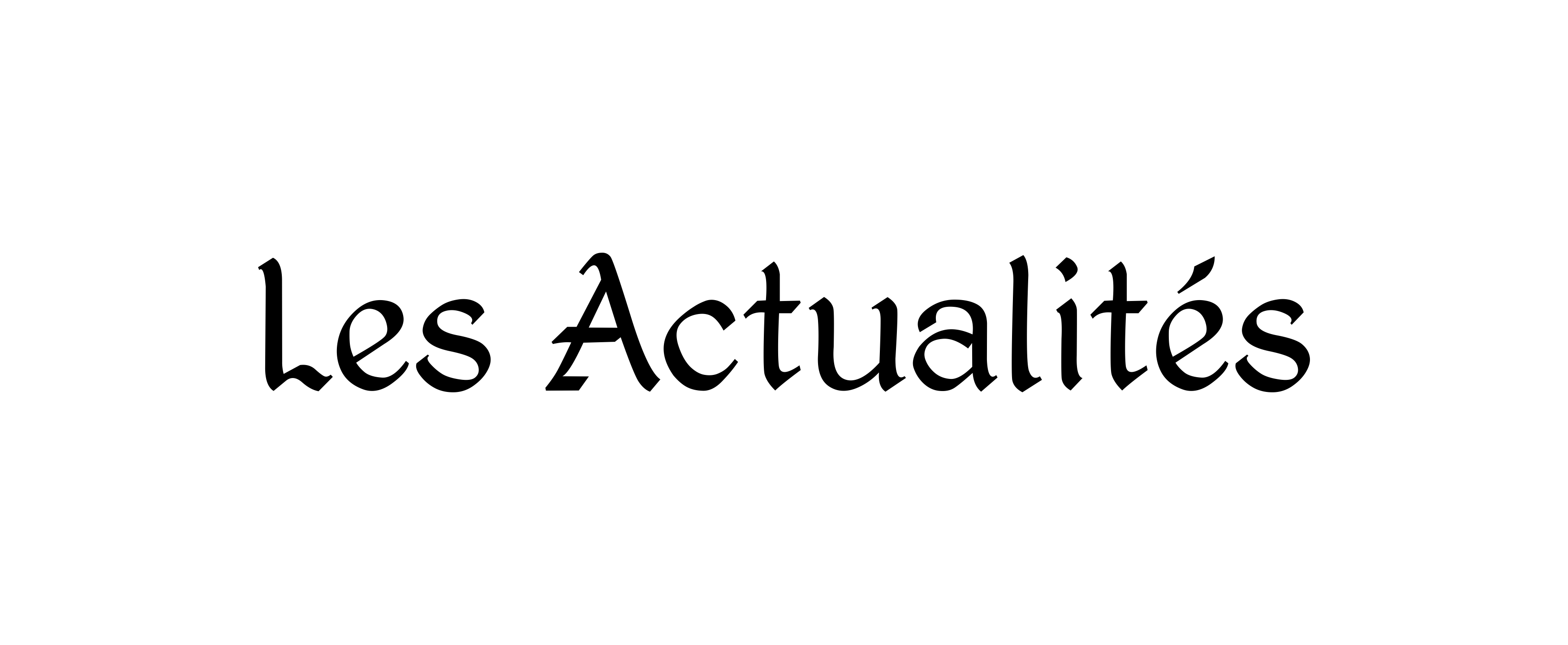






:quality(85):upscale()/2024/05/07/759/n/1922729/f383a052663a61402e51e6.32462157_.jpg)

