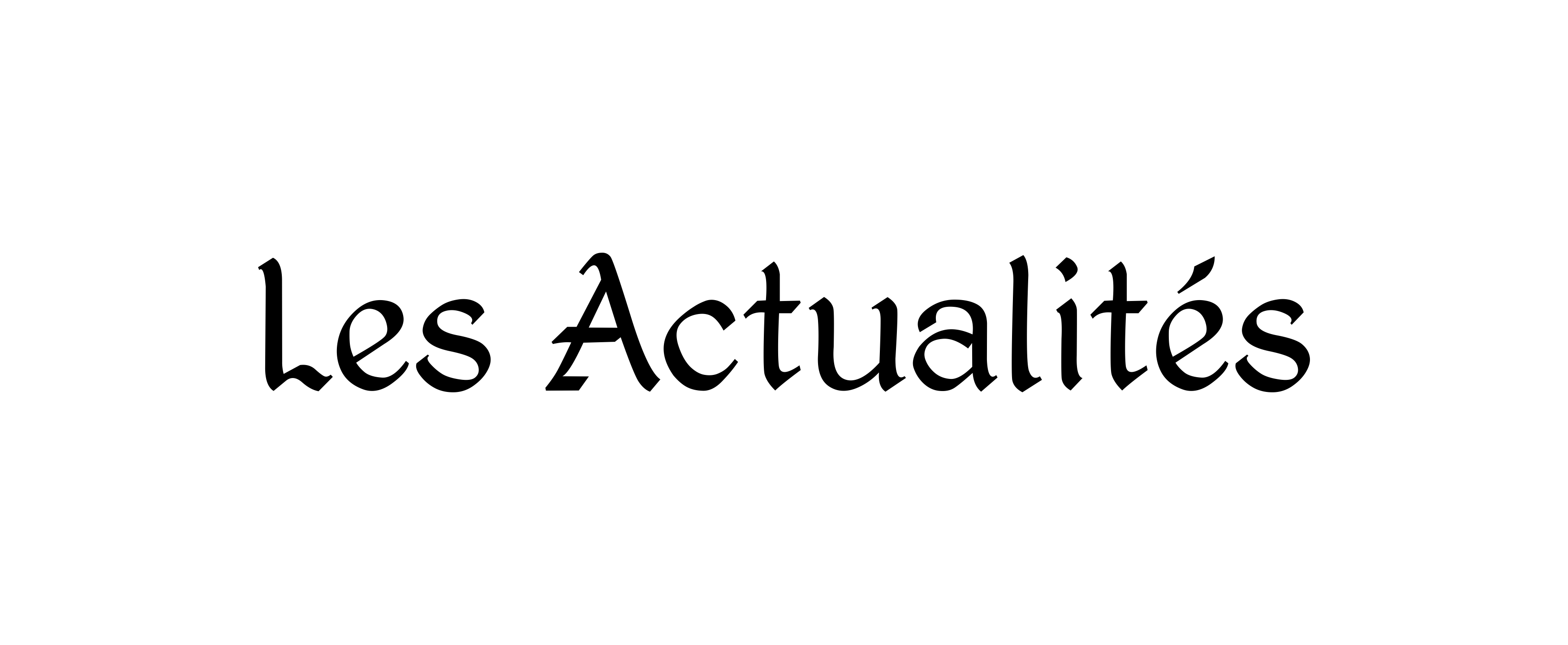Emmanuel Kant, l’un des plus grands philosophes des Lumières, est né il y a 300 ans. Profondément religieux, Kant « ne croyait pas à la théologie rationnelle ». Dans la « Critique de la raison pure », le philosophe réfute la preuve ontologique de Dieu. Pourquoi le « sapere aude ! » de Kant ? est toujours d’actualité aujourd’hui et pourtant ne constitue pas une déclaration de guerre contre la foi, explique le professeur de philosophie Michael Hampe.
Annalena Müller
« L’Éveil est l’émergence de l’homme de l’immaturité qu’il s’est lui-même infligée. » Que signifie réellement cette phrase la plus célèbre d’Emmanuel Kant ?
Michael Hampe* : Pour parvenir à la connaissance, il ne suffit pas de rechercher les vérités ; il faut travailler dur et faire preuve de courage. Un travail acharné car cela prend beaucoup de temps et est fatiguant de comprendre quelque chose ; Courage, car ce que vous découvrirez ne vous conviendra peut-être pas. Lorsque les gens sont paresseux et anxieux, ils préfèrent compter sur les autres pour réfléchir. Cette dépendance à l’égard des autres est la voie vers l’immaturité, car vous devenez alors dépendant des idées des autres. Et la culpabilité de cette immaturité vient du fait de ne pas avoir surmonté sa propre paresse ou son anxiété, alors même qu’on aurait pu les surmonter.
« Les Lumières sont la sortie de l’immaturité auto-infligée », écrivait Emmanuel Kant en 1783.
« Sapere Aude ! Ayez le courage d’utiliser votre propre compréhension ! » continue la phrase. Cet appel peut-il aussi être compris comme une déclaration de guerre contre la souveraineté interprétative des Églises ?
Hampe : Je ne sais pas si Emmanuel Kant a produit des déclarations de guerre. Le texte « Qu’est-ce que les Lumières » va plus loin en comparant les rôles que les gens jouent d’office avec ce qu’ils disent publiquement en dehors de leurs bureaux. Bien entendu, l’une des fonctions les plus importantes à l’époque de Kant était le pastorat. Mais les officiers et les professeurs d’école sont également obligés, par leur devoir officiel, d’être fidèles à leur « maître », qui à cette époque était généralement un prince. En tant qu’agent public, vous n’avez pas le droit de critiquer le roi ou l’Église. Kant est d’accord avec cela.
“Au XVIIIe siècle, il n’existait aucune notion de publicité et de liberté d’expression.”
Mais il a également noté que le rôle du fonctionnaire prend fin lorsque la personne quitte ses fonctions officielles et entre aux yeux du public. Kant souligne qu’il existe une personne publique qui n’est pas un fonctionnaire. Et dans ce rôle, vous avez la permission, voire l’obligation, d’utiliser votre propre raison et de suspendre votre loyauté envers votre employeur…
… Selon cette compréhension, le professeur Michael Hampe n’est pas autorisé à critiquer l’ETH dans les médias, mais le particulier Hampe est…
Hampe : Exactement. Et cette différenciation et cet appel au courage individuel étaient quelque chose qui, à l’époque de Kant, exigeait le courage lui-même. Au XVIIIe siècle, il n’existait aucune notion de sphère publique dans laquelle la libre expression d’opinion était autorisée. Les laïcs et même les dirigeants de l’Église étaient contrariés lorsque quelque chose qu’ils n’aimaient pas était dit publiquement pendant leur temps privé par quelqu’un qu’ils avaient employé. Vous pourriez alors avoir des ennuis. Supporter cela demandait du courage, à l’époque comme aujourd’hui.
À l’époque comme aujourd’hui, la critique publique des princes laïcs et ecclésiastiques exigeait du courage, explique Michael Hampe.

La « Critique de la raison pure » d’Emmanuel Kant est considérée comme l’un de ses écrits les plus importants. En bref : de quoi s’agit-il ?
Hampe : (rires) En bref, il s’agit de l’impossibilité d’appliquer des arguments qui fonctionnent en mathématiques à des objets non mathématiques…
…ça pourrait être un peu plus long…
Hampe : Les soi-disant « métaphysiques » pensaient que des preuves menant à des connaissances mathématiques devraient également être possibles dans l’étude de sujets tels que « Dieu », « l’âme humaine », « le monde dans son ensemble ».
Pouvez-vous expliquer cela un peu plus clairement ?
Hampe : Les mathématiques concernent des objets comme les nombres. En tant qu’objets abstraits, ils ne peuvent être vécus sensuellement. On ne trébuche pas sur le chiffre trois ou π dans le salon, même si on a une ou deux pommes dans la coupe à fruits circulaire. Nous supposons que π existe d’une manière ou d’une autre parce que nous pouvons déduire mathématiquement le nombre et l’utiliser avec succès dans toutes sortes de calculs, en particulier ceux impliquant des cercles.
« On a longtemps cru que des preuves comme celles produites pour les mathématiques pouvaient également s’appliquer à Dieu. »
En théologie et en philosophie, l’idée existe depuis longtemps que de telles dérivations et preuves sur les propriétés d’objets non sensoriels devraient également être possibles pour des objets non mathématiques.
Dieu par exemple ?
Hampe : Exactement. Si Dieu est quelqu’un dont on ne peut pas avoir d’expérience sensorielle, alors la question se pose : des preuves telles que celles produites pour les mathématiques peuvent-elles également s’appliquer à Dieu. Peut-on prouver l’existence de Dieu ou sa toute-puissance ? Kant a nié cela.
Ce faisant, Kant contredit plus de 500 ans de théologie rationnelle. L’Église catholique a voulu prouver Dieu logiquement au moins depuis le « sic et non » de Pierre Abélard (1122)…
Hampe : … le « défunt » Kant ne croyait plus à la théologie rationnelle, c’est vrai. Dans la « Critique de la raison pure », il montre qu’il s’agit d’un projet impossible. Selon la théorie de Kant, il est impossible de produire des déclarations sur Dieu, l’âme et le monde dans son ensemble qui soient, d’une part, universellement valables et, d’autre part, ne se limitent pas à des expériences sensorielles spécifiques.
Pierre Abélard (†1142), à droite, en conversation avec son amante Héloisie, est considéré comme le fondateur de la théologie rationnelle.

Si vous ne pouvez pas prouver mathématiquement Dieu, cela signifie-t-il que vous ne pouvez rien savoir de Dieu ?
Hampe : Kant lui-même était un homme religieux. Il voulait dire qu’il limitait la connaissance pour faire place à la foi. Il aurait probablement simplement dit que nous ne pouvons pas faire de déclarations intersubjectivement justifiables sur Dieu et qu’il n’existe aucune science à son sujet. Que l’on puisse avoir des expériences religieuses privées que l’on associe au mot « Dieu », et même s’il faut « postuler » lui et l’immortalité dans le cadre d’une philosophie pratique, comme le dit Kant, est une autre affaire.
Pouvez-vous expliquer cela ?
Hampe : Kant n’exclut pas la possibilité qu’il existe des expériences religieuses et des besoins moraux liés à la religion. Il dit seulement qu’une telle expérience ne peut être contrôlée conceptuellement. Par exemple, ici (Hampe montre des images encadrées au-dessus de son bureau): Nous pouvons tous les deux convenir que ces cadres sont rouges.
“Nous sommes tous les deux d’accord sur le fait que ces cadres sont rouges.”

Mais si je vous dis que j’ai eu une révélation hier soir, vous pouvez le croire ou non. Il n’y a rien dans cette pièce que vous ou moi puissions physiquement désigner et qui justifierait que j’aie une révélation. Je peux confirmer l’affirmation selon laquelle les cadres sont rouges. L’affirmation selon laquelle j’ai eu une révélation ne l’est pas.
Mais cela ne veut-il pas dire que Dieu n’existe pas ?
Hampe : Non. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas fournir la preuve de l’existence de Dieu. Mais Kant ne voulait pas éliminer l’idée de Dieu, comme le fit plus tard Nietzsche. Ce n’était pas son souci.
Emmanuel Kant a reçu une éducation profondément religieuse, à savoir piétiste. Comment cela a-t-il façonné sa morale ?
Hampe : La moralité joue un grand rôle chez Kant. Pour Kant, le lien entre moralité et religion est très étroit. Le fameux impératif catégorique vient aussi de Kant. La langue vernaculaire commune connaissait une « version antérieure », si vous voulez l’appeler ainsi, dans la « Règle d’or » : « Ce que vous ne voulez pas que quelqu’un vous fasse, ne le faites à personne d’autre. »
« Agis de telle manière que la maxime de ton action puisse devenir une loi générale. »
Impératif catégorique, Emmanuel Kant
Derrière l’impératif catégorique, Kant considère également ce qui motive réellement l’action morale. Alors, agissons-nous moralement parce que nous aspirons à la réussite sociale ? Ou suivons-nous une loi morale que nous trouvons en nous en tant qu’« êtres rationnels » ?
Qu’est-ce que la morale après tout ?
Hampe : Selon Kant, la moralité est le processus de devenir rationnel dans la pratique, dans lequel on amène sa propre émotivité dans un certain accord avec ce qui est requis pour des raisons rationnelles. Selon Kant, nous agissons moralement lorsque nous agissons dans le respect de la loi morale, de l’impératif catégorique. Ce respect est un sentiment motivant. La connaissance de la structure de l’impératif catégorique, en revanche, est le résultat d’une vision rationnelle.
Cette année marque le 300e anniversaire de la naissance de Kant. Qu’est-ce qu’Emmanuel Kant a à nous dire d’autre aujourd’hui ?
Hampe : Je réfléchis beaucoup. Quiconque veut comprendre quelque chose, c’est-à-dire prétendre au savoir, doit encore aujourd’hui faire preuve de travail et de courage. Être paresseux et anxieux est dangereux à l’époque comme aujourd’hui, car les autres peuvent vous tromper. « Sapere aude » est donc toujours correct et important aujourd’hui. Et c’est peut-être particulièrement vrai à l’ère des fausses nouvelles.
*Michael Hampe (62 ans) est professeur de philosophie à l’ETH Zurich. Ses domaines de travail sont la philosophie et l’histoire des sciences empiriques, la théorie critique et la métaphysique, la science et le public, ainsi que les techniques de connaissance de soi.
© Centre catholique des médias, 21 avril 2024
Les droits sur tous les textes sont détenus par le Catholic Media Center. Toute distribution ultérieure est soumise à des frais. Le stockage dans des bases de données électroniques n’est pas autorisé.