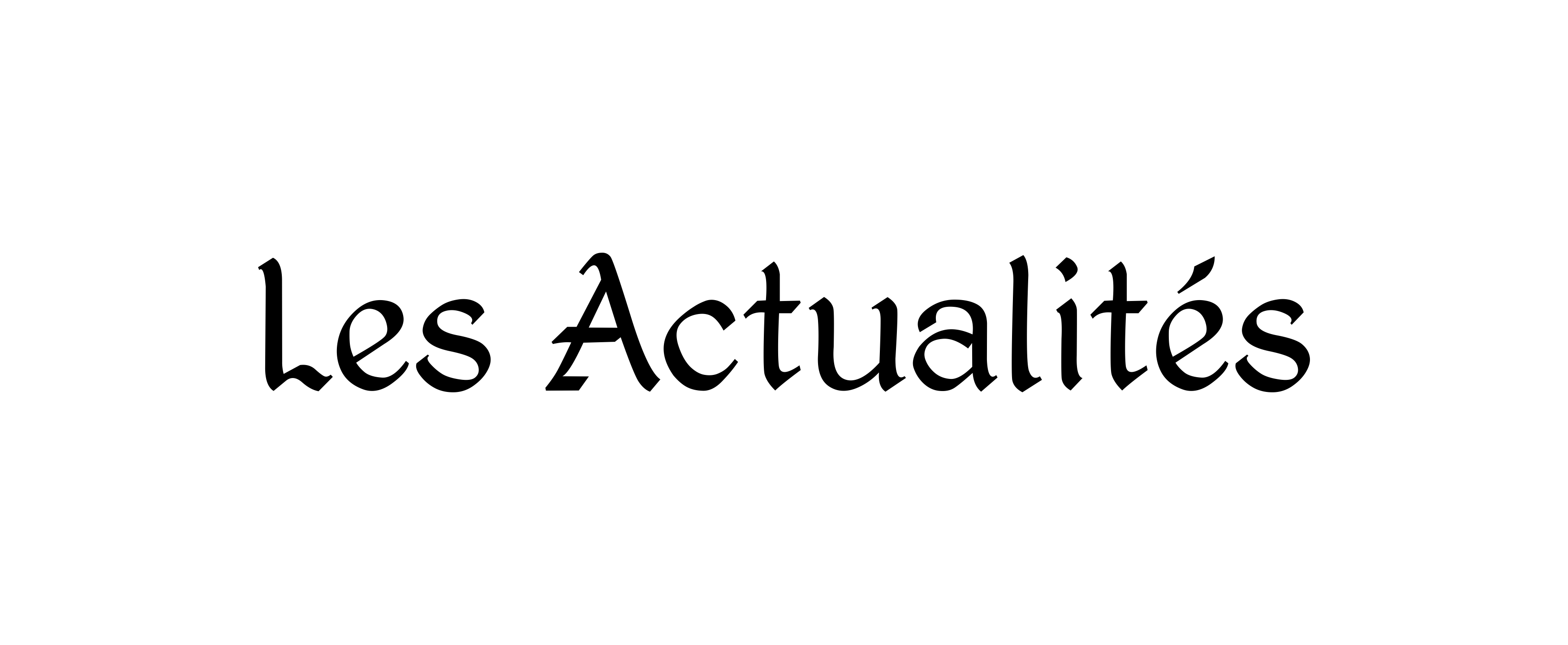Quand je (Nakamura) arrivé pour la première fois aux États-Unis. pour une bourse postdoctorale, le anxiété de parler anglais a frappé dès le premier instant où j’ai mis les pieds dans le hall d’immigration de l’aéroport international de Miami.
“Quel est ton nom?” » a déclaré un agent d’immigration pas très sympathique. Malgré tous les films en anglais que j’avais vus et les dialogues que j’avais pratiqués en anglais, je n’arrivais pas à le comprendre. Ma réponse a été frustrante : « Désolé. Quoi? Pouvez-vous répéter ça, s’il vous plaît?” Malgré toutes les choses passionnantes qui m’attendent en tant que scientifique aux États-Unis, cela m’a fait réfléchir : « Si je ne comprends même pas une question simple, comment suis-je censé travailler comme chercheur dans une université ?
Bien que l’anglais soit la lingua franca de la science, obtenir un excellent niveau d’anglais est un privilège réservé à quelques pays à revenu élevé ou à ceux qui peuvent se payer une formation linguistique intense dans les pays du Sud. Pourtant, la plupart des appels à l’embauche émanant des instituts de recherche du Nord exhortant à l’inclusion associent le fait d’être un bon scientifique et d’être bon (ou excellent) en anglais. Ce n’est pas vrai.
Récemment, une équipe de chercheurs dirigée par Tatsuya Amano de l’Université du Queensland a tenté de quantifier le temps et les coûts de carrière de moindres connaissances en anglais. Qu’il ait besoin de près de deux fois plus de minutes pour lire en anglais et jusqu’à 51 % plus de temps pour écrire en anglais que les anglophones natifs ou qu’il soit environ 2,5 fois plus susceptible qu’un anglophone natif de voir les éditeurs de revues rejeter leur travail sur une base linguistique. , le fait de ne pas bénéficier de l’avantage de la langue anglaise dans l’éducation punit injustement les bons scientifiques qui font de bonnes recherches.
En tant que chercheurs ayant travaillé dans des pays anglophones, nous exhortons les établissements universitaires qui croient réellement en créer un environnement inclusif reconnaître les barrières linguistiques et aider les locuteurs non natifs à devenir de meilleurs anglophones. Nous invitons également les scientifiques qui ont vécu notre situation à partager ouvertement leurs difficultés. Sachant cela peut aider les scientifiques nouveaux venus dans le monde anglophone à se libérer de l’attente selon laquelle nous devrions déjà être des locuteurs natifs au moment de notre arrivée.
C’est dire à quel point il peut être difficile d’apprendre l’anglais : au Brésil, d’où nous sommes originaires, l’enseignement de l’anglais est superficiel, surtout dans les écoles publiques. La plupart des gens n’interagissent avec l’anglais qu’à travers des chansons ou des films. Les cours privés coûteux sont hors de portée de la plupart de la population, mais ils constituent le seul moyen d’acquérir des compétences sans quitter le pays.
Pour prouver nos compétences en anglais, les universités publiques du Brésil proposent des tests gratuits qui nous donnent un score de compétence. Cependant, les universités du Nord n’acceptent généralement pas ces tests, et ceux qu’elles acceptent peuvent coûter jusqu’à un tiers du salaire mensuel d’un doctorat au Brésil.
Et même pour ceux qui maîtrisent bien la langue, parler anglais peut être plus compliqué qu’écrire et lire. Nos amis brésiliens partagent avec nous ce sentiment de mal de tête persistant dès les premiers mois de travail dans un pays étranger. Nous associons cela à l’énorme effort de communication dans une autre langue.
Ce « casse-tête » constitue un coût caché pour les chercheurs non anglophones. Nous pensons que nos superviseurs nous ont embauchés en raison de nos excellentes compétences en recherche et de nos listes de publications (presque toutes en anglais). Le travail que nous effectuons reflète ces compétences. Mais on a toujours le sentiment que la barrière de la langue empêche nos collègues de reconnaître pleinement ce que nous savons ; nous avons des pensées récurrentes : « Avons-nous dit ce que nous voulions réellement dire ?
Parler peut être particulièrement difficile dans des situations telles que des réunions informelles en laboratoire ou des tâches quotidiennes, car elles nécessitent un vocabulaire auquel nous ne sommes pas habitués. Maintenant, ajoutez à ce scénario un environnement dans lequel de bons discours ou conférences sont l’un des indicateurs de performance les plus élevés et un élément essentiel du recrutement. Nous pensons que cette pression décourage les chercheurs des pays où l’anglais n’est pas la langue maternelle de postuler à des emplois dans les pays développés.
Nous comprenons cela La maîtrise de l’anglais est requise travailler dans un pays anglophone, mais la science perd des talents lorsqu’elle licencie des personnes qui n’ont pas « l’excellence » attendue simplement parce qu’elles manquent de pratique. Nous pensons que les comités de recherche doivent cesser d’exiger des candidats qu’ils possèdent d’excellentes compétences en communication en anglais. Cette affirmation dans les offres d’emploi amène la plupart d’entre nous à remettre en question nos compétences. De plus, l’ajout d’un plus grand nombre d’anglophones non natifs aux comités de recherche contribuera à mieux faire comprendre qu’une barrière linguistique n’est pas une barrière en matière d’expertise scientifique.
Une fois embauchés, les établissements et les groupes de recherche peuvent faciliter la transition de communiquer en anglais à parler couramment. L’Université de Toronto, par exemple, soutient de nombreuses activités de formation et de pratique de l’anglais, comme un dîner de Thanksgiving et des clubs (académiques ou non). L’un de nos anciens superviseurs stimule toujours l’engagement par le biais de réunions hebdomadaires pour discuter de questions scientifiques et personnelles susceptibles d’influencer nos résultats académiques. Ces exemples offrent des opportunités moins exigeantes aux locuteurs non natifs de développer leurs compétences orales.
Et nos domaines scientifiques peuvent nous aider. Par exemple, pendant la réunion annuelle Évolution, l’une des réunions de recherche les plus importantes en évolution, systématique et écologie, le comité organisateur a inclus la possibilité de présenter les conférences en anglais ou en espagnol avec des sous-titres pour tous les participants virtuels. En outre, ils ont lancé un programme de mentorat pour aider les anglophones non natifs à préparer leurs résumés et leurs diapositives, et à s’entraîner à d’autres activités régulières qui peuvent être stressantes pour eux lors de la réunion en personne. D’autres sociétés ou départements de recherche pourraient facilement adopter cet exemple.
Enfin, il y a notre responsabilité les uns envers les autres, scientifiques qui ne maîtrisent pas encore l’anglais. Être loin de chez soi et parler une langue différente toute la journée est difficile. Cela peut prendre du temps pour se sentir à l’aise. Nous avons différentes courbes d’apprentissage pour différentes compétences, nous devons donc être patients avec nous-mêmes. Savoir que des personnes que nous admirons ont été confrontées à des problèmes similaires peut être utile dans le long processus menant à la maîtrise de l’anglais. L’excellence en anglais, quelle que soit la manière dont vous la définissez, viendra avec le temps.
Les choses se sont améliorées après un an de travail en tant que chercheurs postdoctoraux aux États-Unis et au Canada, mais nous avions toujours du mal à comprendre les nuances de l’anglais écrit. Nous avons eu du mal à trouver les mots, et lorsque nous les avons trouvés, ils n’étaient peut-être pas adaptés à la complexité que nous souhaitions transmettre. L’un de nous, Nakamura, est retourné au Brésil. L’autre, Soares, reste au Canada. Quand on parle de langage, on pense souvent à Gloria Pritchett, un personnage de la populaire série télévisée américaine Famille moderne. Gloria est de langue maternelle espagnole et vit dans une famille anglophone au rythme rapide.
« Savez-vous au moins à quel point je suis intelligent en espagnol ? elle dit dans un épisode, frustrée de devoir traduire des mots dans sa tête avant de les prononcer, et en colère que les gens rient quand elle a du mal à trouver les mots. “Bien sûr que non.”
Nous ressentons parfois la même chose.
Il s’agit d’un article d’opinion et d’analyse, et les opinions exprimées par l’auteur ou les auteurs ne sont pas nécessairement celles du Scientific American.