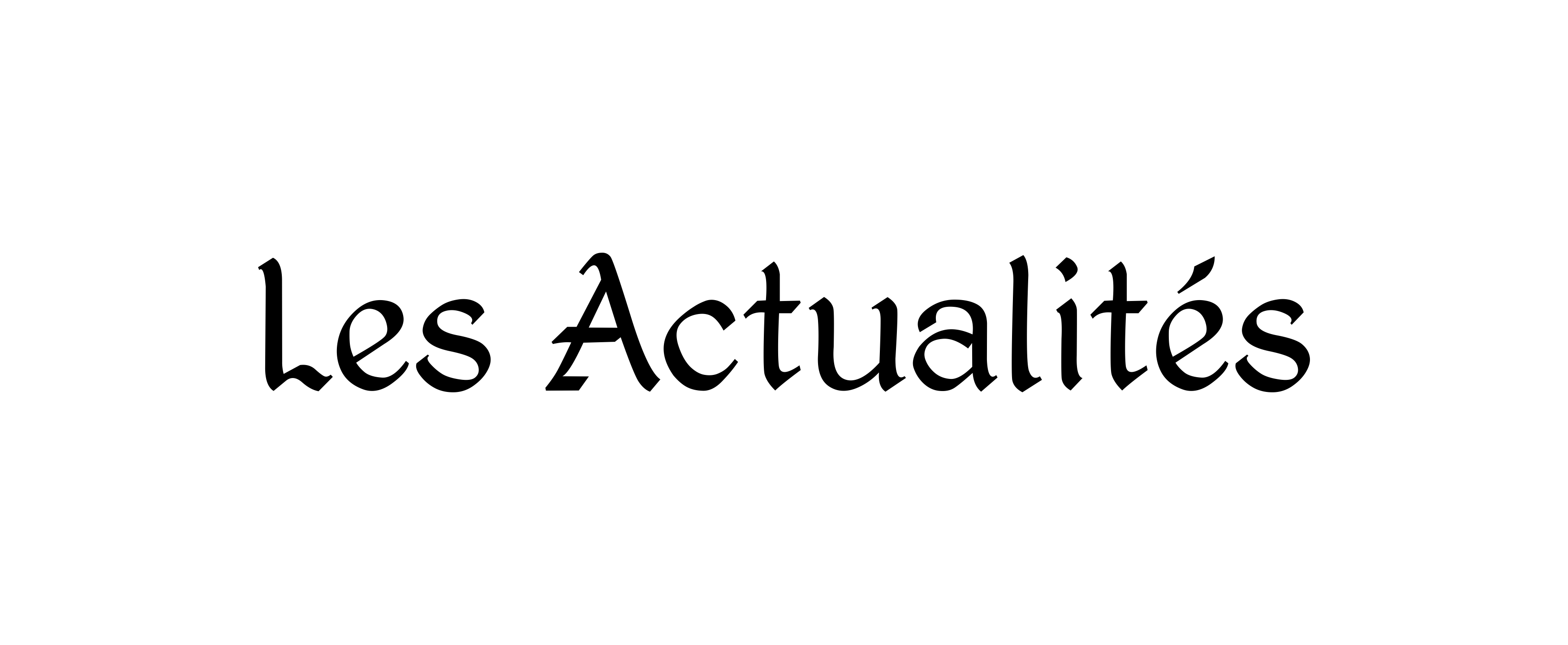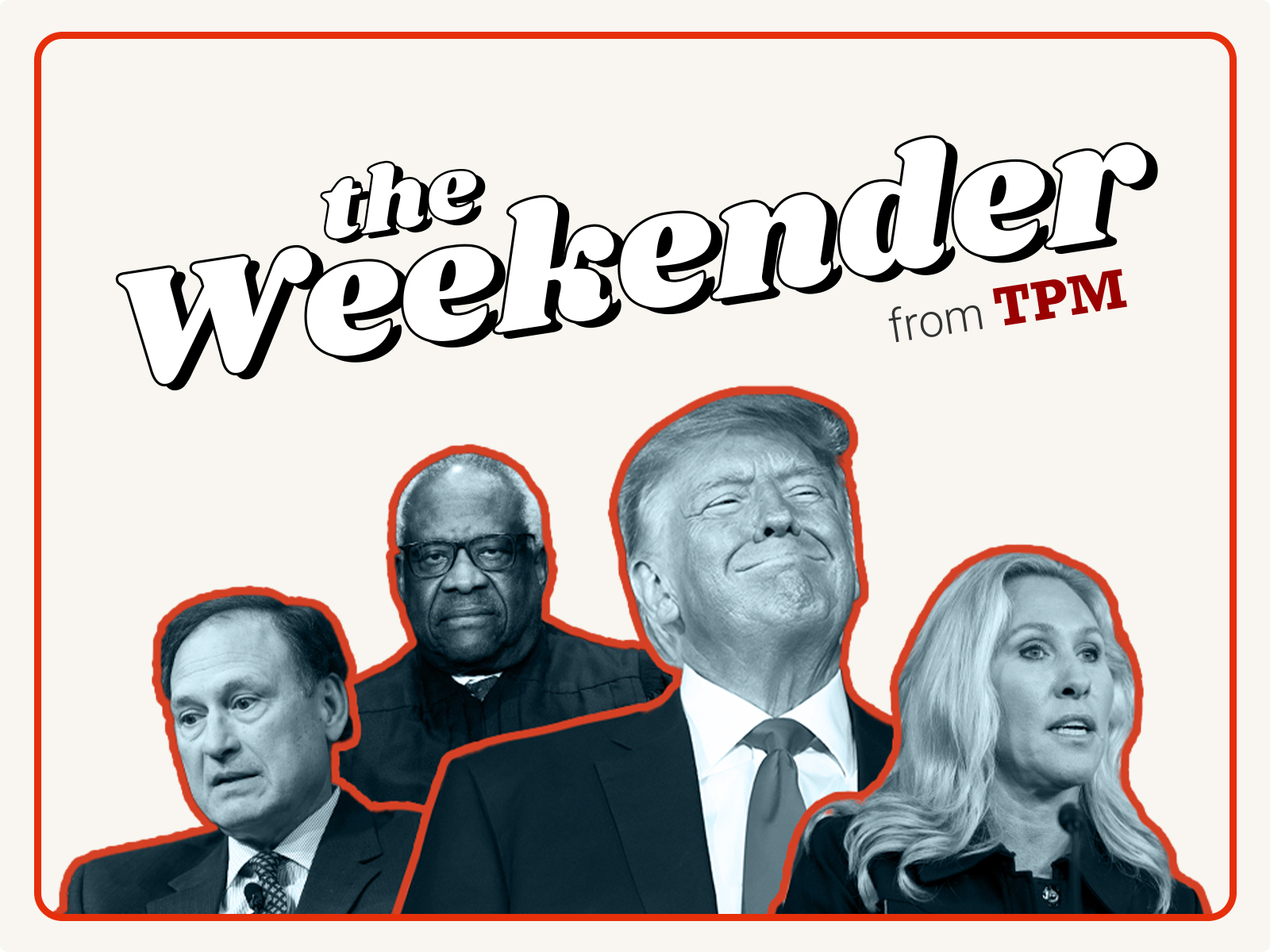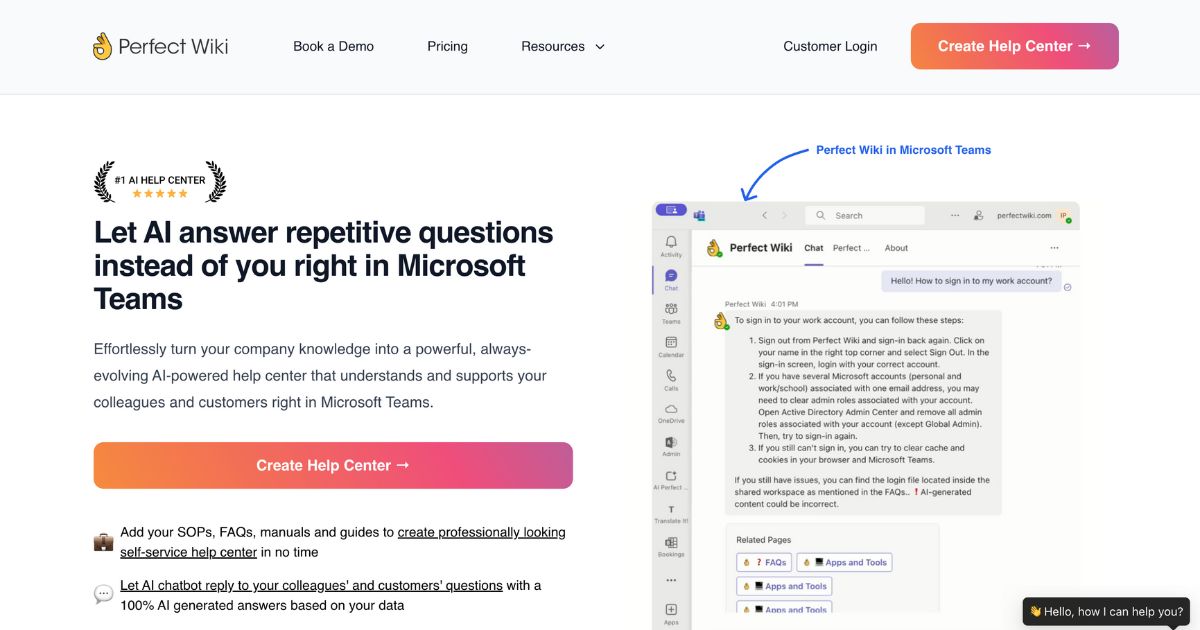La majorité a statué pour la tribu, un résultat qui s’accorde avec mon propre point de vue selon lequel la souveraineté tribale devrait être aussi large que possible. Mais le juge en chef Roberts, écrivant pour les quatre dissidents, a fait valoir que la tribu aurait dû perdre au motif que le jeu joué sur les machines n’était… pas vraiment du bingo. Les observateurs de la cour se sont amusés avec l’une des notes de bas de page de Roberts :
« Une photographie du dossier de cette version de ‘bingo’ est annexée à cet avis. Cela confirme que le bingo électronique joué au Speaking Rock Entertainment Center est à peu près aussi proche du vrai bingo que Bingo le célèbre chien.
Le célèbre chien, bien sûr, est celui qui porte le “nom-o” de Bingo, joueur vedette de ce que l’humoriste Ken Cowherd a qualifié de “la chanson pour enfants la plus irritante de l’histoire”. Mais le terme a une histoire plus ancienne et plus intéressante.
Mot d’étymologie incertaine, “Bingo” semble être entré dans la langue comme un terme d’argot pour le brandy. L’Oxford English Dictionary retrace cette signification jusqu’en 1699, et au 18e siècle, l’usage était courant. À un moment donné, le terme est devenu la base de “Little Bingo” – une chanson à boire que les érudits ont datée de 1780. Mais la chanson est plus ancienne que cela. Une publicité d’avril 1776 dans un journal d’Édimbourg annonce qu’un « Mr Dutton » interprétera « la chanson de Little Bingo ». Une note à la fin de l’annonce ajoute: “Comme un certain nombre d’amis de M. Dutton ont souhaité avoir les mots de Little Bingo, il en a imprimé un certain nombre, qui seront livrés gratuitement aux portes.”
En 1785, le chien était entré dans la chanson. Little Bingo “a sauté sur le style” (c’est-à-dire le montant), et le fermier “aimait une tasse de bonne bière” – ce qu’il appelait, nous dit-on, “un bon stingo rare”. Mais la chanson n’était toujours pas pour les enfants. Les mots semblent avoir été utilisés pour déterminer qui boirait ensuite, ou peut-être combien de gorgées ; c’est-à-dire que, comme beaucoup de chansons à boire, elle a été chantée au service de l’ivresse. Le livre dans lequel les paroles apparaissent mélange “Bingo” avec d’autres airs de débauche, certains sur l’alcool, d’autres sur le sexe (y compris le sexe hors mariage).
À un moment donné dans la seconde moitié du XIXe siècle, le couplet a été transformé en une chanson enfantine familière, souvent utilisée dans un jeu de chaises musicales. Et voici le point clé : qu’elle soit chantée par des buveurs ou des enfants, la chanson intégrait les concepts de gagner et de perdre.
Ce qui nous amène au jeu de bingo – celui qui était ou n’était pas proposé sur les terres tribales d’Ysleta del Sur Pueblo. En tant que jeu, le bingo est essentiellement une loterie, impliquant le hasard et non l’habileté. L’OED appelle l’origine de ce sens du mot “obscur” et n’atteste l’usage que de 1936. En fait, c’est plus ancien. Un article de 1893 paru dans un journal du Nebraska fait référence au bingo comme à un « vieux jeu fiable » qui est « très populaire » chez les femmes. D’autres citations à peu près à la même époque confirment qu’à la fin du 19e siècle, le jeu existait depuis un certain temps.
Mais le terme est également entré dans le langage comme signalant un niveau de dérision. On pense par exemple à “Bingo Bob” – le surnom du personnel de la Maison Blanche pour le vice-président maladroit dans les dernières saisons de l’aile ouest. Si un conseiller financier est accusé de « jouer au bingo » avec l’argent d’un client, personne ne considère l’expression comme un compliment.
Curieusement, le mot a même fait son chemin dans nos vies professionnelles. Les étudiants du Collège jouent au “bingo de la dinde” – la victoire revenant à celui qui réussit le mieux à prédire qui parlera en classe. Et puis il y a le « bingo de la Cour suprême » – un jeu qui semble impliquer de deviner quels juges voteront avec d’autres juges.
Non pas que l’affaire devant la Cour suprême comporte l’une ou l’autre de ces nuances. La loi fédérale en question autorisait la tribu à se livrer à toute forme de jeu non « entièrement » interdite par la loi texane. L’État autorise depuis longtemps le bingo à l’ancienne – le genre où les gens s’assoient à des tables en utilisant des cartes physiques au fur et à mesure que les numéros sont appelés – et la majorité a statué que les machines à sous de la tribu incorporaient la même idée. La petite blague de Roberts visait à réfuter cette conclusion. À son avis, le « bingo en direct » était, disons, un tout autre animal.
Les gags et l’humour ne sont pas ce à quoi on s’attend dans les avis de la Cour suprême des États-Unis. À Ysleta del Sur Pueblo, cependant, la blague qui s’est retrouvée dans la note de bas de page de Roberts a en fait été signalée lors de la plaidoirie, lorsque l’avocat de la tribu expliquait que la machine en question ressemblait à une machine de bingo, avant d’être interrompue par le juge en chef : “Qu’est-ce qui le fait ressembler à une machine de bingo?” À ce moment-là, si l’on en croit la transcription officielle, la salle d’audience a éclaté de rire.
Oh, et en parlant de blagues : si vous avez suivi les premières lettres de ce paragraphe et des quatre paragraphes précédents, félicitations pour avoir repéré le nom-o. Après tout, nous ne pouvons pas laisser le juge en chef s’amuser.
Plus de Bloomberg Opinion:
• À quel point sommes-nous vraiment proches de l’inflation des années 1970 ? : Robert Burgess, Elaine He et Eliza Winger
• Trump et ses alliés répéteront le 6 janvier si nécessaire : Timothy L. O’Brien
• La menace contre Kavanaugh changera irrévocablement la vie des juges : Thérèse Raphaël
Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.
Stephen L. Carter est un chroniqueur de Bloomberg Opinion. Professeur de droit à l’Université de Yale, il est l’auteur, plus récemment, de « Invisible : l’histoire de l’avocate noire qui a abattu le gangster le plus puissant d’Amérique ».
D’autres histoires comme celle-ci sont disponibles sur bloomberg.com/opinion