Baz Luhrmann n’a jamais été reconnu pour son innovation cinématographique, alors disons ici qu’avec Elvis il a été le pionnier du premier film composé exclusivement de montages du début à la fin. Tous les Greatest Hits du montage sont ici : gros titres de journaux par camions entiers ; une grande roue qui se transforme en disque tournant ; une succession de publics hurlants d’une ville à l’autre ; des affiches de concert signifiant la notoriété grandissante d’Elvis, dans lesquelles son nom monte en tête d’affiche ; l’argent et les signes extérieurs de la renommée. Le penchant de Luhrmann pour cette technique des plus éculées n’est que le symptôme d’une maladie plus large dans son cinéma, à savoir sa dépendance inquiétante au piratage et au remixage. Le réalisateur ne peut pas entendre une chanson mais il doit la couper, la faire tourner, y mettre un donk, la ralentir, ajouter une voix haletante, l’accélérer à nouveau, lancer une chorale de gospel, appuyer sur la pédale d’écho, et terminez-le avec une outro de rap non pertinente. Comme dans son processus, il en va de même pour sa narration: il est décourageant qu’il ne fasse pas confiance à son matériel pour capter notre attention de son propre chef, mais le gonfle à la place comme des illuminations de Blackpool. Elvis est un film pour bébés.
Le crochet supposé de ce nouveau film est qu’il se concentre sur l’exploitation financière d’Elvis Presley (Austin Butler, qui n’est pas la pire chose du film) par son manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks, qui pourrait l’être). Cela aurait pu être un angle riche pour aborder la légende d’Elvis Presley, dont l’histoire est déjà très connue, de ses débuts de jeune star du rockabilly à sa résidence à Las Vegas, en passant par son achat de Graceland et sa dépendance croissante à drogues et alcool. Le film de Luhrmann frappe tous ces rythmes, martelant avec de grands yeux une série d’observations banales sur Presley, comme le fait que sa musique mêlait la musique country blanche aux styles de la musique noire. Il y a sans doute des gens dans le monde à qui ce fait incroyablement célèbre n’était pas connu, et il est naturel qu’un biopic d’Elvis en parle, mais c’est la façon dont Luhrmann s’y prend qui agace. Ici, nous obtenons un zoom hilarant sur Tom Hanks réalisant que le gamin qu’il entend à la radio est blanc; une scène langoureuse de l’enfant-Elvis assistant à une performance de blues “sexy” ridicule dans une tente, et prenant part à un revival gospel au cours duquel il reçoit apparemment l’esprit de la musique noire ; il y a aussi un dialogue explicatif à cet effet, des gros titres de journaux sur la ségrégation et une scène en faillite dans laquelle Elvis, déjà une star établie, s’inspire d’un homme prometteur du nom de Little Richard.
Cette approche exagère considérablement l’innovation d’Elvis et est illusoire lorsqu’il s’agit de reconnaître la façon dont il s’est approprié la musique d’artistes de couleur tels que Little Richard. En réalité, Little Richard jouait depuis de nombreuses années au moment où Presley a commencé à enregistrer « That’s All Right », et « Tutti Frutti » est sorti peu de temps après les débuts de Presley avec Sun Records. C’est important, car loin d’être un exemple du métissage musical américain, Elvis a surtout fait ses débuts en volant des artistes noirs, et a eu des chances qu’ils n’auraient pas eues à cause de sa blancheur.
Après avoir passé tant de temps à raconter cette histoire alternative, Luhrmann passe ensuite à l’échec d’autres aspects de la vie d’Elvis – par exemple, Presley passe d’un jeune débutant prometteur avec une reconnaissance croissante à une superstar qui possède Graceland et vend des marchandises. La mort de la mère adorée de Presley est également hilarante – un moment, elle est vivante, et la seconde suivante, Austin Butler pleure sur ses chemisiers dans un dressing, sans presque aucune mention du fait que sa mère l’a conquis dans l’intervalle. période. Ces erreurs sont importantes, car le film est si extraordinairement long et passe ce qui semble être des décennies sur des éléments de la vie de Presley qui sont considérablement moins intéressants (comme la résidence à Vegas), que le film se sent bricolé, un chiffon.
“Ces erreurs sont importantes, car le film est si extraordinairement long et passe ce qui semble être des décennies sur des éléments de la vie de Presley qui sont considérablement moins intéressants (comme la résidence à Vegas), que le film se sent bricolé, un chiffon.”
Parmi tout cela, les problèmes familiers des biopics émergent, notamment le fait qu’Elvis est une icône extraordinairement célèbre et l’une des personnes les plus imitées de la planète. Austin Butler fait un travail parfaitement louable à cet égard, en particulier lors de performances musicales. Pendant les scènes de dialogue, sa voix d’Elvis semble parfois tendue, mais l’essentiel est qu’il ne soit pas gênant. Les scènes tardives dans lesquelles nous voyons le vrai Elvis jouer montrent assez douloureusement la différence de charisme, mais encore une fois, le vrai Elvis n’a pas eu à se battre contre son environnement pour convaincre les gens. En face de Butler, Tom Hanks, toutes prothèses et styles de voix effrayants, joue le colonel Tom Parker comme une sorte d’extraterrestre prédateur, mais pour une raison quelconque, sa performance ne prend jamais vie. Il devait y avoir tellement plus de méchanceté, beaucoup plus d’avantages pour ce personnage contrôlant, plutôt que de le faire être un narrateur peu fiable en marge. Cet échec à faire passer Tom Parker à travers ce qui aurait pu être la facette la plus intéressante du film: un regard sombre sur Elvis en tant que jouet en cage pourrait faire un film époustouflant, peut-être d’un autre réalisateur que Luhrmann.
Elvis est un objet si criard, bourdonnant et implacable, qui pendant 2,5 heures vacille pour faire clignoter son or comme un vieux millionnaire ivre dans un strip-tease. L’effet global produit par tant de vulgarité frénétique, tant d’effets brillants, est celui d’un épuisement total. Luhrmann ne ralentira sans doute jamais, mais il pourrait encore avoir le temps pour lui de donner une forme à son cinéma hyperactif, peut-être avec l’aide d’un scénariste obstiné (Elvis crédite environ 192 personnes sur des tâches de script) qui peuvent apporter quelque chose d’humain reconnaissable à son monde.
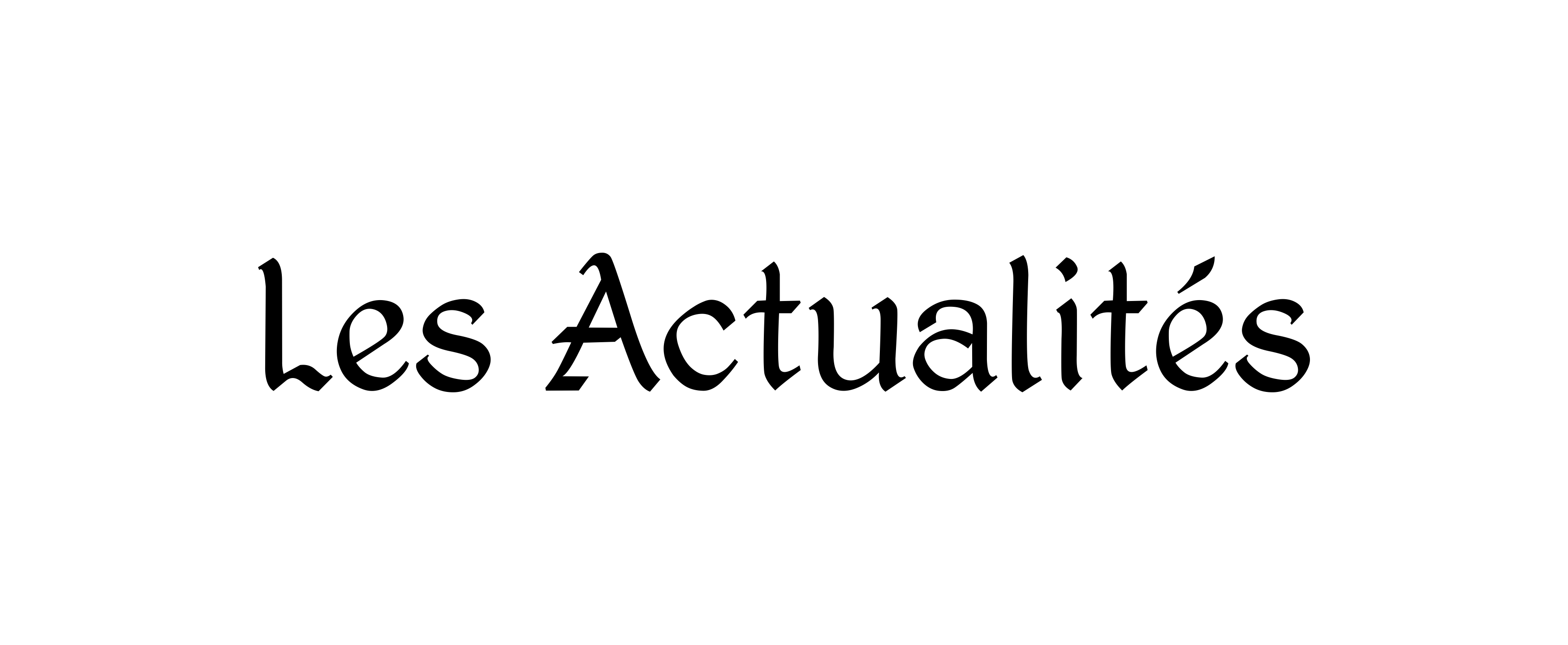


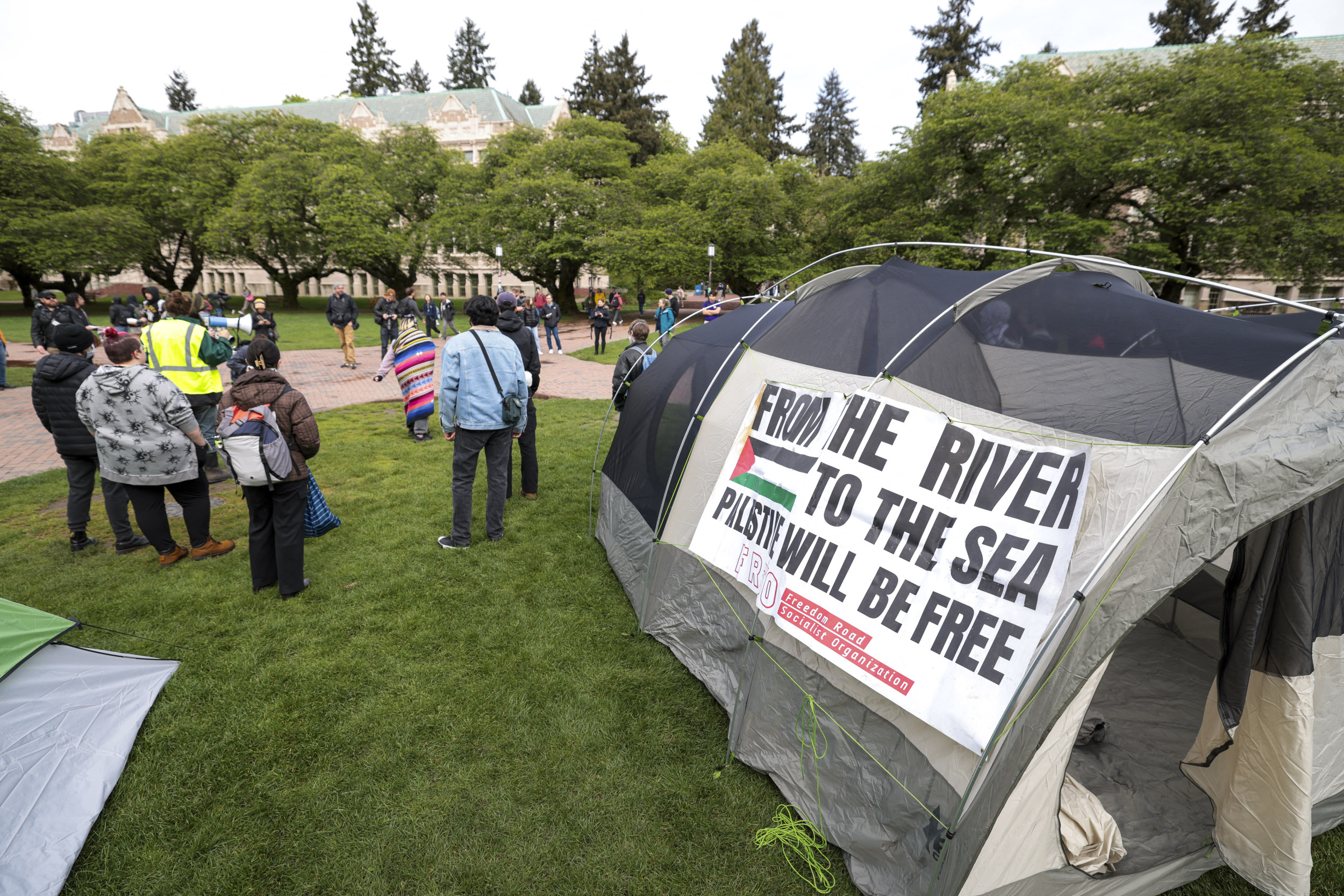




:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/562MEFHAFJCORKH2IZDFMFKJ2A.png)


