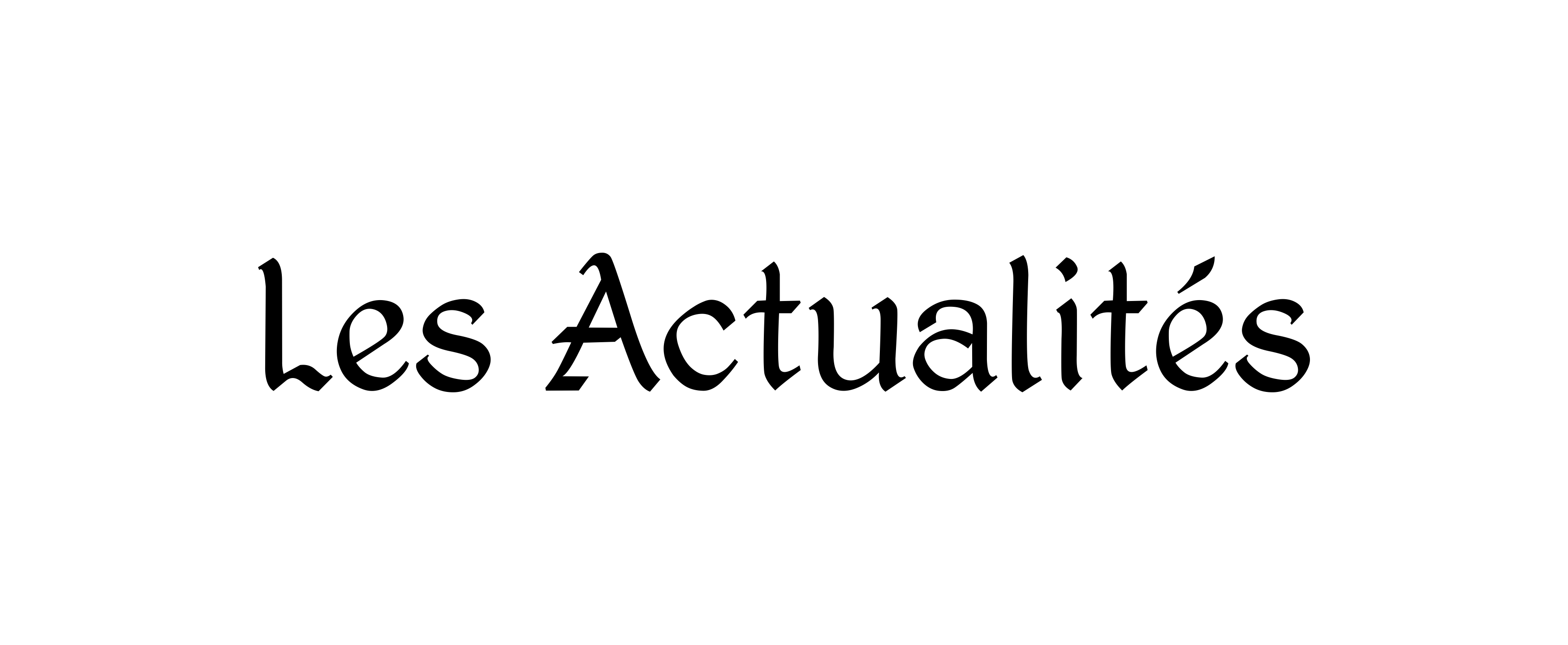Avec un plus grand nombre de personnes vaccinées et des pays cherchant à rouvrir leurs frontières en toute sécurité, l’introduction d’une certaine forme de passeport vaccinal semble de plus en plus probable.
Pour la Nouvelle-Zélande, où la stratégie d’élimination a été largement couronnée de succès mais qui reste vulnérable aux violations des frontières, la preuve de la vaccination pourrait bien être une condition d’entrée.
Le ministre de la Santé, Chris Hipkins, a déclaré que ce serait “presque inévitable” au cours de la prochaine année. Air New Zealand est l’une des nombreuses compagnies aériennes qui testent déjà l’initiative des laissez-passer de voyage IATA.
Certains pays exigent également des « laissez-passer de santé » – une preuve obligatoire de vaccination ou un test négatif, y compris pour les événements en salle (tels que les jeux sportifs et les concerts) et l’hospitalité – déclenchant des manifestations anti-restrictions dans le processus.
En Grande-Bretagne, la Royal Society a mis en garde contre le potentiel des passeports vaccinaux de restreindre les libertés de certains individus, ou de créer une distinction entre les individus en fonction de leur état de santé.
De plus, les passeports vaccinaux utilisent des informations personnelles sensibles et les cyberattaques contre les secteurs de la santé en Nouvelle-Zélande et à l’étranger rappellent que la sécurité des données n’est pas toujours garantie.
Les passeports vaccins ne sont pas nouveaux
Nous devons cependant nous rappeler que la liberté de circulation à travers les frontières a été régulièrement réglementée tout au long de l’histoire. Les passeports modernes pour les voyages internationaux sont utilisés depuis plus de 100 ans.
La preuve de vaccination n’est pas nouvelle non plus. Certains pays exigent des certificats de vaccination contre la fièvre jaune depuis plusieurs décennies, et le document de vaccination « carton jaune » de l’Organisation mondiale de la santé est familier à de nombreux voyageurs internationaux.
En Nouvelle-Zélande, les registres de vaccination documentent les dossiers de vaccination à des fins de santé publique. Et en Australie, une politique « No jab no play/no jab no pay » régit l’éligibilité aux prestations de protection de l’enfance.
Droits et libertés en cas d’urgence de santé publique
Le droit à la liberté de mouvement est reconnu dans la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international sur les droits civils et politiques, ainsi que dans d’autres traités fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme que la Nouvelle-Zélande a acceptés.
Le Bill of Rights Act de la Nouvelle-Zélande inclut également le droit à la liberté de mouvement.
Mais les fermetures et les verrouillages des frontières démontrent clairement que ce droit peut être limité, même si cela « doit être nécessaire et avoir un but légitime, être proportionné et fondé sur la loi ».
En réalité, toute exigence que les citoyens utilisent des passeports ou des laissez-passer vaccinaux impliquera un équilibre entre divers droits.
Droits et devoirs concurrents
La limitation du droit à la libre circulation peut être justifiée pour des raisons de santé publique. Le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels exige en fait que les États préviennent, traitent et contrôlent les maladies épidémiques comme l’un des moyens de garantir le droit au meilleur état de santé possible.
Étant donné que la loi néo-zélandaise sur la Déclaration des droits autorise également des restrictions manifestement justifiables au droit à la liberté de mouvement, les diverses mesures Covid-19 adoptées par le gouvernement en vertu de la loi sur la santé devaient répondre à cette exigence.
Et Te Tiriti o Waitangi – le traité de Waitangi – sous-tend le principe de protection active qui « exige que la Couronne agisse, dans toute la mesure du possible, pour obtenir des résultats de santé équitables pour les Maoris ».
Bien que la loi néo-zélandaise sur la Déclaration des droits ne contienne pas de droit à la vie privée, l’un des objectifs de la loi sur la protection de la vie privée est de donner effet aux obligations et normes internationales, y compris le pacte international sur les droits civils et politiques.
Aucun motif de discrimination
Toute initiative visant à introduire des passeports vaccinaux ou des laissez-passer de santé doit être fondée sur le droit de ne pas subir de discrimination, tel que prévu par le droit international des droits de l’homme, ainsi que par la loi néo-zélandaise sur la Déclaration des droits. La loi sur les droits de l’homme interdit la discrimination fondée sur la maladie physique.
Ces exigences s’étendent au secteur privé, avec des règles particulières en jeu concernant la fourniture de biens et de services et l’accès du public aux lieux, véhicules et installations – une exception à cette dernière étant le risque de contaminer les autres avec une maladie.
Mais il ne s’agit pas seulement d’éviter la discrimination. Tout comme il y a eu des questions sur l’accès équitable aux vaccins Covid-19, l’accès universel à la technologie numérique qui sous-tend les passeports ou les laissez-passer présente un défi.
Plus généralement, comme l’a prévenu un rapport de l’ONU, « les mégadonnées et l’intelligence artificielle renforcent les inégalités raciales, la discrimination et l’intolérance ».
En fin de compte, ce sera un exercice d’équilibre, pas un cas d’absolu.
Les certificats de vaccination numériques aideront à rouvrir les frontières et à protéger la santé publique. Mais il y a des implications importantes pour nos droits en tant qu’individus. Des décisions prudentes et transparentes seront cruciales.
Cet article a été publié pour la première fois dans Conversation. Claire Breen est professeure de droit à l’Université de Waikato à Hamilton