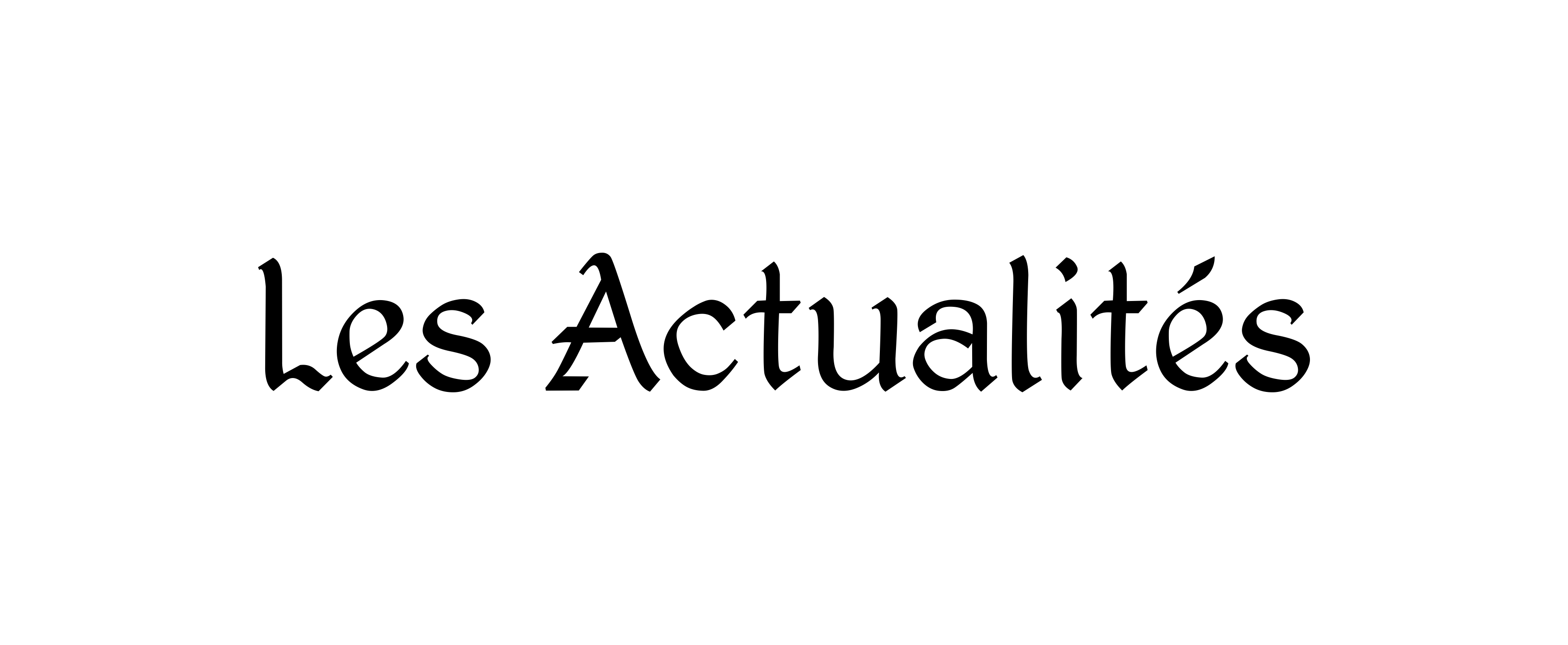Regarder les villes afghanes tomber en succession rapide aux mains des talibans, alors que les États-Unis achèvent un retrait précipité du pays, est une expérience surréaliste, empreinte d’un sentiment de déjà vu. Il y a vingt ans, j’ai rapporté depuis l’Afghanistan que les ennemis des talibans leur ont pris ces mêmes villes, lors de la courte mais décisive offensive militaire soutenue par les États-Unis qui a suivi les attentats du 11 septembre. La guerre contre le terrorisme venait d’être déclarée et l’action militaire américaine en cours était masquée par un déterminisme délibéré au nom de la liberté et contre la tyrannie. Pendant un bref instant, la guerre a été bénie par cette chose rare : le soutien public, tant au pays qu’à l’étranger.
À la suite de l’horreur des attaques d’Al-Qaïda contre les États-Unis, la plupart des Américains interrogés pensaient que le pays faisait la « bonne chose » en entrant en guerre en Afghanistan. Ce niveau de soutien n’a pas duré longtemps, mais la guerre contre le terrorisme l’a fait, tout comme l’expédition militaire en Afghanistan, qui s’est prolongée de manière non concluante pendant deux décennies et se termine maintenant dans l’ignominie. Donald Trump a déclenché ce fiasco en annonçant son intention de retirer les troupes américaines restantes en Afghanistan et d’entamer des négociations avec les talibans. En février 2020, un accord a été signé qui promettait de retirer toutes les forces militaires américaines en échange, entre autres, de pourparlers de paix avec le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis. Les troupes américaines ont été dûment retirées, mais, au lieu de s’engager dans de véritables discussions, les talibans ont intensifié leurs attaques. En avril, le président Joe Biden a annoncé son intention de poursuivre le retrait et de retirer ses forces d’ici le 11 septembre. Même s’il dit qu’il « ne regrette pas » sa décision, sa présidence sera tenue pour responsable de tout ce qui se passera en Afghanistan maintenant, et les mots clés qui seront à jamais associés au long séjour américain là-bas comprendront l’orgueil, l’ignorance, l’inévitabilité, trahison et échec.
À cet égard, les États-Unis rejoignent une lignée de prédécesseurs notables, dont la Grande-Bretagne, au XIXe siècle, et l’Union soviétique, au XXe. Ces précédents historiques ne rendent pas l’expérience américaine plus acceptable. En Afghanistan, et d’ailleurs en Irak également, les Américains n’ont pas simplement appris des erreurs des autres ; ils n’ont pas appris de leurs propres erreurs, commises une génération plus tôt, au Vietnam.
Les principales erreurs ont été, d’une part, de sous-estimer les adversaires et de présumer que la supériorité technologique américaine se traduisait nécessairement par la maîtrise du champ de bataille, et, d’autre part, d’être culturellement dédaigneux, apprenant rarement les langues ou les coutumes des populations locales. À la fin de la première décennie américaine en Afghanistan, il semblait évident que l’entreprise occidentale de contre-insurrection était vouée à l’échec, et pas seulement à cause du retour des talibans dans de nombreuses régions rurales du pays : les Américains et leurs OTAN les alliés se sont fermés aux Afghans dans les grandes bases régionales, à partir desquelles ils ont opéré dans des unités plus petites hors des avant-postes de combat, et la méfiance s’est réprimée entre eux et leurs camarades afghans putatifs. Les « attaques vert sur bleu », au cours desquelles les forces de sécurité afghanes ont ouvert le feu sur leurs homologues américains et européens, sont devenues d’une fréquence alarmante. Les talibans, quant à eux, sont devenus inexorablement plus forts.
Lors d’une visite dans la province orientale de Khost, tendue et assiégée, à l’hiver 2010, un haut commandant militaire américain là-bas, le lieutenant-colonel Stephen Lutsky, m’a reconnu le manque de confiance avec ses homologues afghans, dont il soupçonnait plusieurs travailler avec les talibans. « La complexité culturelle de l’environnement est tellement énorme qu’il nous est difficile de la comprendre », a-t-il déclaré. «Pour les Américains, c’est noir ou blanc, c’est soit les gentils, soit les méchants. Pour les Afghans, ce n’est pas le cas. Il y a de bons et de mauvais talibans, et certains d’entre eux sont prêts à conclure des accords entre eux. C’est juste au-delà de nous.
Dix ans plus tard, alors que les capitales provinciales de l’Afghanistan tombent aux mains des talibans et que Kaboul elle-même est encerclée, la litanie de noms de lieux exotiques – Sheberghan, Taloqan, Kunduz, Kandahar, Herat – ne doit pas signifier grand-chose pour la plupart des Américains, à l’exception de ceux qui ont déjà été déployés. en eux. Mais il y a une génération, alors que les moudjahidines afghans, ou guerriers sacrés, de la soi-disant Alliance du Nord, une coalition anti-talibans commandée par des seigneurs de la guerre, se battaient aux côtés des forces spéciales américaines pour libérer ces mêmes villes des talibans, ils faisaient constamment la une des journaux. , aussi banal pour les Américains que Benghazi ou Raqqa le sont devenus plus tard. (En temps de guerre, comme dans la vie, peut-être, les gens et les lieux peuvent devenir brièvement et souvent intensément familiers, pour être effacés de la mémoire lorsque leur apparente pertinence a cessé. Qui se souvient aujourd’hui de Hamid Karzai ? Ou du mollah Omar ?)
Lorsque Kunduz et Sheberghan, des villes adjacentes du nord de l’Afghanistan, sont tombées à une journée d’intervalle, le week-end dernier, je me suis demandé combien d’Américains se souvenaient qu’il s’agissait des sites de certains des premiers épisodes les plus sanglants de la guerre, en 2001. Dans le désert à l’extérieur de Kunduz, des centaines, voire des milliers de talibans et de prisonniers de guerre présumés d’Al-Qaïda, qui s’étaient rendus à l’Alliance du Nord après la chute de la ville en novembre, ont été enfermés dans des conteneurs d’expédition et abattus ou laissés à mort par les forces dirigées par les Afghans. le chef de guerre Abdul Rashid Dostum, qui travaillait avec la CIA et avec les commandos des forces spéciales. Certains des survivants de cette épreuve ont été sélectionnés pour être rendus par des agents américains sur le terrain et se sont retrouvés prisonniers à Guantanamo, ouvrant ainsi un nouveau chapitre controversé de l’histoire judiciaire américaine.
Dans le même temps, un soulèvement de talibans capturés et de djihadistes étrangers, dans une forteresse voisine nommée Qala-i-Jangi, a entraîné le meurtre de Johnny Micheal Spann, un officier américain de la CIA, le premier Américain à mourir au combat en Afghanistan. Après des jours de combats, au cours desquels au moins trois cents prisonniers sont morts, le « taliban américain » John Walker Lindh, un musulman de vingt ans converti de Californie, devenu volontaire dans les forces talibanes et interrogé par Spann, a été repris, après que Dostum ait inondé les chambres souterraines du complexe. Lindh a été renvoyé aux États-Unis, jugé par un tribunal fédéral pour avoir apporté son soutien aux talibans et condamné à vingt ans dans une prison fédérale de haute sécurité. Sa présence à la forteresse, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’il ait participé à la révolte, a provoqué de forts sentiments aux États-Unis et a conduit à un débat en cours sur l’identité nationale et la loyauté à l’époque moderne. En 2019, Lindh a été libéré trois ans plus tôt, pour bonne conduite, et il est en probation pour le reste de sa peine.
J’étais sur les lieux de la chute de Kunduz, en 2001, et je faisais partie d’un petit groupe de journalistes étrangers pris en embuscade par des combattants talibans restés cachés et attaqués, alors même que la plupart de leurs camarades étaient en train de se rendre. Heureusement, aucun de nous n’a été tué, mais la nuit suivante, après notre retour dans la capitale provinciale voisine, Taloqan, qui avait déjà été reprise par l’Alliance du Nord – et qui est également tombée aux mains des talibans le week-end dernier – un journaliste suédois a été abattu et tué par des hommes armés à la maison où il résidait. Après sa mort et compte tenu de la présence persistante de nombreux talibans à Taloqan, ainsi que de combattants alliés ouzbeks, dont nous avions vu un groupe engagé dans des accords de dernière minute avec l’Alliance du Nord, les journalistes étrangers ont rapidement fui la ville. J’ai rejoint un convoi armé en direction de Kaboul, un voyage de quatre jours à travers les montagnes de l’Hindu Kush. En chemin, nous avons été accostés par des hommes armés afghans – peut-être des talibans, peut-être simplement des bandits de grand chemin – mais, encore une fois, nous avons eu de la chance et sommes arrivés sans faire de morts.
Kaboul était déjà tombé, soi-disant. Au moins, les talibans étaient visiblement partis et, avec eux, leurs amis d’Al-Qaïda. Mais, les jours suivants, alors que je me déplaçais dans la ville dévastée, j’avais des raisons de me demander à quel point la victoire de l’Alliance du Nord assistée par l’Occident avait été authentique. Un matin, un groupe de quatre femmes dissimulées dans des burqas bleues s’est approchée de moi dans la rue et l’une d’elles m’a demandé si je connaissais des opportunités de travail. J’ai été accosté par un commerçant furieux pour avoir osé communiquer à travers le fossé entre les sexes. Les femmes se sont dispersées. C’était comme si une maladie persistait dans l’air afghan, malgré la retraite des talibans.
.