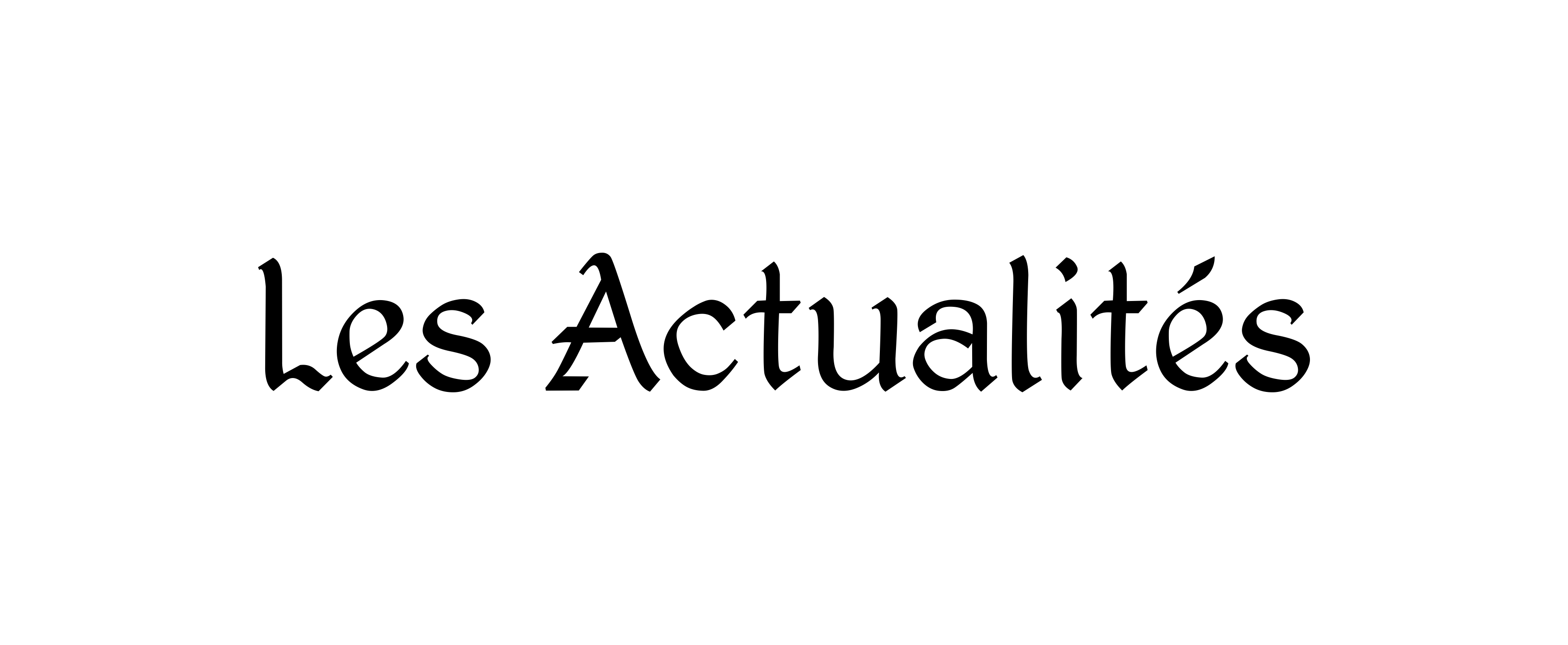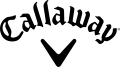Dans ce qui pourrait être la première estimation des décès bactériens dans le monde, les chercheurs ont signalé que 33 agents pathogènes bactériens étaient responsables de plus d’un décès sur 7 en 2019, cinq agents pathogènes étant liés à un peu plus de la moitié de ces décès.
“Les décès associés à ces bactéries seraient la deuxième cause de décès dans le monde en 2019”, derrière les cardiopathies ischémiques, écrivent le chercheur principal Mohsen Naghavi, MD, PhD, de l’Université de Washington, Seattle, et un hôte de GBD 2019 Antimicrobial Collaborateurs de la résistance.. “Par conséquent, ils devraient être considérés comme une priorité urgente d’intervention au sein de la communauté mondiale de la santé.”
Les résultats, publiés en ligne aujourd’hui dans Le Lancetpointer vers Staphylococcus aureus comme la principale cause de mortalité bactérienne dans 135 pays et Streptococcus pneumoniae associé au plus grand nombre de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Les trois autres agents pathogènes les plus significatifs sur le plan clinique étaient Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, et Pseudomonas aeruginosa.
L’étude a estimé S. aureus était lié à plus d’un million de décès dans le monde en 2019, tandis que les quatre autres agents pathogènes étaient associés à plus de 500 000 chacun.
“Cette étude peut être utilisée pour guider les stratégies de réduction du fardeau des maladies infectieuses bactériennes, y compris les mesures de prévention et de contrôle des infections, le développement et la mise en œuvre de vaccins et la disponibilité des services de soins aigus de base”, écrivent les auteurs.
33 agents pathogènes, 204 pays et 11 syndromes infectieux
L’étude a estimé la charge mortelle associée à l’infection causée par 33 espèces ou genres bactériens dans 204 pays ou territoires et dans 11 syndromes infectieux. Les chercheurs ont inclus des bactéries à la fois résistantes et sensibles aux antimicrobiens, mais ils ont exclu Mycobacterium tuberculosiscar il s’agit déjà d’un objectif majeur d’une initiative mondiale de santé publique, ont-ils écrit.
Les chercheurs ont utilisé des données dérivées de certificats de décès, de dossiers de sortie d’hôpital, de surveillance de la mortalité, de revues de la littérature et de données microbiennes, ainsi que des estimations de l’étude Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study.
En trois étapes de modélisation, ils ont estimé :
-
le nombre total de décès dans lesquels l’infection a joué un rôle
-
les syndromes infectieux responsables de ces décès
-
les pathogènes associés à ces syndromes infectieux
“Un syndrome infectieux est l’infection directement responsable de la septicémie et sert de pont entre la cause sous-jacente du décès et la septicémie”, expliquent les auteurs.
Les trois syndromes responsables du plus grand nombre de décès étaient les infections des voies respiratoires inférieures, les bactériémies et les infections péritonéales et intra-abdominales. Les syndromes responsables du plus grand nombre de décès variaient d’un endroit à l’autre.
Dans l’ensemble, les infections des voies respiratoires inférieures étaient responsables de 4 millions de décès, les bactériémies de 2,91 millions de décès et les infections péritonéales et intra-abdominales de 1,28 million de décès.
“Il y avait une variation substantielle dans laquelle l’agent pathogène était le plus dominant dans différents syndromes infectieux”, notent les auteurs, avec S pneumoniae étant la première cause d’infections mortelles des voies respiratoires inférieures (653 000 décès), S. aureus étant la principale cause d’infections mortelles du sang (299 000 décès), et et E coli étant la première cause d’infections péritonéales et intra-abdominales mortelles (290 000 décès).
Il y avait une “variation considérable” d’une région à l’autre dans le fardeau des infections bactériennes, le plus grand nombre de décès survenant en Afrique subsaharienne, “où nous avons clairement vu l’effet des agents pathogènes Gram-positifs et Gram-négatifs”, écrivent-ils. Le fardeau disparate en Afrique subsaharienne est amplifié par le fardeau substantiel des années de vie perdues (YLL) dans cette région également, ajoutent-ils.
Dans l’ensemble, le taux de mortalité normalisé selon l’âge associé à ces agents pathogènes bactériens était le plus élevé en Afrique subsaharienne (230 décès pour 100 000 habitants) et le plus bas dans la super-région à revenu élevé (52,2 décès pour 100 000 habitants).
“En estimant la mortalité et les YLL pour un large éventail d’agents pathogènes et de syndromes infectieux, nous avons produit un compte rendu mondial des bactéries pour lesquelles le fardeau était auparavant inconnu et, peut-être, sous-estimé”, notent-ils.
Peu d’attention de la santé publique
Sur les cinq agents pathogènes les plus significatifs sur le plan clinique qu’ils ont identifiés, seuls S pneumoniae a été au centre des initiatives mondiales de surveillance et de santé publique, ont-ils écrit, les autres « n’étant pas au centre des initiatives mondiales de santé publique ».
Les chercheurs ont mis l’accent sur quatre interventions pour faire face au fardeau de ces pathogènes bactériens :
-
prévention des infections
-
vaccination
-
des services de soins aigus adéquats, y compris « l’accès en temps opportun aux antibiotiques appropriés, la capacité microbiologique d’identifier l’agent pathogène responsable d’une infection et la fourniture de soins de soutien »
-
une “approche stratégique et un investissement important dans le développement d’antibiotiques nouveaux et efficaces”
Bien que cette étude ait examiné à la fois les pathogènes bactériens sensibles et résistants aux antimicrobiens, la résistance aux antimicrobiens (RAM) est “le maillon le plus faible” qui menace “l’ensemble de la médecine moderne et de la santé publique”, selon une perspective publiée une semaine plus tôt dans PLoS Biology par Christiane Dolecek , MD, PhD, de l’Université d’Oxford, Oxford, Royaume-Uni, et de l’Université Mahidol, Bangkok, Thaïlande, et ses collègues.
Dolecek et Naghavi, ainsi que les collaborateurs de la résistance aux antimicrobiens, ont contribué au “rapport GRAM”, une analyse systématique de la charge mondiale de la résistance bactérienne aux antimicrobiens en 2019 publiée plus tôt cette année dans Le Lancet. Ils ont estimé que la RAM était un facteur contributif à 4,3 millions de décès et a directement contribué à 1,27 million de décès cette année-là.
“Les grands principes de lutte contre les infections bactériennes résistantes aux médicaments ont été clairement définis et convenus… Cependant, leur mise en œuvre s’est avérée beaucoup plus difficile”, ont écrit l’éditorialiste Dolecek et ses collègues.
“Il reste beaucoup à faire, même dans les pays les plus riches, en particulier pour encourager la gestion responsable des antibiotiques, la recherche et l’innovation (R&I) et soutenir les mécanismes d’attraction pour dissocier le développement d’antibiotiques du volume des ventes. Cependant, la réalité dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire pays est que les ressources dédiées aux actions nécessaires à la réalisation de ces plans font défaut, ce qui compromet leur mise en œuvre ».
Soulignant que “nous sommes sur une tendance désastreuse”, ont-ils conclu, “nous devons de toute urgence nous recentrer sur la résistance aux antimicrobiens ; sinon, des vies plus précieuses seront perdues”.
L’étude Global Burden of Disease a été financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le ministère de la Santé et des Affaires sociales, à l’aide d’un financement d’aide britannique géré par le Fleming Fund. Le projet GRAM est financé par le Fleming Fund du ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales, le Wellcome Trust et la Fondation Bill et Melinda Gates. Les auteurs de l’étude et les éditorialistes ne rapportent aucune relation financière pertinente.
Lancette. Publié en ligne le 21 novembre 2022. Texte intégral
Kate Johnson est un journaliste médical indépendant basé à Montréal qui écrit depuis plus de 30 ans sur tous les domaines de la médecine.
Pour plus d’actualités, suivez Medscape sur Facebook, TwitterInstagram, YouTube et LinkedIn